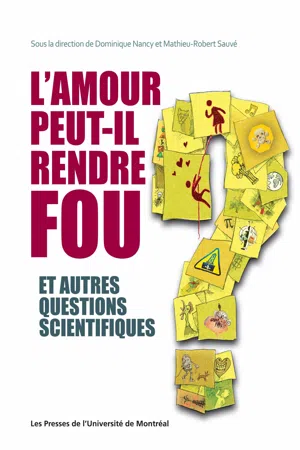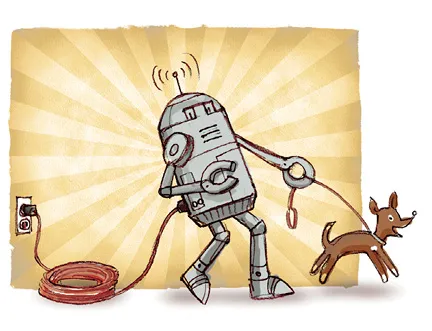![]()
ÉPILOGUE
Pourquoi la science?
par Frédéric Bouchard
Philosophe de la biologie, Frédéric Bouchard est un spécialiste de la théorie de l’évolution et de l’histoire des idées. Conférencier recherché, tant en Amérique qu’en Europe, il mène des recherches sur la place de la science dans la société, tout en assurant un enseignement de haut niveau (il a obtenu un des prix d’excellence en enseignement de l’Université de Montréal au tout début de sa carrière en 2008). Directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie et titulaire de la chaire Ésope en philosophie, il livre ses réflexions sur l’évolution des connaissances et de la communication de la science.
La science tiendra-t-elle ses promesses?
Quelles promesses? Je ne connais pas de chercheur qui promette des retombées directes de ses découvertes. L’objectif des savants et des intellectuels est d’abord de repousser les limites de la connaissance. Il serait téméraire qu’un expert en oncologie clame que ses travaux mènent à l’éradication du cancer ou qu’un épidémiologiste annonce la fin des maladies infectieuses. Si on peut avoir l’impression que la science «promet» des choses, c’est que les résultats de la recherche sont souvent amplifiés par l’opinion publique avide de percées spectaculaires. C’est nous tous qui espérons que les humbles avancées de la recherche soient des «pas de géant». Nous mettons plusieurs de nos espoirs dans des retombées concrètes, des applications immédiatement téléchargeables.
La recherche relève d’une tout autre logique; elle avance par tâtonnements, par essais-erreurs. D’ailleurs, les expériences qui échouent sont aussi importantes que celles qui réussissent. Elles permettent d’aller plus loin ou d’identifier les culs-de-sac.
Cela dit, la lutte pour le financement de la science amène les chercheurs, même les plus honnêtes, à identifier et souligner toutes les applications potentielles de leurs découvertes. Dans les demandes de subvention, ils tentent de souligner l’impact que pourraient avoir leurs découvertes afin d’obtenir des fonds. Pour obtenir les moyens de faire de la recherche subventionnée, il faut souvent annoncer des retombées positives plutôt que des démarches purement exploratoires.
Que doit-on attendre de la recherche?
Trois choses: répondre à nos aspirations, vaincre nos inquiétudes et comprendre la nature. Je m’explique. Lorsque les Américains ont décidé d’investir dans la conquête spatiale dans les années 1960, cet objectif visait une aspiration: conquérir la Lune. On y a consacré des milliards de dollars et mis à contribution les plus grands savants de l’époque. En tant qu’être humain, nous avons diverses aspirations et nous souhaitons que la recherche nous aide à les satisfaire. Quant à elle, la lutte aux grandes maladies de notre époque – cardiopathies, cancers, etc. – relève du domaine des inquiétudes. On veut repousser la mort et la difficulté de vivre. L’être humain a des aspirations, mais il a aussi des inquiétudes, et nous espérons que la recherche nous donnera les moyens de les éliminer. Enfin, la troisième catégorie est d’ordre plus fondamental: notre soif de comprendre l’univers. C’est par exemple ce qu’accomplit la recherche fondamentale en astrophysique ou en mathématique. Ce désir de comprendre est selon moi le socle fondamental de la recherche: comprendre le monde est une quête sans fin et nous permet de donner un sens à notre expérience du monde.
Bien entendu, ces trois niveaux de savoirs sont liés entre eux. La plupart des chercheurs apportent leur contribution aux trois de petites et grandes manières. Mais il y a actuellement une tendance mondiale vers le financement de la recherche qu’on dit «orientée», soit la recherche devant mener rapidement à des applications concrètes. Cette orientation se fait souvent au détriment de la recherche exploratoire non orientée. Les applications concrètes répondent souvent à nos aspirations ou à nos inquiétudes, mais mettent moins l’accent sur la compréhension en soi. Cela m’inquiète car c’est dans cette dernière catégorie qu’on trouvera le plus de travaux qui nous aident à comprendre le monde. Cette recherche donne de l’envergure à notre existence. Pourquoi y a-t-il sept jours dans une semaine? À quoi sert la crête du coq? Voilà des questions dont les réponses éclairent ma journée. Ironiquement, l’histoire de la science nous montre que c’est souvent la recherche purement exploratoire et non orientée qui mène aux plus grandes avancées et applications. Pour vraiment répondre à nos aspirations et à nos inquiétudes, nous devons aussi investir dans la compréhension… Et dans la patience.
Pourquoi communiquer la science?
La recherche existe pour être partagée. Un résultat de recherche qui n’est pas partagé est une aberration. Jadis, c’était une élite qui occupait le champ scientifique et elle considérait peu utile de rendre compte de ses activités à l’ensemble de la population, ses recherches étant financées exclusivement par les riches et les puissants et les moyens de communication rares et souvent inaccessibles au commun des mortels. Aujourd’hui, les choses ont changé: la recherche est rendue possible par les fonds publics et il y a de multiples tribunes pour faire connaître ses résultats: tout le monde a droit à une information actualisée. La communication de la science doit se faire à plusieurs niveaux, d’ailleurs. Oui à l’échange d’information entre spécialistes dans des revues spécialisées et dans des conférences sur invitation, ces démarches étant cruciales. Mais la population mérite d’être renseignée sur l’évolution des connaissances, dont elle paie en grande partie les frais. Les chercheurs ont une responsabilité à ce chapitre.
Êtes-vous optimiste ou pessimiste?
Très optimiste. Je suis encouragé par le fait que la science s’est démocratisée partout dans le monde et de façon encore plus prononcée au Québec. Les chercheurs proviennent maintenant de milieux socioéconomiques beaucoup plus variés, ce qui génère une multitude de points de vue et d’intérêts sur le monde. Depuis les années 1950 – et c’est une des plus belles retombées de la Révolution tranquille – la recherche s’est développée dans tous les secteurs au Québec et est devenue accessible à tous les Québécois, sans distinction, notamment, de sexe.
D’ailleurs, il n’y a pas seulement plus de femmes en recherche, mais la recherche elle-même se préoccupe davantage du fait féminin, ce qui rend la présence des femmes en laboratoire d’autant plus précieuse. Un article sur la santé buccale et les maladies cardiovasculaires rapporte que les recherches se faisaient traditionnellement uniquement sur des modèles masculins, ce qui nous empêchait de comprendre la totalité du phénomène. Quelqu’un a fait remarquer qu’on excluait ainsi involontairement la moitié des individus de l’espèce. Avec plus de femmes en sciences, ce sont des choses qu’on verra moins souvent: pour mieux comprendre l’univers, nous avons besoin de tous les points de vue et l’apport des femmes à la recherche est remarquable. Il faut s’en réjouir, car nous ne reviendrons plus en arrière.
![]()
Remerciements
Ce livre n’aurait pu voir le jour sans l’appui des Presses de l’Université de Montréal. Son directeur, Antoine Del Busso, et son éditrice, Nadine Tremblay, ont d’entrée de jeu manifesté un grand enthousiasme à l’idée de rendre accessible à un plus large public ces réponses d’experts à des questions parfois simples, parfois compliquées, mais toujours pertinentes. Cette collaboration entre l’équipe du journal Forum et les PUM n’est ni la première ni la dernière assurément: l’un et l’autre pratiquent le métier de vulgariser les connaissances.
Merci aux principaux rédacteurs des textes, Dominique Nancy – à qui revient l’idée de ces capsules – et Mathieu-Robert Sauvé. Mme Nancy et M. Sauvé ont par ailleurs convenu de verser le montant de leurs droits d’auteur au Fonds des bourses de la réussite de l’Université. Un autre membre de l’équipe, Benoît Gougeon, signe les savoureuses illustrations de l’ouvrage.
Paule des Rivières
Directrice des publications
Bureau des communications et des relations publiques
Université de Montréal
![]()
Les auteurs
Daniel Baril a été rédacteur du journal Forum pendant 22 ans après avoir travaillé à la Direction des communications. Il a aussi été rédacteur en chef de la revue Les diplômés de 2001 à 2013. Présentement retraité, il poursuit ses activités de rédaction à titre de blogueur.
Il est l’auteur de: Les nouvelles générations sont-elles plus intelligentes?; Un poulain issu du croisement cheval-orignal est-il pensable?; Comment la luciole produit-elle sa lumière?; D’où vient l’interdiction de manger du porc?
Marie-Claude Bourdon est rédactrice en chef d’Actualités UQAM et INTER, magazines institutionnels de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), et a été journaliste à la pige pendant de nombreuses années pour diverses publications, dont Forum.
Elle est l’auteure de: Le compostage réduit-il les gaz à effet de serre?; La vitamine C prévient-elle le rhume?; Le blanchiment des dents: sans danger?
Marie Lambert-Chan est journaliste indépendante, titulaire d’un baccalauréat en communication de l’UQAM. Elle a été vidéaste et rédactrice à l’Université de Montréal de 2007 à 2013. Elle est à l’origine des capsules vidéo Forum en clips.
Elle est l’auteure de: À qui profite le commerce équitable?
Martin LaSalle mène une carrière dans le domaine des communications et du journalisme scientifique depuis près de 25 ans et il fait partie de l’équipe du journal Forum depuis 2013. Parmi les médias d’actualités pour lesquels il a écrit, mentionnons PasseportSanté.net de 2004 à 2011.
Il est l’auteur de: Nos régimes de retraite sont-ils viables?
Dominique Nancy écrit pour l’hebdomadaire Forum depuis 1999. Elle a proposé au journal l’idée des capsules science et ses articles ont obtenu des prix d’excellence du Conseil canadien pour l’avancement de l’éducation dont la médaille d’or dans la catégorie «meilleur article de langue français» en 2009.
Elle est l’auteure de: À quoi sert la musique?; Les dispositions pour la musique sont-elles innées ou acquises?; Pourquoi bâille-t-on?; À quoi sert la crête du coq?; Pourquoi le homard rougit-il en cuisant?; Un insecte a-t-il intérêt à avoir une progéniture mâle ou femelle?; Pourquoi l’arc-en-ciel forme-t-il un demi-cercle?; Que se passerait-il si la Lune disparaissait?; D’où vient le goût pour le sucre?; Les boissons énergisantes sont-elles bénéfiques?; L’anorexie touche-t-elle aussi les hommes?; Les étudiants ont-ils tendance à surconsommer?; Les automobilistes du Québec en ont-ils pour leur argent?; Peut-on se fier aux sondages?; Doit-on craindre les tests prénataux?; Faut-il abandonner les lettres attachées?; Peut-on mener des études universitaires en ligne?; La musique aide-t-elle à développer le langage?; Pourquoi les Québécois s’opposent-ils tant aux gaz de schiste?; L’ordinateur peut-il être responsable de troubles de la vue?; La gingivite provoque-t-elle des maladies cardiovasculaires?; La cigarette menace-t-elle la vue?; Qu’est-ce qui cause le mal des transports?; L’amour peut-il rendre fou?; Les femmes sont-elles plus sensibles au stress que les hommes?; Qu’est-ce que l’amour?
Antoine Robitaille est éditorialiste et responsable des débats d’idées au quotidien Le Devoir. Il scrute les mots et expressions qui sortent de la bouche des acteurs de la classe politique. Il a aussi la responsabilité du Devoir de philo, une série de textes inspirés des idées des grands philosophes.
Il est l’auteur de: Notre cerveau est-il vraiment sous-utilisé?
Mathieu-Robert Sauvé est reporter au journal Forum. Actuel rédacteur en chef du magazine Les diplômés, il a été président de l’Association des communicateurs scientifiques de 2008 à 2012, pour laquelle il écrit toujours. Il est aussi un auteur d’essais et de biographies.
Il est l’auteur de: Le rire est-il propre aux humains?; Y-a-t-il des cougars au Québec?; Faut-il craindre les tremblements de terre?; Le réchauffement climatique modifie-t-il les couleurs de l’automne?; Y a-t-il des castors au lac aux Castors?; Comment se forment les flocons de neige?; Vouloir très bien manger: une nouvelle maladie?; L’obésité entraîne-t-elle une diminution de l’espérance de vie?; Les boissons énergisantes sont-elles bénéfiques?; Le beurre artificiel dans le maïs est-il dangereux?; Pourquoi le maïs éclate-t-il?; Faut-il retirer le permis de conduire aux personnes âgées?; Les automobilistes du Québec en ont-ils pour leur argent?; Pourquoi y-a-t-il sept notes dans la gamme?; Pourquoi y-a-t-il sept jours dans une semaine?; Les immigrants français s’intègrent-ils bien à la société québécoise?; Un seul mot peut-il révéler une personne?; Peut-on calculer «pi» à coups de fusil?; Faut-il réintroduire la dissection en médecine?; Peut-on «survivre» à dix jours sans réseaux sociaux?; Pourquoi y-a-t-il plus d’allergies?; Y-a-t-il plus de maladies d’origine animale?; Gaz d’échappement: l’éthanol est-il la solution?; Le coup de foudre ne serait-il qu’une affair...