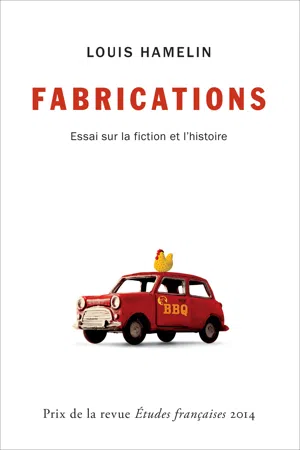![]()
L’Italie (1)
Depuis longtemps, affirmer que le roman et l’idéologie font mauvais ménage relève du lieu commun le plus banal. La précaution d’ajouter l’adjectif officielle à idéologie devrait s’imposer, ne serait-ce que pour nous rappeler que, loin de ses manifestations les plus extrêmes et les plus étriquées, l’idéologie est aussi ce milieu mental dans lequel, comme société, groupe, individu, nous baignons sans même, à de rares exceptions près, en être conscients. Cela dit, il faudrait aussi, seconde précaution, distinguer l’idéologie, entendue dans son sens le plus étroit, de la pensée politique, la première ne donnant le plus souvent qu’une pauvre idée de la forme fossilisée que peut prendre la seconde.
Un romancier peut se permettre d’avoir une pensée politique, non de suivre une idéologie reconnue, le plein accord avec cette dernière, ciment dans les fissures du doute, étant la voie la plus sûre pour tuer son ouvrage. S’il ne peut se défendre d’entretenir, fût-ce inconsciemment, une idéologie – soit le faisceau de valeurs à partir desquelles il écrit –, mettre sa prose au service d’une pensée officielle, d’une idéologie agréée, serait une déviation contre-nature, pour ne pas dire un crime contre l’esprit ironique de la prose romanesque. Et cette remarque s’appliquant à la situation du romancier généraliste devient, chez le romancier de l’histoire, l’exigence d’une extrême vigilance puisque, peu importe la forme qu’il lui donne, le jugement politique exercé sur le passé constitue une dimension à laquelle son travail ne saurait échapper.
En 1974, Elsa Morante, dont l’œuvre rare avait déjà été couronnée par les deux principaux prix littéraires italiens, fit paraître La storia, un gros roman populaire sur la traversée italienne du XXe siècle, et particulièrement de la Seconde Guerre mondiale. Le livre, à commencer par cette étiquette même de populaire que lui reprochait la critique, provoqua, dès sa parution, une controverse dans son pays. On y jugeait, d’une part, déplacée, poseuse et extravagante la prétention de la romancière à exiger et obtenir que son livre fût disponible, dès ses premiers tirages, dans une édition de poche vendue à un coût accessible. Mais la critique de gauche contestait aussi bien le caractère populaire du contenu de l’œuvre, faisant remarquer qu’aucun des personnages auxquels Morante avait prêté vie n’était un authentique prolétaire. C’est principalement le défaut idéologique de l’histoire selon Morante qui fit l’objet des critiques les plus féroces.
1974. Les années de plomb. À mi-chemin de la fondation des Brigades rouges (1970) et du redouté «compromis historique» par lequel le président de la Démocratie chrétienne et premier ministre de l’Italie, Aldo Moro, va presque réussir, deux mois avant sa mort, à faire entrer les communistes au gouvernement (1978). En attendant, la gauche prolétarienne et anti-impérialiste a le vent dans les voiles.
Quand j’ai lu La storia, je me souviens d’avoir ressenti, par moments, un certain agacement devant l’approche choisie par la romancière, qui donnait l’impression de vouloir situer sur un même plan, dans l’échelle de l’importance historique, les balbutiements langagiers inauguraux du petit Useppe, né du viol d’une Romaine par un soldat allemand ivre, et les funèbres prestiges de la participation des légions italiennes à l’invasion de l’URSS. À l’époque de ma lecture, n’ayant pas encore moi-même procréé, je me montrais peu sensible à cette magie des calembours et calembredaines enfantins. Celle d’un enfant dont la langue, mère de toutes les créations verbales, s’édifie à coups d’erreurs émouvantes et d’involontaires et comiques envolées poétiques. Le parti-pris de Morante, qui était d’incarner le point de vue, sur l’histoire dite universelle, des êtres les plus faibles, des immémoriales victimes innocentes des guerres de toujours, m’avait échappé, au point que je jugeais disproportionnées non seulement la place occupée par Useppe dans la trame narrative, mais aussi celle du chien-chien de la famille. Je marchais encore à plein dans l’hommerie de l’histoire.
Dans La storia se profile une sensibilité érigée en un large spectre idéologique qui, de féminine à féministe, déferle au même moment sur tout un pan de la littérature occidentale. Morante choisit d’investir cette sensibilité dans la structure convenue du gros roman à succès, plutôt que dans les aventures formelles plus ou moins lisibles d’une avant-garde dûment identifiée.
Considéré du strict point de vue de l’idéologie, le roman d’Elsa Morante était plus proche du monde que des idées. Il heurtait de front l’idéologie dominante d’une grande partie de la littérature et de la critique italiennes de ces années de plomb, plus proche de l’extrême gauche, ou d’un mythique eurocommunisme en forme de troisième voie, que d’une droite adossée à son repoussoir fasciste.
Le roman, qui provoqua la rupture de l’auteure avec Pasolini, un compagnon de route, dérangeait avec son idéologie imprécise dont l’impardonnable péché était sans doute de ne pas être immédiatement réductible à une ligne de parti, à un kit de pensée convertible en action, voire à une posture pacifiste récupérable par un camp, plutôt qu’à une position morale, générale, totale sur la guerre, voisine de celle qu’exprimait le Bardamu de Céline dans Voyage au bout de la nuit: «Je ne veux plus mourir.»
![]()
L’Italie (2)
Il s’agit de formes de complicité
entre nous et les pouvoirs qui nous empêchent,
les pouvoirs et nous, de dire ce
qui s’est vraiment passé.
Alberto Franceschini
Brigades rouges: l’histoire secrète des BR
racontée par leur fondateur
Par une étrange facétie de l’histoire,
il semble que les ennemis d’hier –
les brigadistes et l’État –
aient réussi à trouver un moyen
pour coexister, mais seulement à travers
leurs silences réciproques.
Giovanni Fasanella
Brigades rouges: l’histoire secrète des BR
racontée par leur fondateur
Au mitan des années 1970, le noyau historique des Brigades rouges est décimé: Alberto Franceschini et Renato Curcio sont arrêtés en 1974, Mara Cagol tombe l’année suivante. La génération de brigadistes qui leur succède, dominée par Mario Moretti, afin de frapper les institutions politiques à la tête du pays, haussera la violence anti-étatique à un niveau supérieur, inaugurant les années de plomb.
Le 16 mars 1978, un commando d’une dizaine de brigadistes intercepte le convoi formé par la voiture du premier ministre démocrate-chrétien, Aldo Moro, et son escorte, en route pour le parlement, et mitraille mortellement ses cinq gardes du corps avant d’emmener le chef de l’exécutif en captivité. Moro n’aura pas la chance du juge Sossi, relâché par Franceschini quatre ans plus tôt, au moment où l’étau se resserrait autour de sa «prison du peuple». Il est retrouvé criblé de balles 55 jours après sa capture, dans le coffre d’une voiture abandonnée en plein centre de Rome.
«Si tu veux comprendre la crise d’Octobre, intéresse-toi à l’affaire Moro», m’avait conseillé Jacques Cossette-Trudel au cours d’une de nos conversations téléphoniques. Et c’est ce que j’ai fait.
Au-delà de la simple coïncidence que représente le fait d’avoir tous les deux été retrouvés morts dans le coffre d’une voiture, par-delà, aussi, une évidente différence d’échelle – les brigadistes et leurs complices, sympathisants actifs et membres des réseaux de soutien, ont totalisé, à l’apogée des années de plomb, une couple de milliers d’individus, contre, au plus fort de la crise d’Octobre, largement moins d’une centaine pour le FLQ –, les ressemblances les plus frappantes, entre les affaires Moro et Laporte, relèvent de la gestion de la situation politique par l’appareil militaro-policier et la classe dirigeante.
La désolante inefficacité des policiers romains pendant la séquestration, en plein centre-ville de Rome, d’Aldo Moro a été soulignée par de nombreux observateurs. L’histoire des Brigades rouges est pleine de péripéties révélant la négligence, la nonchalance, voire l’apparente étourderie du pouvoir et de ses bras armés.
Au Québec, un Cossette-Trudel reconnaît que ses amis et lui, alors même qu’ils épiaient les allées et venues de leur futur otage, se sentaient eux-mêmes «surveillés». Alberto Franceschini, lui, avait l’impression que les BR était protégées. Pour une raison fort simple à ses yeux: «On nous a combattus quand c’était utile de nous combattre, on nous a laissé faire quand c’était utile de nous laisser nous développer.»
On croit voir se profiler, derrière les relations de ces États avec leurs mouvements terroristes – Rome et Brigades rouges, Québec et FLQ –, un même mécanisme: l’instrumentalisation de la violence terroriste à des fins de consolidation du pouvoir. La logique répressive trouve, dans la subversion armée, une justification si totale qu’il est permis de se demander (comme, en son temps, le docteur Ferron dans ses fameuses lettres ouvertes au Devoir) si de subtils encouragements secrètement prodigués à ces forces d’opposition clandestines, résultant en la transformation d’un ennemi mortel en allié objectif, ne pourrait pas s’inscrire dans le cadre plus large d’une stratégie de renforcement de la légitimité des gouvernements. La violence devenant alors ce carburant destiné à alimenter le plus puissant moteur de tout pouvoir politique, qui est la raison d’État.
Franceschini: «Nous sommes partis à la conquête d’un nouveau monde, sans nous rendre compte qu’en réalité nous contribuions à consolider le vieux.»
«Stratégie», ai-je écrit. Pourtant, je n’irai pas jusqu’à imaginer quelque sphinx ruminant, du haut de sa tour d’ivoire, la manière de conduire à leur perte des masses humaines hostiles au règne du Prince. Cet individu existe sans doute. Mais le truc auquel je pense est en quelque sorte plus fondamental et plus ancien, il fait partie de l’arsenal des forces de l’ordre depuis toujours. Sa forme la plus simple s’incarne dans l’agent provocateur. Tactique un tantinet plus sophistiquée, la provocation par abstention: laisser le champ libre à des criminels dont les projets funestes sont connus des autorités.
Ultimement, on en arrive à ce constat: la meilleure forme de prévention de la violence politique, pour l’État et ses bras armés, consiste à la commettre soi-même.
Un autre trait commun aux deux affaires – Moro et Laporte – consiste en ceci: un otage dont le décès éventuel représente la mort assurée du mouvement qui a commis et revendiqué son enlèvement.
Par «mort d’un mouvement», je ne veux pas dire l’état des forces sur le terrain. Le FLQ a survécu un peu plus d’un an au décès de son otage; des surgeons des Brigades rouges étaient encore actifs en Italie plus de vingt ans après l’exécution du premier ministre Moro par le mystérieux Mario Moretti.
«Mort d’un mouvement» veut dire: mort d’un esprit, de l’âme d’un combat. Ça n’a rien à voir avec l’emprisonnement des individus, leur repentir, ou son absence. Le FLQ est mort avec Laporte; les BR, en condamnant Moro, présidèrent à leur propre liquidation historique.
«J’ai instrumentalisé les Brigades rouges pour tuer Moro», se vante, dans un documentaire réalisé par Emmanuel Amara, Steve Pieczenik, un monsieur qui de toute évidence ne se prend pas pour un pied de céleri, psychiatre à l’emploi du département d’État américain, prêté, en 1978, à la cellule de crise du gouvernement italien à titre de spécialiste des prises d’otages pour aider à gérer l’affaire Moro. Résultat? «Nous avons dû sacrifier Moro pour maintenir la stabilité de l’État italien.»
Dans le livre tiré de ses entretiens avec Amara, Nous avons tué Aldo Moro (2006), Pieczenik ajoutait: «On peut dire que c’est un coup brutal que nous avons monté de sang-froid. […] Le piège était qu’ils devaient le tuer. […] [Les Brigades rouges] ont été manipulées jusqu’à devenir les maîtres d’œuvre de leur propre destruction.»
Il n’est pas mauvais de replacer un tel événement dans le contexte mondial auquel il appartient, en l’occurrence la guerre froide et les préoccupations méditerranéennes de l’OTAN. Pour les Américains et leurs alliés dans la droite italienne, sacrifier Moro, c’était faire d’une pierre trois coups: le terrorisme d’extrême gauche se déconsidérait par un lâche assassinat, l’architecte du compromis historique (sur l’entrée des communistes au gouvernement, soit Moro lui-même) disparaissait de l’échiquier politique, et l’Italie demeurait ce pays apparemment ingouvernable, dirigé en sous-main par la mafia, l’extrême droite et les loges maçonniques.
Sans compter cette chose précieuse entre toutes dans la vie d’une nation: un martyr. Un bouc émissaire au sens biblique du terme, sacrifié à une cause supérieure (l’anti-communisme, la democracy canadienne) qui peut n’être qu’un simple prétexte, l’important étant de refaire un instant, sur la tombe du trépassé, et ne serait-ce que symboliquement, l’unité perdue.
![]()
Le principe de Franceschini
Des similitudes, donc, Cossette-Trudel avait raison. Mais aussi, une énorme différence: car les silences auxquels il est fait allusion dans le second épigraphe du précédent chapitre sont très relatifs. En réalité, les principales figures des Brigades rouges, Franceschini, Moretti, Curcio et quelques autres, ont, depuis, parlé. Raconté. Témoigné. Se sont confiés à des journalistes, ont trouvé des auteurs, des coauteurs, fait paraître des livres. La confrontation des récits et des interprétations rivales a remplacé les dissensions idéologiques de jadis.
Comparer ce sain processus de catharsis postrévolutionnaire avec l’entêté mutisme des protagonistes de la crise d’Octobre est un peu déprimant. Le constat s’impose: l’envergure intellectuelle des brigadistes et des felquistes n’est tout simplement pas comparable.
Lorsque Paul Rose annonçait, sempiternellement, sous la forme d’un écho dans le journal, l’achèvement prochain de la série télé racontant l’histoire politiquement engagée de sa famille, il avait soin de préciser qu’il n’y serait pas question de la crise d’Octobre, comme s’il était possible d’évacuer cette dernière de sa vie de militant. Son frère Jacques fait de la raquette dans le bois et, pour ce qu’on en sait, il ne parle qu’aux épinettes. Jacques Lanctôt voulait bien écrire sur son exil cubain, mais pas sur les enlèvements. Yves Langlois, alias Pierre Séguin, doté par Marc Laurendeau (Les Québécois violents, 1990) d’une «pensée extrêmement articulée», bizarrement, n’a pas pondu une ligne en quarante ans. Quant à Pour en finir avec Octobre, l’ouvrage impressionniste de Francis Simard, il a d’abord été contresigné par les trois ex-complices de l’auteur, lesquels, au moment de la réédition, lui ont retiré leur imprimatur.
Tout ça fait un peu pitié.
Si la vérité historique était une marchandise, j’aurais tendance à préférer le bazar animé et bruyant des Brigades rouges au grenier poussiéreux, encombré de cossins du FLQ.
Loin de moi la prétention de réduire la complexité de la scène politique italienne des années de plomb à une rassurante simplicité schématique, mais je crois pouvoir affirmer que, dans la masse écrite touffue formée par les tentatives d’interprétation et de compréhension des événements liés à la montée en puissance des Brigades rouges, il est possible de distinguer deux versions principales: celle d’Alberto Franceschini, et celle de Mario Moretti, passé à l’histoire sous les traits du bourreau d’Aldo Moro.
Mon intention n’est pas de décrire dans le détail ces deux grands récits antagonistes. Qu’il suffise de savoir que Franceschini, le fondateur historique, condamné à suivre l’affaire Moro de sa cellule de prison, décrira ensuite les nouvelles BR nées de la prise de contrôle de Moretti comme un groupe révolutionnaire infiltré par des éléments politiquement douteux (dont fait partie Moretti), et manipulé par des forces extérieures, sinon même téléguidé de l’étranger dans un dessein occulte (dont fait partie la mort d’Aldo Moro).
Dans Brigate rosse: une histoire italienne (2010), Moretti, tel Paul Rose affirmant: «La crise d’Octobre est québécoise de la tuque aux mitaines», défend tant l’intégrité idéologique des Brigades que le caractère national de l’organisation qui, sous sa gouverne, va connaître une paramilitarisation croissante dans la deuxième moitié des années 1970.
Qui a raison? Franceschini quand il pointe vers de mystérieux commanditaires parisiens situés tout au centre du grand jeu planétaire des services secrets? Ou Moretti quand il défend l’orthodoxie prolétarienne et meurtrière de ses Brigades rouges? Je ne vais pas, ici, tenter de démêler l’écheveau des points de vue dont la vérité historique, sinon sa possibilité même en tant qu’objet connaissable, ne peut que ressortir irrémédiablement embrouillée. C’est sur un tout autre plan que la confrontation de ces deux-là m’int...