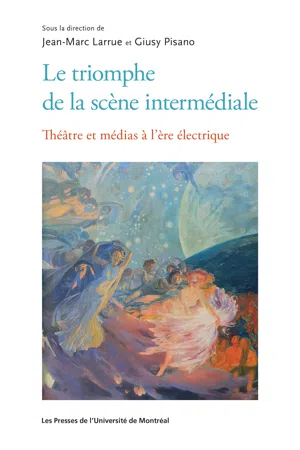![]()
PRÉSENCES SONORES
![]()
CHAPITRE 4
Naturalisme et musique:
fonctions des airs
et des références musicales
dans les adaptations théâtrales
de Zola à la fin du XIXe siècle
Geneviève De Viveiros
Bien que Zola n’ait été lui-même, selon ses dires, qu’un piètre musicien, suivant l’anecdote relatée par Paul Alexis dans Notes d’un ami – on sait qu’il a joué de la clarinette sans jamais trop maîtriser cet art –, son œuvre n’en reste pas moins chargée de connotations et d’associations musicales. Lui-même, dans une lettre écrite à Giacomo Giacosa en 1886, notera des ressemblances entre l’architecture de son œuvre et celle des musiciens: «Il est certain que je suis un poète et que mes œuvres sont bâties comme de grandes symphonies musicales». «Symphonique» est aussi l’épithète que les critiques, qui ont commenté Zola, tant au XIXe siècle qu’à notre époque, ont utilisée à maintes reprises pour qualifier son œuvre romanesque. On peut rappeler la fameuse scène de la «symphonie des fromages» dans Le ventre de Paris et la «symphonie des fleurs» dans La faute de l’abbé Mouret. Zola, dans ses nombreux feuilletons de critiques théâtrales, commente également assez abondamment les types de spectacles qui font une grande place à la musique à la mode de son époque, comme la féerie, l’opéra-bouffe, le vaudeville, ainsi que l’a remarqué récemment Olivier Sauvage. Enfin, sa rencontre avec le compositeur Alfred Bruneau en 1888 va marquer un point tournant dans sa carrière d’écrivain, puisque Zola va alors décider de s’interroger véritablement sur la place de la musique dans les arts du XIXe siècle. Après avoir voulu rénover, suivant ses théories naturalistes, la scène théâtrale, Zola va s’attaquer à des genres connexes mais pourtant très différents du théâtre: l’opéra et le drame lyrique.
Le romancier va mettre en scène, en collaboration avec Alfred Bruneau, des drames lyriques inspirés de ses œuvres romanesques ou provenant de livrets originaux comme Le rêve (1891), L’attaque du moulin (1893), Messidor (1897) ou encore L’ouragan (1901). Or, ces œuvres ne sont pas les seules adaptées de ses romans qui ont bénéficié d’un support musical pour rendre vivant sur scène le destin des personnages des Rougon-Macquart. Sauf pour la collaboration entre Zola et Bruneau, les relations entre la musique et le naturalisme théâtral ont été très peu étudiées, voire pratiquement ignorées, par la critique universitaire. Il faut dire que l’édition des pièces adaptées des Rougon-Macquart par l’un des collaborateurs de Zola, William Busnach, et rassemblées par lui, contient peu de didascalies ou d’indications concernant la musique jouée pendant la représentation de ces pièces, tandis que les autres pièces créées par d’autres adaptateurs n’ont, pour la plupart, pas même été publiées.
Notre propos se donne ainsi comme objectif d’éclairer la place de la musique dans le théâtre naturaliste. En faisant référence aux archives du fonds des relevés de mises en scène de l’Association de la Régie théâtrale (ART) de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, il s’agira d’étudier les diverses fonctions des références et des sources musicales présentes dans quelques-unes des adaptations théâtrales tirées des romans de Zola, montées à la fin du XIXe siècle. Nous nous concentrerons sur trois des adaptations théâtrales qui figurent dans le fonds de l’ART, soient L’assommoir, Nana et Pot-Bouille, représentées pour la première fois à Paris entre 1879 et 1883.
Musique et théâtre au XIXe siècle
Quoique souvent absente des didascalies dans les textes de théâtre publiés au XIXe siècle, la musique fait pourtant partie intégrante des spectacles de toute cette période. L’utilisation du son et de mélodies diverses sur les tréteaux dépasse largement la mise en scène de genres théâtraux associés à la musique comme le vaudeville, les cafés-concerts, l’opéra ou le drame lyrique. Les théâtres de la capitale française ont tous un orchestre et l’on constate dès le début du siècle une plus grande variété d’instruments utilisés et un enrichissement du répertoire. Les orchestres des théâtres de boulevard «comprenaient au minimum violons, alto, basse, flûte, clarinettes, basson, corset timbales». Les partitions retrouvées pour les textes de théâtre du XIXe siècle sont, pour la plupart, à l’état de manuscrits et ne sont généralement pas incluses à l’origine dans les publications officielles des pièces. La présence d’annotations musicales constitue donc un champ d’investigation pour les chercheurs qui reste encore à explorer. Il est, de fait, très peu fait mention, dans le domaine de la recherche sur le théâtre du XIXe siècle, de la part qu’a jouée la musique dans les spectacles au cours de cette époque. Il semble qu’un certain préjugé relevant de la classification du savoir et de la hiérarchie des genres littéraires soit à l’origine de cette lacune documentaire dans les recherches historiques sur le théâtre. En effet, jusqu’à tout récemment, tout élément de l’aspect matériel de la représentation théâtrale, jugé secondaire au texte, intéressait peu les chercheurs. La musique, considérée comme un art à part entière, n’a pas, de ce fait, été examinée comme un élément participant à la symbolique du texte. Les archives du fonds de l’ART nous permettent de réévaluer cette assertion et ces présupposés idéologiques. Le très grand nombre de partitions figurant dans ce fonds viennent plutôt corroborer l’hypothèse que la musique occupait une part éminente de la représentation théâtrale au XIXe siècle, et les liens entre texte et musique sont alors, bien plus souvent qu’autrement, intrinsèques et se situent dans une relation d’interdépendance, car, comme l’ont indiqué Jean-Marc Larrue et Marie-Madeleine Mervant-Roux, «si le théâtre est le lieu où l’on voit, il a toujours été aussi – et tout autant – le lieu où l’on entend».
Le XIXe siècle, de plus, connaît la naissance d’une culture de masse fondée sur l’apparition de nouvelles formes culturelles imposées par le développement de l’imprimé, mais cette importance nouvelle que prend alors l’écrit n’entraîne aucunement l’appauvrissement des modes d’expression de la culture orale et sonore. La scène, en tant que lieu de rencontre, reste alors l’espace où s’exposent, simultanément et en parallèle, la parole écrite et la parole vive. Comme l’ont expliqué Élisabeth Pillet et Marie-Ève Thérenty, «le public des villes en plein développement, s’il est grand lecteur de journaux, est aussi demandeur de chansons, de poèmes, de saynètes, de récits comiques ou sérieux, prenant vie par le corps et la voix d’interprètes dans un moment d’émotion partagée; cela dans des lieux de réunion où se développent sociabilité et convivialité». La musique, alors ancrée dans des traditions classiques et folkloriques, participe dans des lieux de représentation comme le théâtre à l’expérience du spectacle tout en étant un agent de circulation et de dissémination culturel.
La musique dans les pièces de Zola
Dans le cas des pièces de Zola, plusieurs partitions musicales et des indications sonores, pour la plupart non répertoriées dans les éditions publiées de ces pièces, figurent dans les dossiers de mise en scène du fonds de l’ART. La nature et la fonction de ces partitions et de ces notes d’effets sonores sont assez diverses: il s’agit, pour la majorité d’entre elles, de feuilles de musique représentant les scènes des pièces de Zola où il est question de moments spécifiques de l’intrigue, lorsque les personnages doivent interpréter un morceau ou faire directement référence à une œuvre musicale. Par exemple, dans l’adaptation théâtrale de Nana, la première scène de l’adaptation s’ouvre sur l’air de la Blonde Vénus, interprété par l’actrice qui joue le rôle de Nana – ce qui correspond d’ailleurs à l’action du premier chapitre du roman dont est tirée la pièce:
Lorsque Vénus rôde le soir, la belle blonde, la belle blonde
Tunique au vent, on croit la voir sortant de l’ombre.
Ces paroles sont inspirées du passage du roman où est décrite l’entrée en scène mémorable de Nana dans son rôle de la Blonde Vénus au théâtre des Variétés:
À ce moment, les nuées, au fond, s’écartèrent, et Vénus parut. Nana, très grande, très forte pour ses dix-huit ans, dans sa tunique blanche de déesse, ses longs cheveux blonds simplement dénoués sur les épaules, descendit vers la rampe avec un aplomb tranquille, en riant au public. Et elle entama son grand air: Lorsque Vénus rôde le soir…
Cet air de la Blonde Vénus, qui ne figure pas dans la version publiée de la pièce par Busnach, semble avoir été composé spécialement pour la mise en scène de l’adaptation théâtrale du roman. L’utilisation de la musique, dans ce cas-ci, correspond bien à l’application des idées esthétiques naturalistes de Zola: il s’agit de représenter dans un «décor exact», de reproduire avec le plus de précision possible l’environnement des pers...