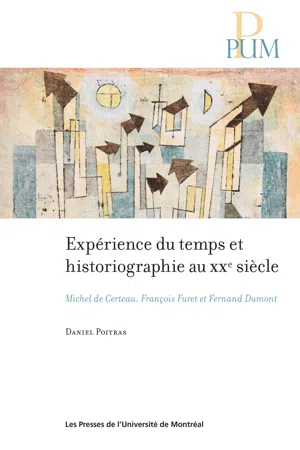![]()
1. L’Histoire entre croyance
et rédemption (1925-1955)
Cherchant à comprendre l’entre-deux-guerres, Paul Valéry faisait l’hypothèse d’un dérèglement dans le temps pour expliquer ses dérives idéologiques: «Le passé, plus ou moins fantastique, ou plus ou moins organisé après coup, agit sur le futur avec une puissance comparable à celle du présent même.» C’est dans un tel contexte que Michel de Certeau, Fernand Dumont et François Furet, nés entre 1925 et 1927, ont grandi et ont manifesté leur première velléité d’engagement dans le monde et sur le plan intellectuel. Bien plus tard, pendant cette période des années 1980 et 1990 caractérisée par un régime d’historicité tout opposé à celui que décrivait Valéry, ils reviendront, parfois de mauvais gré, sur leur itinéraire.
Chez les historiens, malgré les essais plus ou moins fructueux d’ego-histoire, ces retours sur soi ont parfois une portée plus longue: ils servent d’aiguillons pour penser autrement l’histoire elle-même. L’un des thèmes privilégiés dans ce processus rétrospectif est souvent celui du déracinement. De fait, les trois auteurs ici à l’étude ont quitté un certain milieu pour un autre. Il s’agit ici non pas de faire de ce déracinement la source ultime de leur cheminement et de leur œuvre future, mais de poser un premier jalon, un «à partir de quoi» ils réfléchiront à leur parcours, à celui de leur société et à l’historiographie.
Parcours de jeunesse
L’information accessible sur la prime jeunesse des trois contemporains est en soi révélatrice de certains thèmes, héritages et hantises qui les habiteront tout au long de leur vie. Dans sa biographie de François Furet, Christophe Prochasson a pu constater la rareté des matériaux disponibles pour traiter de cette période. L’historien de la révolution, qui s’est confié parcimonieusement et souvent à contrecœur, avouait carrément: «Je n’ai pas le temps, ni d’ailleurs le goût d’écrire un essai de souvenirs personnels.» Michel de Certeau ne disait pas autrement, ce qui avait poussé son biographe François Dosse à reconstituer son parcours à l’aide des témoignages oraux de ceux qui l’avaient connu. Un instant tenté par le projet d’ego-histoire (1987) de Pierre Nora, Certeau avait finalement décliné: «cette scansion d’écueils et de solidarités», «ce n’est pas mon style». Il reconnaissait pourtant la valeur et l’utilité d’«articuler sur un travail historiographique les dettes qui l’ont soutenu et orienté». À quelques milliers de kilomètres de là, c’est justement cette hantise de la dette qui avait motivé Fernand Dumont à revenir sur son enfance et à rédiger, à la fin de sa vie, son autobiographie. Des trois auteurs, c’est le seul à avoir raconté de bon cœur sa propre histoire.
François Furet et l’adhésion au communisme
Né à Paris le 27 mars 1927, Furet vient d’un milieu bourgeois de gauche. Son père, Pierre, était directeur de banque et sa mère descendait d’une lignée de patriciens républicains. François sera d’ailleurs proche de son oncle Henri Monnet, politiquement engagé dans le Parti radical (socialiste), qui formera une coalition avec la SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière) et le Parti communiste pour créer le Front populaire en 1936. Un autre oncle de Furet, Georges Monnet, proche du leader du Parti radical, Léon Blum, avait été élu député socialiste lors des élections législatives de 1928, avant de devenir ministre de l’Agriculture dans le gouvernement du Front populaire. À cette époque où les fascismes s’expriment sans pudeur, l’antisémitisme virulent dont est victime Léon Blum marque le jeune Furet, qui reviendra souvent sur cette «passion idéologique»:
[La haine des juifs est] une passion qui m’est étrangère, et en même temps, comme à n’importe quel Français de ma génération, tout à fait familière. Je l’ai rencontrée dès l’enfance, dans ce lycée du XVIe arrondissement où le Front populaire divisait même les toutes petites classes à partir de l’élémentaire, entre prosémites et antisémites.
Après le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et pendant l’Occupation, Furet avait fréquenté un établissement à Paris, le très réputé lycée Janson-de-Sailly, où il était resté à l’écart de la politique. En 1944, il avait toutefois rejoint un maquis des Forces françaises de l’intérieur (FFI) dans le Cher, mais on en sait peu sur ses motivations durant cet épisode. On peut néanmoins supposer l’impact qu’ont sur lui le brassage social et l’intensification des échanges pendant la Résistance où républicains, socialistes, communistes et catholiques sociaux luttent côte à côte. Pour les communistes en particulier, de 1940 à 1947, l’emprise de l’URSS sur les PC nationaux s’était relâchée et une relative liberté avait subsisté pour les militants. La revue Action symbolisait cet esprit. «[Dans] cette zone de circulation des idées, nous pouvions parler. Nous discutions du passé, du présent et de l’avenir.» Cette mobilité convient davantage au caractère de Furet que l’insertion dans une institution étroitement régulée ou dans ce qu’il appellera plus tard «la “chambrée” virile, normalienne ou militaire, à laquelle je me sens particulièrement allergique». C’est peut-être cette dimension militaire qui avait poussé Furet, à la fin de la guerre, à quitter l’armée de libération qu’il venait tout juste d’intégrer, ce qui lui avait d’ailleurs attiré des ennuis. Risquant le conseil de guerre pour désertion, il l’avait échappé belle: un ami de la famille, Roger Grégoire, conseiller d’État, était intervenu à temps.
Une tragédie personnelle viendra s’ajouter à la tragédie collective lorsque Furet perdra sa mère, atteinte d’une tumeur au cerveau à l’âge de 42 ans. Ébranlé, son père ne s’en remettra pas et, après une tentative de suicide ratée, parviendra à ses fins en 1959. Christophe Prochasson a souligné l’importance de ces deux événements pour expliquer la mélancolie (politique) de Furet tout au long de sa vie. Celui-ci avouera quelques années avant sa mort: «J’ai perdu ma mère la dernière année de la guerre, ce qui a assombri mon adolescence.» Selon Ran Halévi, «ces épreuves lui ont infligé des blessures indélébiles. Elles ont déshérité ses souvenirs sans les éteindre. Elles l’ont destiné à vivre sans nostalgie pour les choses défuntes, à la fois isolé de son passé et hanté par ses injures.» Cette absence de nostalgie se vérifiera par la suite, Furet chassant sans vergogne les cultes de l’origine, les réminiscences embellies et les lieux de mémoire idéalisés de ses contemporains. Ce drame personnel, dans un contexte où la «France bourgeoise» est en pleine débandade, explique le puissant attrait exercé par le communisme sur lui.
Sur l’engagement communiste de Furet, on en sait très peu: «Nulle introspection rétrospective», contrairement à plusieurs de ses camarades qui ont fait une véritable cure de désintoxication à grand renfort d’aveux. On sait tout au moins que Furet a choisi d’officialiser son entrée dans le communisme à un drôle de moment, en 1949, alors que les horreurs du monde soviétique commençaient à percer en Occident à la suite du procès Rajk. Homme politique hongrois, László Rajk avait été l’une des premières victimes des procès d’épuration, grandement médiatisés à l’ouest, de Staline. Dans ces procès kafkaïens, les accusés admettaient des crimes inventés de toutes pièces pour le bien de la cause communiste. Furet avait déjà lu Le zéro et l’infini d’Arthur Koestler (1941), traduit en français en 1945, dans lequel l’auteur dénonçait le système totalitaire soviétique.
Les témoignages ne manquent pas sur les mécanismes de l’engagement communiste pendant cette période trouble. Le recours à un lexique religieux est particulièrement frappant chez les anciens pour raconter leur expérience. Revenant sur son épisode communiste, Emmanuel Le Roy Ladurie parlera d’une conversion du «puritanisme janséniste» de son milieu familial traditionnel substituant le mysticisme politique au mysticisme religieux. Annie Kriegel, qui s’était chargée de l’exécution politique du camarade renégat Edgar Morin et qui deviendra l’amie de Furet, décrira le PC comme une Église. Furet ne sera pas en reste: au fil de ses combats historiographiques et mondains, il forgera, à l’aide d’un lexique puisant dans l’expérience de l’endoctrinement, quelques-unes de ses métaphores les plus spectaculaires afin d’en découdre avec les croyances idéologiques. L’article «Le catéchisme révolutionnaire», publié en 1971, est un modèle en ce genre. On peut sans doute appliquer à Furet ce que disait Edgar Morin, dont le témoignage est particulièrement pénétrant, sur la posture critique que plusieurs anciens communistes développeront par la suite:
[N]otre critique politique fut extraordinairement tardive. Faiblesse énorme, incroyable, mais peut-être fonda-t-elle notre force. Car notre critique fut finalement plus radicale que toute critique politique. Elle partit d’épiphénomènes, mais peu à peu elle gagna l’être tout entier, notre être tout entier et l’être du stalinisme tout entier, et le marxisme lui-même tout entier. Ceux qui en eurent la force, la patience et la lucidité en arrivèrent au point de départ du jeune Marx: une mise en question radicale de l’idéologie.
Furet le dira lui-même: ...