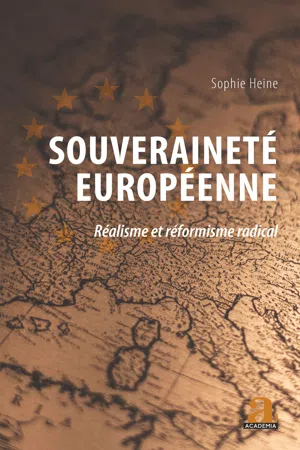
- 168 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Souveraineté européenne. Réalisme et réformisme radical est un essai original qui passionnera tous ceux qui se soucient de l'avenir de l'Union européenne. Il s'adresse aux partisans du projet européen tout comme à ceux qui pensent que sa rénovation en profondeur est indispensable. Mêlant analyse critique, théorie politique, dialogues et propositions stratégiques concrètes, il s'agit d'une contribution substantielle aux débats et actions visant à influer positivement sur le futur de l'Union européenne.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Souveraineté européenne par Sophie Heine en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politics & International Relations et European Politics. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Chapitre Trois
Une souveraineté
européenne pour recréer
de l’agir politique
L’européanisation partielle d’un nombre croissant de politiques a petit à petit miné les souverainetés nationales sans qu’une souveraineté supranationale n’ait été mise en place pour compenser cette perte. Plus précisément, le partage de souveraineté encouragé par l’intégration européenne dans plusieurs politiques publiques essentielles a progressivement conduit à un affaiblissement dramatique de cette dernière. Et pourtant, sans un pouvoir souverain effectif, les gouvernements ne peuvent tout simplement pas répondre aux besoins et préférences de leurs citoyens. La demande croissante de la part des populations en faveur d’une souveraineté forte découle donc en partie d’une réalité objective : la réduction drastique des pouvoirs souverains nationaux.
Je commence ce chapitre en explorant les différentes définitions possibles de la souveraineté. Loin des approches les plus fréquentes, celle que je propose se veut beaucoup plus exigeante. Je montrerai ensuite dans quelle mesure les souverainetés nationales ont été érodées par l’européanisation partielle ayant affecté un nombre croissant de domaines. Dans la dernière partie de ce chapitre, je défendrai l’idée d’une réhabilitation européenne de la souveraineté.
LA SOUVERAINETÉ EXISTE-T-ELLE ENCORE ?
Avant d’expliquer dans quelle mesure la souveraineté a perdu de son effectivité, je voudrais clarifier ce que j’entends par ce concept crucial. Dans les débats académiques, intellectuels et politiques sur ce sujet, des définitions très diverses s’opposent, qui mènent à des conclusions pratiques très différentes. En d’autres termes : l’acception donnée à ce terme influence la réponse apportée à la question de savoir s’il existe encore aujourd’hui des pouvoirs souverains.
Ainsi, bon nombre de ceux qui estiment que la souveraineté des États subsiste font une interprétation essentiellement formelle, juridique et discursive de ce concept. Par exemple, la plupart des experts en droit de l’Union européenne estiment que celle-ci ne limite pas la souveraineté nationale. Pour justifier cet argument, ils s’appuient sur les jugements de certaines Cours constitutionnelles, telles que les cours suprêmes allemandes et françaises.
Selon cette analyse, les limites que pose le droit européen à l’exercice de la souveraineté ne suppriment pas l’essence de cette dernière, à partir du moment où ce sont les États qui décident de signer et d’appliquer des accords internationaux ou de les rompre. Cette capacité constitue, selon eux, un trait essentiel de leur souveraineté. Il s’agit ici d’une extrapolation d’un argument fréquent en droit international, selon lequel les États demeurent souverains dans leurs relations internationales : d’une part, les traités internationaux tels que les conventions des Nations Unies ne stipulent jamais l’extinction de la souveraineté nationale ; d’autre part, les États non seulement choisissent librement de signer ces traités, mais ils sont en outre toujours libres d’en sortir31.
En adhérant à certains traités, les États consentiraient seulement à limiter l’exercice de leurs pouvoirs souverains, tandis que leurs pouvoirs souverains en tant que tels demeureraient intacts. Ces derniers ne seraient pas transférés et pourraient toujours être utilisés32. Par ailleurs, même si l’exercice des pouvoirs et compétences est « partagé » et « divisé » entre les États et l’Union européenne, la souveraineté elle-même ne l’est pas. Dans cette approche formelle et juridique, « la souveraineté, au sens de l’autorité de l’État, ne constitue pas l’exercice des compétences mais le pouvoir de les exercer si l’État le souhaite. Dès lors, même quand cet exercice est délégué par l’État, ce pouvoir ne disparaît pas ». En d’autres termes, « l’État peut déléguer l’exercice de certains pouvoirs mais, étant donné qu’il peut toujours mettre fin à cette délégation, il conservera toujours l’essence de ce pouvoir »33.
Dans cette perspective, le fait que les États ont l’obligation de transférer les directives européennes en droit national ne contredit pas radicalement leur souveraineté : tout d’abord, les États ont toujours la possibilité de ne pas respecter les accords internationaux auxquels ils ont souscrit s’ils acceptent de subir des sanctions ; ensuite, le droit international a souvent été intégré pour partie dans de nombreuses constitutions nationales et, par conséquent, le respect de ces normes internationales deviendrait une obligation constitutionnelle. Le « constitutionalisme constructiviste » développe une telle argumentation : comme une partie du droit international fait désormais partie des constitutions nationales, les contraintes qu’il exerce sur le droit national sont équivalentes aux contraintes exercées par les normes constitutionnelles nationales34. Ces auteurs avancent que la prédominance du droit européen sur le droit national elle-même n’est possible que sur la base de la constitution – ou d’un équivalent – tels qu’un ensemble de lois supérieures. Selon un tel argument, la souveraineté reste l’attribut d’une autorité supérieure à toutes les autres : le souverain est l’instance mettant en œuvre le niveau le plus élevé des normes35.
La plupart des experts et militants pro-européens adoptent cette vision de la souveraineté ou vont même plus loin en arguant que le mode de gouvernance de l’Union européenne, par son caractère sui generis est d’une nature supérieure au mode de gouvernement représentatif classique et ce, même si c’est aux dépens de la souveraineté36. Par exemple, la tentative du juriste français Olivier Beaud de définir l’Union européenne comme une fédération revient à justifier le statut hybride de l’Union européenne37. Pour Beaud, une fédération n’est ni un État fédéral ni une confédération d’États, mais plutôt une « Union fédérale d’États ». L’un des éléments principaux qui distinguent la fédération de l’État fédéral est précisément l’absence d’une souveraineté unitaire commune. Selon ce schéma, les États qui composent la fédération conservent leur souveraineté. Pour Beaud, cet arrangement institutionnel, loin de constituer un état intermédiaire et instable, doit être étudié et valorisé comme une instance originale à part entière. Il est difficile de voir dans quelle mesure cette formulation est réellement originale. De fait, elle ressemble fortement à la description fréquente de l’Union européenne comme organisation à mi-chemin entre la confédération et l’État fédéral38.
Cette perspective formelle et juridique, largement dominante dans les cercles pro-européens, ne décrit pas adéquatement les évolutions qu’a subies la souveraineté. La citation suivante, de la part d’un expert en affaires européennes reflète l’inanité de telles approches quand il s’agit d’expliquer la réalité : « La souveraineté n’est pas une caractéristique objective de l’État que l’on pourrait observer et décrire. Il s’agit plutôt d’un concept (…). Elle appartient au langage du droit positif (…) utilisé par les tribunaux (…). Ces théories ne devraient pas être jugées mais simplement décrites et expliquées. Elles ne sont ni vraies ni fausses (…) et leur cohérence ou incohérence interne n’affecte en rien leur existence ou leur efficacité. En ce sens, la souveraineté survit toujours »39.
Selon moi, la souveraineté n’a de sens que si elle est définie de façon beaucoup plus exigeante. Les arguments juridiques exposés précédemment omettent une réalité fondamentale, à savoir, la difficulté concrète des gouvernements à exercer leur souveraineté, ainsi que l’inexistence d’un pouvoir souverain propre à un autre niveau. Se concentrer sur les discours politiques et juridiques, ainsi que sur les aspects formels de la souveraineté plutôt que sur son contenu et son effectivité conduit à la percevoir comme pouvoir général de l’État plutôt que comme l’ensemble de pouvoirs et compétences exercés en pratique par les États.
L’argument de ces auteurs et acteurs pro-européens selon lequel le transfert des pouvoirs souverains à d’autres niveaux importe peu si le souverain conserve le droit de récupérer ces pouvoirs néglige l’impact énorme que ces transferts ont eu en pratique sur la capacité des États à gouverner. Ils nient aussi le fait que les accords internationaux et les institutions et politiques supranationales ont profondément affecté l’exercice même de la souveraineté. Cette analyse est valable y compris si l’on adopte une acception mince et juridique de ce concept. Par exemple, il ne suffit pas de rappeler que les principes d’« effet direct » et de « primauté du droit européen » ont été intégrés aux Traités par les États après avoir été formulés par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE). Ces principes supranationaux contraignent clairement les gouvernements nationaux. La notion de « post-souveraineté » permet ici de saisir cette situation dans laquelle la souveraineté a disparu, en tout cas dans sa signification traditionnelle40.
Une autre faille dans l’argumentaire pro-européen prédominant est son insistance excessive sur la dimension intergouvernementale : les États membres demeureraient les acteurs clés du processus décisionnel européen. Un examen honnête de la machinerie institutionnelle européenne mène pourtant à des conclusions bien moins tranchées. Certes, tout nouveau traité doit être signé et ratifié par les États membres. Cependant, la prise de décision européenne ne s’arrête pas là. Bien que fort détaillés, les traités européens demeurent du droit primaire général qui doit être mis en œuvre par les institutions nationales et européennes. Au quotidien, la prise de décision européenne requiert l’intervention de plusieurs institutions : le conseil des ministres – censé représenter les intérêts nationaux – mais aussi trois autres institutions. Dans la plupart des domaines, le conseil légifère conjointement avec la Commission européenne et le parlement européen lors de la procédure dite de « codécision ». Or, ces deux dernières institutions sont supranationales plutôt qu’intergouvernementales. Selon ce procédé, la commission détient le pouvoir formel de proposer une nouvelle législation européenne et c’est seulement lorsque ces trois institutions tombent d’accord que celle-ci peut être votée41.
Quid du mode de fonctionnement de l’instance intergouvernementale, à savoir, le conseil – abréviation pour conseil des ministres ? Quand les matières débattues requièrent l’unanimité au conseil, cela signifie que le seul pouvoir réel détenu par les États – en particulier s’il s’agit d’un petit État dont le pouvoir de négociation est faible – est un pouvoir de veto ou de blocage de la décision. Par ailleurs, le mode de décision majoritaire qui prévaut sur de nombreuses matières à l’intérieur du conseil a pour effet de mettre en minorité certains gouvernements sur des thèmes parfois essentiels. On fait alors face à une situation dans laquelle un gouvernement se voit obligé de mettre en œuvre une politique contre laquelle il a voté au conseil, ce qui peut le mettre en porte à faux vis-à-vis de son parlement et de sa population. Ceci contredit l’argument selon lequel le conseil défend nécessairement l’intérêt de tous les États. Quand la prise de décision se fait à la majorité qualifiée, le conseil agit de façon supranationale plutôt que strictement intergouvernementale42.
Le conseil européen est l’autre instance intergouvernementale composée des chefs d’États et de gouvernements se réunissant à intervalles réguliers. Sa fonction principale est d’impulser des directives politiques générales, plutôt que de créer de nouvelles lois européennes. En pratique, cela veut dire que le pouvoir informel des États les plus grands et les plus influents tend à prévaloir à l’intérieur de cette institution.
L’Union européenne est donc une entité hybride, dotée de traits intergouvernementaux et supranationaux. Cela a dès lors peu de sens d’affirmer que, parce que les États gardent la capacité de signer ou de sortir des traités, leur souveraineté demeure intacte. Même sur le plan purement formel, cette assertion n’est pas convaincante. La dimension supranationale de l’Union européenne affecte clairement la souveraineté, y compris dans ses aspects formels. S’il est bon de rappeler que les États ont, à un moment donné de leur histoire, consenti à cette limitation de leur souveraineté, cela ne change rien à cette réalité troublante affectant toujours les gouvernements actuels.
En outre, le retrait des traités de la part d’un État n’est pas aussi aisé que le prétendent les argumentaires formels et juridiques affirmant le maintien des souverainetés nationales. La longue et douloureuse expérience du Brexit l’a démontré à souhait. Outre ...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Copyright
- Titre
- Introduction
- Chapitre Un : Liberté individuelle et collective
- Chapitre Deux : Réformisme radical et construction d’une Europe souveraine
- Chapitre Trois : Une souveraineté européenne pour recréer de l’agir politique
- Chapitre Quatre : Vers une nouvelle approche du cosmopolitisme
- Chapitre Cinq : Souveraineté européenne, démocratie et état de droit
- En guise de conclusion
- Dialogues – Madame l’Européenne, l’« alter », le « pro » et l’« anti »
- Bibliographie
- Table des matières