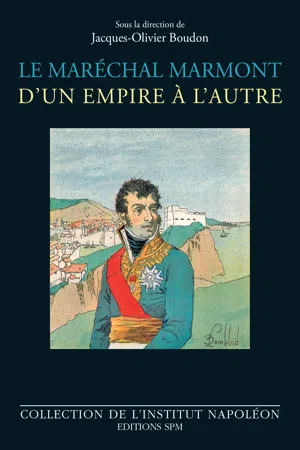
- 226 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Le maréchal Marmont est resté dans la mémoire de l'épopée napoléonienne comme le modèle du traître. La défection d'Essonnes le 4 avril 1814, quatre jours après la capitulation de Paris, est restée à jamais attachée à sa mémoire, alors même que Marmont avait été l'un des plus proches compagnons du jeune Bonaparte, dès le siège de Toulon, puis encore en Italie et en Égypte. Même s'il n'est pas immédiatement promu maréchal, il reste un rouage essentiel du système napoléonien jusqu'à se voir confier le gouvernement général des provinces illyriennes où il a laissé un souvenir durable. Après la chute de l'Empire, Marmont n'aura de cesse de se justifier, objet principal des Mémoires qui seront publiés après sa mort survenue en 1852.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Le maréchal Marmont d'un empire à l'autre par Jacques-Olivier Boudon en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Histoire et Histoire du monde. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
HistoireSujet
Histoire du mondeMARMONT, GOUVERNEUR GÉNÉRAL DES PROVINCES ILLYRIENNES
AUX PRISES AVEC LA « LANGUE DU PAYS »
par Alain Jejcic
Nommé à la tête des Provinces illyriennes gouverneur général dès leur création le 14 octobre 1809, le maréchal Marmont, duc de Raguse, arrive à Laybach (Ljubljana), capitale des Provinces, le 4 novembre suivant. Dix-huit mois plus tard, appelé à remplacer le maréchal Masséna en Espagne, il quitte le pays le 26 avril 1811.
Durant son office à la tête du gouvernement des Provinces illyriennes, il fait un travail considérable pour la modernisation de l’administration étatique mais également, en conduisant toute une série de réformes concernant la vie économique et sociale notamment en changeant le système d’imposition, en élargissant la conscription à tous les hommes aptes à servir, en introduisant la liberté du commerce et de l’artisanat et surtout en donnant à la « langue du pays » le statut de langue officielle par l’introduction dans les programmes d’enseignement scolaire, il rompt avec la situation prévalant jusqu’alors et marque de la sorte l’avènement des temps nouveaux. Par ailleurs, général en chef, il procède à l’organisation des forces armées en territoire illyrien en consacrant une attention particulière aux Confins militaires croates ajoutant de la sorte un volet militaire à son action. Ainsi, gouverneur général des Provinces illyriennes, Marmont se présente face à l’Histoire non seulement comme un homme de guerre mais également comme un administrateur, un homme politique, voire comme homme d’État.
Lorsqu’il s’installe au palais épiscopal, évacué par l’évêque Kavčič, le maréchal Marmont est un homme jeune. Très bien de sa personne, aux allures de grand seigneur que tempèrent une bonhommie et une bienveillance qu’il ne manque pas d’afficher à ceux qui l’approchent, il plaît. Sa bibliothèque de quelques six cents volumes, acheminée dans un fourgon spécial, impressionne. Ajoutées à ses manières non-conformistes de régler les problèmes regardant la vie quotidienne des gens, sa méthode de gouvernement est acceptée de la population. Bien évidemment, la rigueur de l’occupation militaire comme les contradictions de la société illyrienne pèsent, mais son « heureuse nature »1, mise en avant par l’historien slovène Francé Kidrič, et son entregent contribuent à faire face. À son arrivée, connu du pays puisqu’il vient de séjourner en Dalmatie pendant trente-quatre mois, des transparents, affichés sur les fenêtres de la ville l’accueillent en lui souhaitant la bienvenue. Passant dans son carrosse, tiré par un attelage de douze chevaux, a-t-il vu sur l’Hôtel de ville, inscrit en slovène « Depuis Beljak (Villach) jusqu’à Budva, les Slovènes chantent le salut de notre voïvode Marmont ! »2 Aussi a-t-il prêté attention à l’affiche où les habitants de Ljubljana proclament, toujours en slovène, leur volonté de connaître « la voïvodine » (son épouse) ? On ne saurait le dire. Mais, retenons qu’avant même qu’il n’ait rejoint son palais, le gouverneur général, le maréchal Marmont, a affaire à la « langue du pays », le grand sujet politique qui fera de l’intermède français un moment décisif de l’histoire slovène et croate.
L’ÉNIGME ILLYRIENNE DES MÉMOIRES DU MARÉCHAL MARMONT, DUC DE RAGUSE
Vingt ans après, à partir de 1828, ou « plus probablement après 1830 »3, il rédige des mémoires dans l’intention manifeste de justifier son action qui a contribué à la prise de Paris le 29 mars 1814 par la Coalition et l’abdication de l’Empereur le 6 avril suivant, la fameuse Ragusade. Sur l’ensemble de 4500 pages que forment le contenu des Mémoires, seule une centaine sont consacrées aux Provinces. C’est assez peu, constate Jacques-Olivier Boudon4. Néanmoins, l’historiographie les exploite abondamment, notamment en retenant l’origine romaine de l’appellation des Provinces illyriennes et le terme de margraviat pour qualifier son caractère frontalier. « Et vous serez le margrave »5, lui a dit l’Empereur en lui annonçant sa volonté de créer un nouvel État à partir des pays cédés par l’Autriche.
Dès leur parution, les Mémoires font l’objet de commentaires et de critiques, la plupart du temps négatives6. Tous se plaisent à reconnaître à Marmont « un talent comme écrivain » mais n’en considèrent pas moins qu’il s’agit « d’un long pamphlet n’épargnant personne ». Pour Albert du Casse, qui a examiné en détail la partie consacrée à la campagne d’Espagne, les Mémoires ne sont « ni histoire ni mémoires »7. Le jugement serait sévère si le constat ne faisait pas paradoxe. Aussi, en dépit de sa brutalité, il nous suggère la voie à suivre pour lire les Mémoires, à savoir dénicher le paradoxe. Et de fait, en parcourant la centaine de pages consacrées aux Provinces on s’y confronte en constatant que pas la moindre allusion n’est faite à la « langue du pays ». Absente des Mémoires, mais pourtant essentielle tant par rapport à l’histoire des Provinces qu’au niveau de l’action du maréchal à la tête du gouvernement illyrien, son absence détonne. Ainsi, au regard qu’il porte sur son action à la tête du gouvernement des Provinces, tel qu’il l’a consigné dans les Mémoires, il nous est apparu intéressant d’ajouter une relation sur son action en faveur de la « langue du pays ». Ce faisant, on espère donner une image plus complète du séjour illyrien du maréchal et surtout mettre en relief ce moment politique de son action à la tête du gouvernement illyrien.
« LA LANGUE DU PAYS », PRÉLIMINAIRES
Quand, après avoir franchi le Tagliamento le 16 mars 1797, les armées françaises passent l’Isonzo trois jours plus tard et pénètrent sur le territoire qui plus de douze ans après va être intégré dans les Provinces illyriennes, elles se retrouvent pour la première fois face à des populations slaves, plus exactement aux Slaves du Sud.
Le commandant en chef, Napoléon Bonaparte, installe son état-major à Gorica (Gorizia, Görz) alors que le général Bernadotte à la tête de sa division occupe la Carniole. Avant d’entrer dans la capitale, Ljubljana (Laybach), de Logatec où il établit son état-major, il envoie le 29 mars un émissaire à la tête d’un détachement d’une quarantaine de hussards porter une déclaration à l’adresse de la population. Rédigée en trois langues, français, allemand et slovène ‒ « la langue du pays », l’affiche incite les populations à demeurer dans leurs foyers car l’armée française s’engage à respecter les us et les coutumes du pays8. De la sorte, dès leur première rencontre avec les Slovènes, les militaires français font appel à la « langue du pays » pour s’adresser aux populations locales. D’une certaine façon il s’agit d’une première reconnaissance officielle de l’idiome slovène.
Geste ressortissant aux besoins d’efficacité de l’occupation militaire ou expression d’une attention particulière aux populations locales ? On ne saurait y répondre mais, compte tenu du retentissement qu’aura la question de « la langue du pays » par la suite, on peut y voir le moment initial d’un mouvement qui va culminer quatorze ans plus tard lorsque Marmont, gouverneur général, signera l’arrêté instituant l’usage officiel de la « langue du pays » dans les Provinces illyriennes.
DIVERSITÉ ET UNITÉ DES « PROVINCES DE L’ILLYRIE »
La diversité géographique et humaine des Provinces illyriennes s’impose à Marmont qui l’évoque de sa plume brillante dès les premières lignes de sa relation en ces termes : « … agrégations de provinces, les unes autrefois vénitiennes et les autres autrichiennes, différent entre elles par le climat, par le langage, par la nature de leur population, enfin par toutes les circonstances qui constituent la diversité des peuples. (…) Il y a donc autant de mœurs diverses que de provinces, autant de produits différents que de localités, et surtout les diverses manières d’exister n’ont aucun rapport entre elles »9. Le tableau est saisissant mais incomplet puisqu’il néglige d’indiquer que les populations slaves sont très largement majoritaires dans les Provinces ; elles représentent entre 80 % à 90 % de la population10.
Par conséquent, le Provinces illyriennes, si diversifiées qu’elles puissent paraître, et la présentation de Marmont n’est guère excessive, n’en recèlent pas moins un élément d’unité du fait de la prépondérance de l’élément slave dans sa population. C’est un point essentiel.
LES SLAVES DU SUD ET LEUR LANGUE
Étant donné l’attention dont va l’être l’objet la « langue du pays » de la part de l’administration française sous Marmont, deux remarques s’imposent sur les rapports des Slaves du Sud à leur langue.
En premier lieu, il semble qu’il faille tenir compte du slovo, la langue, la lettre, le mot, et de la slava, la gloire, la célébration, la notoriété. Les mots étant chargés d’évoquer le souvenir, la gloire des anciens, ils sont porteurs d’un nouage assurant aux Slaves leur présence dans l’histoire11. Par ailleurs, en second lieu, le parler slave est l’ultime recours des populations balkaniques dépourvues d’un cadre étatique digne de ce nom après que l’invasion ottomane ait littéralement fait voler en éclat les bases matérielles et spirituelles de leur organisation sociale, l’empire des Habsbourg et la République de Venise ne sachant ou ne voulant pas remédier au désordre qui en a résulté.
Ainsi, raisons intrinsèques et circonstances historiques se conjuguant donnaient à la « langue du pays » une importance décisive pour la pérennité historique des nations sud-slaves. Apanage des campagnes, les villes étant peuplées en partie d’Italiens sur la côte Adriatique et d’Allemands en Carniole et Carinthie, la « langue du pays » devient vers la fin du dix-huitième siècle objet d’intérêt intellectuel de la part d’individus s’intéressant au passé, aux coutumes, à la littérature orale de leur pays. Happés par les grands bouleversements de l’époque, ces individus, connaisseurs, spécialistes en quelques sortes des particularités distinctives, locales de leur communauté (parler, histoire et tradition locales etc.) en deviennent les porte-paroles et acquièrent un poids social pourrait-on dire, une notoriété qu’ils n’avaient pas jusqu’alors12.
Dans les pays qui formeront les Provinces illyriennes deux groupes de personnalités se distinguent alors : d’une part, les slavisants ragusains ; d’autre part, les rénovateurs slovènes. Les premiers, héritiers d’une longue tradition littéraire, forment le principal pilier de l’illyrisme. Spécifique aux Slaves du Sud, l’illyrisme tente de construire l’histoire de leur présence sur la côte Adriatique en situant leur origine chez les Illyres, sujets de l’Empire romain13. La filiation est prestigieuse. Marmont, général en chef de l’Armée de Dalmatie, les fréquente assidûment. Les seconds, influencés par le jansénisme français, la philosophie des Lumières mais également impulsés directement par la philologie tchèque alors en plein essor, tentent de dégager la voie vers la constitution d’une langue slovène littéraire dotée d’une graphie standard14. À Ljubljana, capitale des Provinces illyriennes, rassemblés autour du riche baron Zois, ils forment un cercle intellectuel influent dont Marmont, gouverneur général, ne tarde pas à faire connaissance après son arrivée.
MARMONT GÉNÉRAL EN CHEF EN DALMATIE
Gouverneur général des Provinces illyriennes, Marmont doit beaucoup au général en chef de l’Armée de Dalmatie qu’il a été durant trente-quatre mois du mois d’août 1806 jusqu’à la mi-mai 180915.
Durant son séjour dalmate, débuté par des affrontements avec l’armée russe et les Monténégrins et s’achevant par la campagne de Croatie contre l’armée autrichienne16, il se familiarise avec la réalité humaine de cette terre anciennement vénitienne, il fait la connaissance de la langue croate (illyrienne) et, collaborant avec le provéditeur général Vincenzo Dandolo à la conduite des affaires du pays, il rencontre nombre de ses futures collaborateurs qui vont le suivre à Ljubljana. « … mes loisirs me permettant de parcourir la Dalmatie dans toutes les directions, il n’y a pas une vi...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Copyright
- Les auteurs
- Introduction, par Jacques-Olivier Boudon
- Dans les pas de Bonaparte, par Franck Favier
- Marmont, les Perregaux et les Suisses en 1814 et en 1830, par Alain Jacques Czouz-Tornare
- Marmont, gouverneur général des Provinces illyriennes, aux prises avec la « langue du pays », par Alain Jejcic
- Le maréchal Marmont et Joseph Bonaparte. Le cours des choses pouvait-il être inversé en Espagne ?, par Vincent Haegele
- La bataille des Arapiles, par Natalia Griffon de Pleineville
- Marmont et la défense de Paris, par Pascal Cyr
- Marmont et la défection d’Essonnes. Le maréchal a-t-il « ragusé » ?, par Jacques Jourquin
- Marmont et Napoléon, par Nordine Kadaoui
- Le maréchal Marmont dans la France de la Restauration, par Jacques-Olivier Boudon
- Marmont et le duc de Reichstadt : entre souvenir et propagande, par Laetitia de Witt
- La réception critique des Mémoires de Marmont, par Charles Éloi Vial
- Table des matières