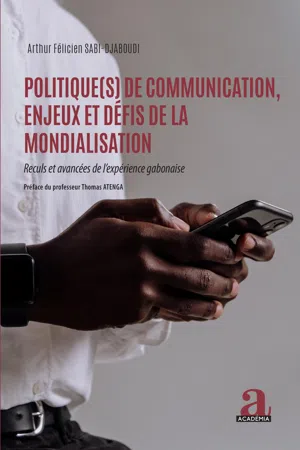
eBook - ePub
Politique(s) de communication, enjeux et défis de la mondialisation
Reculs et avancées de l'expérience gabonaise
- 416 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Politique(s) de communication, enjeux et défis de la mondialisation
Reculs et avancées de l'expérience gabonaise
À propos de ce livre
Pas de démocratie sans information libre et de qualité. Sur la base de ce principe, Arthur Félicien SABI-DJABOUDI s'interroge sur les politiques de communication au Gabon: comment garantir la liberté des médias contre les velléités de contrôle des pouvoirs politiques? L'analyse documentaire et critique met en évidence les reculs et avancées des médias gabonais dans leur combat pour le développement, les droits et les libertés, dans le respect d'un débat pluriel des idées.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Politique(s) de communication, enjeux et défis de la mondialisation par Arthur Félicien Sabi Djaboudi en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences sociales et Politique. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
Sciences socialesSujet
PolitiqueCHAPITRE 1
CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE
1. Le rapport entre communication et développement
Le rapport entre communication et développement constitue un vaste champ dans lequel on trouve des approches méthodologiques et idéologiques différentes. Au-delà de ces différences, les leçons de l’expérience en ce domaine montrent qu’il est souhaitable de privilégier les processus interactifs et participatifs plutôt que d’examiner la production et la diffusion d’informations isolées des processus communautaires. Bien qu’on les considère parfois comme la contribution globale de la communication au développement de la société ou encore comme l’application des médias au traitement des thèmes de développement, on s’entend généralement pour définir les processus de communication comme l’utilisation planifiée de stratégies en vue du développement. Le concept même est apparu dans le cadre de l’apport de la communication et des médias au développement des pays du Tiers-Monde dans les années 1950-1960. L’UNESCO et l’US AID (Agence des États-Unis pour le développement international) ont alors fait la promotion de quantité de projets d’utilisation des médias à des fins de communication, d’information ou d’éducation, en vue de faciliter le développement ; les pays en développement étant la cible des thèmes de développement1.
Les relations entre les flux d’information et le développement – au niveau national ou local – sont mieux connues depuis quelques années, de même que le rôle des processus de communication pour accompagner les changements sociaux et individuels. Toutefois, dans de nombreux pays africains, ces relations ne sont pas suffisamment débattues ni facilement acceptées, notamment par les planificateurs du développement2. Fondamentalement, la communication est un processus social qui provoque des changements dans les connaissances, les attitudes et les comportements des individus ou des groupes, en mettant à leur disposition des informations factuelles et techniques mais aussi en facilitant le processus d’apprentissage et d’adaptation à l’environnement social. Ces éléments pourraient conduire à une maîtrise plus aisée des compétences essentielles pour les individus et à une réalisation plus efficace de divers buts déterminants3. Parmi les autres effets possibles de la communication, on peut observer l’augmentation de l’estime de soi et du bien-être, par une participation à la vie sociale et communautaire, l’amélioration de la qualité des relations interindividuelles, le renforcement du respect mutuel et de la confiance en soi dans les groupes sociaux et l’instauration de la confiance au sein des communautés. Tous ces ingrédients contribuent à produire des changements positifs au niveau des individus, des communautés ou de la société, que l’on qualifie souvent de « développement ».
Dès la formation des premiers gouvernements africains, parfois même avant la proclamation des indépendances, l’importance reconnue et accordée aux médias se devait donc d’aider les populations à mieux se connaître entre elles pour prendre conscience de similitudes, reflet d’une communauté de sang et de destinée, à affirmer leur personnalité4. Cet intérêt des Africains pour les médias, et en particulier pour la radio, fut aussi marqué par le transfert des installations de la France et de l’Angleterre aux nouveaux États. Historiquement, la radio a exercé en Afrique le même attrait qu’elle suscita auprès des Occidentaux, mettant notamment en relief le rôle important de l’information dans la relation étroite de la radio avec le pouvoir politique. En effet, la place qui lui fut attribuée, combinée avec le contrôle étroit du pouvoir politique, fit rapidement d’elle un instrument de mobilisation politique et nationale.
Outre son rôle économique et social, la radio s’est imposée comme le principal moyen d’information en Afrique noire en ce qu’elle permettait à l’origine de diffuser les mots d’ordre des dirigeants, de s’adresser aux populations rurales plus qu’à celles de la capitale. La plupart des habitants y ont en effet des possibilités restreintes d’utiliser les moyens modernes de communication pour exprimer leurs opinions sur des questions d’ordre national et public, et ainsi participer aux processus de prise de décisions. Les taux d’équipement en matériel audio-visuel vers 1960 laissent apparaître que les pays africains situés au sud du Sahara demeurent la partie du monde qui n’a pas encore été envahie par la télévision.
2. Du concept de développement
Le discours sur le développement a fait l’objet d’une riche et abondante littérature au cours des trente dernières années. Postérieur à la Deuxième Guerre mondiale, ce terme de développement s’est substitué à celui de « civilisation », qui s’identifiait à l’expansion coloniale en lui servant de justification, sinon d’alibi. Rudyard Kipling, qui s’appuyait parfois sur les thèses racistes postulant la supériorité de l’homme blanc, était convaincu qu’un effort civilisateur compenserait l’exploitation coloniale, conséquence du développement capitaliste de la fin du XIXe siècle5.
Héritage du positivisme, le concept de développement n’est pas à confondre avec les notions de croissance et de progrès. Utopie, élément d’une croyance moderne établissant la nécessité du progrès de la connaissance6, le développement est perçu depuis longtemps comme une évidence, une aspiration universelle, le bonheur de tous pouvant être assuré par le progrès, la connaissance sans limites et la production de biens et de services7. La problématique du développement laisse libre cours à diverses réactions selon les tendances politiques, idéologiques et géographiques. Plusieurs postulats sous-tendent une explication exhaustive du développement, liant celui-ci à la possibilité que chaque nation soit en mesure de l’atteindre, s’inspirant des sociétés les plus développées et parvenant de la sorte à rattraper rapidement leur retard. Les difficultés qu’ont générées certaines politiques de développement ne cadrent pas toujours avec les aspirations et la culture des sociétés. Terrains d’expérimentation, les pays latino-américains, asiatiques et africains, ayant souffert de la colonisation et aspirant à l’indépendance, à partir d’un vaste mouvement de décolonisation, vont adresser aux pays du Nord une virulente critique de leurs conceptions du développement et de l’esprit humain jugées ethnocentristes.
Révélatrice du sous-développement de l’Afrique, la mondialisation remet en cause le concept de développement qui a longtemps entretenu la propagande et la langue de bois dans les médias. Les dirigeants des anciens peuples colonisés appelés « sous-développés », ensuite pudiquement « en voie de développement », ont cru, sous l’impulsion de l’UNESCO et de l’ONU, que les médias électroniques (radio et télévision) permettraient de combler le retard dû à l’analphabétisme8. Inspirée des idées évolutionnistes et darwinistes en anthropologie et en biologie, la conception sous-jacente au développement est que chaque société est en mesure de devenir une nation industrielle, mais à condition qu’elle s’inspire du modèle des sociétés avancées, celles-ci préfigurant leur avenir et leur rendant possible un rattrapage rapide9. Selon François Perroux, le développement se définit comme « la combinaison des changements politiques, sociaux, techniques, culturels et mentaux d’une population, qui la rendent apte à accroître durablement les différents progrès individuels et collectifs »10.
Dans la résolution sur le développement économique des « pays en développement », votée le 4 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies, la finalité des politiques de développement est appuyée par la coopération internationale11, c’est-à-dire l’assistance technique puis le transfert des capitaux du Nord vers le Sud par le biais de la Banque mondiale. Le discours d’investiture du président des États-Unis Harry Truman, le 20 janvier 1949, interpelle l’opinion par sa nouvelle vision du développement :
« Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de notre avancée scientifique et de notre pensée industrielle au service de l’amélioration et de la croissance des régions sous-développées […] Ainsi, une relation étroite est établie entre le développement, progrès technique et modernisation ; les transferts de technologie reposent sur des savoir-faire. […] L’instruction et notamment l’alphabétisation apparaissent comme des instruments indispensables pour transmettre des savoirs et des savoir-faire12. »
Ce modèle de développement concevait la communication comme un processus de masse et de grande envergure basé sur l’augmentation de l’activité économique et le changement de valeurs et d’attitudes. Il se fondait sur l’idée qu’il suffisait de diffuser les connaissances et les innovations venant du Nord pour qu’elles soient adoptées par le Sud13. Théorisée par Walt Rostow14, cette approche développementiste considérait que la croissance de la « société industrielle était le degré zéro de l’histoire et de l’industrialisation, comme un processus irréversible suivant obligatoirement le même chemin que celui tracé par les pays européens »15.
Plusieurs théoriciens se sont essayés à mobiliser les médias en vue d’apporter des réponses claires sur le devenir du monde face aux mutations observées. De ce constat, il apparaît – selon les tenants de la théorie de la modernisation – que l’internationalisation des médias contribue à moderniser les sociétés, notamment celles du Tiers-Monde. Dans cette perspective, les médias africains vont apparaître comme des outils de modernisation et des « multiplicateurs de développement ». Pour Daniel Lerner, qui envisage la modernisation comme le processus séculaire de changement vers un système social de participation, les médias constituent une des variables de modernisation par leur influence sur le taux d’alphabétisation et sur la participation politique.
Ces idées seront reconnues officiellement par l’UNESCO qui charge Wilbur Schramm en 1962, en tant que membre du Stanford University Institute for Communication Research, d’étudier le rôle de l’information et des médias dans les pays en voie de développement16. Une réflexion dont il rendra compte en 1964 dans un ouvrage intitulé Mass media and national development : the role of information in the developing countries. Comme l’a bien indiqué Sylvie Capitant,
« les dirigeants africains appuieront cette idée et, souvent pour des raisons politiques, imposeront un monopole étatique sur les médias de masse afin que ces derniers remplissent leur mission de développement et de construction d’un sentiment national. Dans les années 70 le discours se modifie, sous l’influence de la pensée critique d’inspiration marxiste qui influe les sciences sociales dans leur ensemble. Le Tiers-Monde n’est plus vu sous le prisme tradition/modernité mais sous celui de la domination. L’Occident est au centre d’une aire de domination à profil concentrique dans laquelle le Tiers-Monde n’est qu’une périphérie exploitée par le centre17. »
Le rapport de la Commission Sud (Défis au Sud), rédigé sous la direction de l’ancien président tanzanien Julius Nyeréré, propose la définition suivante :
« Le développement est un processus qui permet aux êtres humains de développer leur personnalité, de prendre confiance en eux-mêmes et de mener une existence digne et épanouie. C’est un processus qui libère les populations de la peur du besoin et de l’exploitation et qui fait reculer l’oppression politique, économique et sociale. C’est par le développement que l’indépendance politique acquiert son véritable sens18. »
En vogue au cours des années 1970 et 1980, ce paradigme tenait le modèle occidental comme l’exemple économique à suivre en vue d’attein...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Copyright
- Titre
- À PROPOS DE L’AUTEUR
- Dédicace
- REMERCIEMENTS
- PRÉFACE
- INTRODUCTION
- CHAPITRE 1 – CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE
- CHAPITRE 2 – TYPOLOGIE DES SYSTÈMES DE COMMUNICATION
- CHAPITRE 3 – DE LA DÉCOLONISATION DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT AU RÉÉQUILIBRAGE DE L’INFORMATION
- CHAPITRE 4 – LE GABON ET SA POLITIQUE DE COMMUNICATION
- CHAPITRE 5 – L’ÉMERGENCE DES MÉDIAS ÉCRITS ET AUDIOVISUELS
- CHAPITRE 6 – LE CADRE INSTITUTIONNEL DES MÉDIAS
- CHAPITRE 7 – LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES DE CONTRÔLE DE L’INFORMATION
- CHAPITRE 8 – LES MISSIONS ET PRINCIPES D’ACTION DÉVOLUS AUX MÉDIAS PUBLICS
- CHAPITRE 9 – DES LOIS RÉPRESSIVES ET LA LIBERTÉ EN DANGER
- CHAPITRE 10 – LA POLITIQUE DE PROMOTION, DE SOUTIEN ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRESSE ET DE L’AUDIOVISUEL
- CHAPITRE 11 – L’ÉDITION ET LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
- CHAPITRE 12 – LE NOUVEAU CODE DE LA COMMUNICATION : UNE DÉRIVE AUTORITAIRE ?
- CHAPITRE 13 – LE JOURNALISTE-FONCTIONNAIRE : STATUTS ET CONDITIONS D’EXERCICE
- CHAPITRE 14 – LE JOURNALISTE FACE À LA QUESTION DE L’ÉTHIQUE, DE LA DÉONTOLOGIE ET DE L’OBJECTIVITÉ
- CHAPITRE 15 – LE JOURNALISME DE « DÉVELOPPEMENT » OU LE RÈGNE DU JOURNALISME DE CONNIVENCE
- CHAPITRE 16 – LE JOURNALISTE ET SON CADRE D’ACTION SYNDICALE
- CHAPITRE 17 – LES CONDITIONS MATÉRIELLES ET DE VIE : LA PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE DES MÉDIAS PUBLICS
- CHAPITRE 18 – LES MÉDIAS GABONAIS À LA CONQUÊTE DE LA CRÉDIBILITÉ ET DE LA LÉGITIMITÉ PERDUES
- CHAPITRE 19 – LES INSTANCES DE RÉGULATION ET D’AUTORÉGULATION DES MÉDIAS
- CHAPITRE 20 – MÉDIAS ET DÉVELOPPEMENT POLITIQUE
- CHAPITRE 21 – LA COOPÉRATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- CHAPITRE 22 – L’AUDIENCE DES MÉDIAS GABONAIS
- CHAPITRE 23 – REPENSER LA COMMUNICATION AU GABON
- CHAPITRE 24 – LE GABON ET LES DÉFIS DE LA MONDIALISATION
- CHAPITRE 25 – LE GABON : PETIT PAYS AUX GRANDES AMBITIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
- CONCLUSION
- BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
- PRINCIPAUX SIGLES UTILISÉS
- TABLE DES MATIÈRES