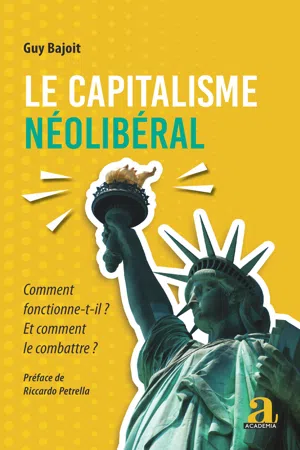
eBook - ePub
Le capitalisme néolibéral
Comment fonctionne-t-il ? Et comment le combattre ? - Préface de Riccardo Petrella
- 208 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Le capitalisme néolibéral
Comment fonctionne-t-il ? Et comment le combattre ? - Préface de Riccardo Petrella
À propos de ce livre
Si vous ne comprenez plus le monde dans lequel vous vivez, mais que vous être pourtant convaincu que ceux qui le gouvernent le mènent « droit dans le mur », lisez ce livre. Vous y apprendrez ce qu'il faut faire pour empêcher cela. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui sont indignés par ces comportements intolérables et prétend apprendre comment fonctionne le capitalisme néolibéral, afin de leur proposer une manière efficace de le combattre.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Le capitalisme néolibéral par Guy Bajoit en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Social Sciences et Economic Theory. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
Social SciencesSujet
Economic TheoryPremière partie
Comment fonctionne le capitalisme néolibéral ?
Chapitre I
La logique de fonctionnement du capitalisme néolibéral
« Réduire l’aventure humaine à la compétition, c’est ravaler l’individu au rang de primate. »7
Dans les pays du Nord occidental, depuis un demi-siècle environ, la logique dominante qui régit le fonctionnement du capitalisme a changé très radicalement. Pour le dire en une phrase, nos sociétés sont passées d’un capitalisme industriel national et protectionniste, régulé par les États, à un capitalisme néolibéral mondialisé, dérégulé et imposant ses propres règles aux États*. Il importe de préciser d’abord que ces deux régimes ne sont pas seulement des régimes économiques (des modes de production), mais que ce sont des régimes sociétaux, c’est-à-dire qui imprègnent toutes les relations sociales* de la vie commune, donc tous les champs relationnels*.
L’analyse présentée ici repose sur sept propositions*, qui concernent les sept champs relationnels que je considère comme constitutifs de la vie commune. Ces champs sont articulés entre eux et j’estime qu’ils ont tous une importance théorique égale : car si l’un d’entre eux ne fonctionne pas comme le veut la logique de l’ensemble, il bloque le fonctionnement des autres et « la machine » ralentit ou s’arrête. Un schéma (figurant à la fin de ce premier chapitre) résume l’analyse et peut servir de guide de lecture. J’attire l’attention sur la signification des flèches dans ce schéma : elles ne signifient pas « cause… », mais plutôt « permet de comprendre les raisons de… ». Car il n’y a pas de causalité efficiente dans la vie sociale : les acteurs sont conditionnés, mais comme je viens de le rappeler, ils ne sont jamais entièrement déterminés par des logiques structurelles : ils peuvent toujours dire « non » !
Première proposition : la logique des relations de savoir*
Depuis les années 1970, les innovations techniques dans les domaines de l’informatique, de la robotique et de l’intelligence artificielle, ainsi que les découvertes scientifiques de la génétique et leurs prolongements dans la biotechnologie, ont engendré une profonde mutation technologique.8 Celle-ci a eu au moins trois conséquences majeures.
1- Cette mutation a engendré une course effrénée à l’innovation technologique entre les entreprises des pays les plus hégémoniques du monde. Les entreprises qui adoptent les nouvelles technologies, et parviennent à suivre le rythme du renouvellement permanent de leurs procédés de production, survivent et grandissent ; celles qui n’ont pas pu (ou pas voulu) les intégrer ont survécu péniblement ou ont disparu : elles ont fait faillite, ou bien elles ont été absorbées par les plus grandes. Aucune considération éthique ne semble pouvoir arrêter cette course : les entreprises vont jusqu’à prendre des brevets sur le vivant9 – sur des molécules, sur des gènes –, brevets qui sont autorisés aux USA depuis 1980 et dans l’UE depuis 1992. Ce qui implique que les entreprises capitalistes peuvent désormais traiter la vie comme une marchandise, soumise à la loi de l’offre et de la demande.
2- Cette course à l’innovation a engendré une forte hausse de la productivité* du travail, surtout dans les secteurs les plus stratégiques de l’économie : ces nouvelles technologies permettent de produire, en quantité et en qualité, des biens et des services extrêmement diversifiés, dont l’offre dépasse largement la demande solvable dans les domaines les plus rentables de l’industrie.
3- Cette croissance accélérée et brutale des forces productives a provoqué une prise de conscience écologique. Le progrès indéfini de la maîtrise et de la transformation de la nature par la science, la technique et le travail a touché ses limites : les ressources non renouvelables s’épuisent, l’environnement est en danger, la survie de l’espèce humaine est menacée.
Deuxième proposition : la logique des relations de puissance*
Ce formidable dynamisme technologique a bouleversé les rapports sociaux de production.10 D’abord, en 1973, les fameux « accords de Bretton Woods » (signés en juillet 1944) furent abandonnés. Cela signifie que la valeur des monnaies nationales n’est plus rattachée à un étalon-or commun. L’argent devient ainsi une marchandise privée comme les autres, soumise à la loi de l’offre et de la demande, dont les échanges ne sont plus contrôlés par les États et qui peut donc faire l’objet de spéculation. En même temps, les entreprises, soumises à la loi de la compétition, doivent, pour survivre, vendre tout ce qu’elles sont capables de produire. Elles doivent donc conquérir des marchés au-delà des frontières nationales de leur pays d’origine. On a vu ainsi les États, surtout dans les pays les plus industrialisés, abandonner rapidement le protectionnisme* économique (le modèle keynésien) qu’ils avaient mis en place pour résoudre les problèmes posés par la grande crise des années 1929-1930. Ils ont réduit les droits de douane qui protégeaient leurs entreprises nationales contre la concurrence des entreprises étrangères. Ils ont réduit aussi, voire supprimé, les interventions des États qui avaient pour but de réguler les cycles de l’économie en entreprenant de grands travaux publics, en créant des entreprises publiques et en pratiquant le contrôle des changes. Ils ont donc privatisé (totalement ou partiellement) les grandes entreprises publiques. Bref, la nouvelle classe gestionnaire du capitalisme néolibéral – celle que j’appelle la « classe compétitiviste » (voir plus loin) – a exigé que les États se mettent au service d’un nouveau « dieu » – le Marché – qu’ils se soumettent à ses « lois », qu’ils laissent circuler librement les biens et les services, les capitaux et les informations, qu’ils laissent le marché fonctionner selon sa rationalité propre, en comptant sur sa prétendue « main invisible » pour réguler les échanges. Ils ont ainsi généralisé le modèle économique capitaliste néolibéral.
Cette évolution a engendré une violente montée du chômage, de l’exclusion sociale et des inégalités. Mais elle a eu aussi pour conséquence un changement radical des rapports de classes. Les classes sociales, que Marx avait identifiées pour le capitalisme industriel national – la bourgeoisie, qui s’appropriait et gérait les surplus* économiques et le prolétariat qui les produisait – ne sont plus celles qu’engendre le capitalisme néolibéral d’aujourd’hui. Comprendre ce changement des classes sociales et de leurs rapports est tout à fait essentiel, tant pour analyser que pour réorienter les luttes sociales (voir le chapitre II).
Troisième proposition : la logique des relations d’hégémonie*
Les performances économiques du modèle néolibéral sont telles que la nouvelle classe gestionnaire s’est efforcée de l’imposer au niveau des marchés mondiaux. Les pays qui ont adopté le modèle néolibéral ont réussi, le plus souvent, à augmenter leur « PIB par tête d’habitant* », donc la richesse économique qu’ils produisent et consomment. Cependant, cette richesse est très mal distribuée et les inégalités sociales grandissent entre les groupes sociaux les plus riches et les plus pauvres, ainsi qu’entre les pays qui réussissent, tantôt plus, tantôt moins, à appliquer ce modèle économique, et ceux qui échouent. Cette évolution a eu d’abord pour conséquence l’effondrement des régimes communistes de type soviétique, qui n’ont pas su résister à la compétition avec les pays capitalistes. Elle a eu ensuite pour effet de stimuler les économies de certains grands pays (les « émergents » : Brésil, Russie, Inde, Chine)11, dont la nouvelle classe gestionnaire avait intérêt à conquérir rapidement les marchés.
Dès lors, l’ordre économique et politique mondial qui avait régné jusqu’alors s’est trouvé bouleversé : le monde actuel n’est plus piloté par des Blocs (Est/Ouest), mais par des alliances entre les États les plus hégémoniques de la planète (G8, G20…), qui ont adopté le modèle néolibéral, et par les grandes organisations internationales (FMI, BM, OMC, OCDE12…). Les dirigeants et le personnel de ces dernières, principalement financées par les États hégémoniques, sont au service du projet néolibéral et pèsent de tout le poids de leurs ressources financières et de leur pouvoir politique, pour promouvoir, là où c’est possible dans le monde, l’économie de marché, réputée efficace et incontournable. C’est par l’intermédiaire des États les plus hégémoniques et de ces organisations internationales que la nouvelle classe gestionnaire parvient à imposer le modèle néolibéral à tous (ou presque tous) les autres États du monde. Partout sont mis en œuvre des traités de libre commerce destinés à libéraliser les échanges commerciaux et financiers entre les pays. Ces traités constituent le nouveau visage de l’impérialisme d’aujourd’hui et de demain, puisque les pays moins hégémoniques, s’ils veulent participer au commerce mondial, sont obligés de les signer ou de s’y soumettre dans les faits.
Quatrième proposition : la logique des relations de pouvoir*
La classe gestionnaire néolibérale et les organisations internationales, qui promeuvent ses intérêts, exercent d’énormes pressions sur les États nationaux pour qu’ils se conforment aux exigences du modèle néolibéral. Dès lors, la relation de force entre les États et le marché s’est inversée : pour que la « machine » tourne rond, il faut que les États renoncent à une grande partie de leur souveraineté nationale, qu’ils signent de nombreux traités internationaux qui les engagent, qu’ils renoncent à interférer sur la rationalité du marché (par exemple, qu’ils cessent d’aider les entreprises ou les secteurs économiques en difficulté), qu’ils privatisent leurs entreprises publiques et qu’ils pratiquent une politique d’austérité budgétaire.
Or, les États du monde sont inégaux devant ces exigences : les moins hégémoniques (ceux qui sont moins « développés ») sont souvent incapables de pratiquer de telles politiques, qui ouvrent tout grand la porte à l’impérialisme occidental et qui creusent les inégalités de façon dangereuse au sein de leur population (qui donc a tendance à migrer vers le nord) ; les plus hégémoniques (ceux du Nord occidental) ont dû, pour y faire face, accepter le principe d’un « État minimum » qui les a amenés à renoncer en grande partie à leur souveraineté et qui a mis en cause leur démocratie représentative. En effet, les citoyens se rendent bien compte que leurs dirigeants politiques ont beaucoup perdu de leur emprise sur les États qu’ils gouvernent : pour être élus, ils font des promesses qu’ils savent ne pas pouvoir tenir ! Par exemple, les politiciens promettent de résoudre le problème du chômage, alors que ce ne sont pas (bien au contraire) les États qui créent des emplois ; ils font des « cadeaux » fiscaux aux entreprises étrangères pour qu’elles s’installent dans leur pays : elles profitent de l’aubaine, s’y installent en effet, mais ne créent pas, ou très peu d’emplois. Tout cela fausse le « jeu » politique et provoque une crise profonde de la démocratie parlementaire représentative. D’où le découragement des électeurs qui ne savent plus pour qui voter, ni comment être citoyens : que leurs élus soient de gauche, du centre ou de droite, cela revient presque au même ! Ils s’abstiennent donc de voter ou, pire encore, ils votent pour des partis démagogiques et populistes d’extrême droite. Ceux-ci séduisent l’opinion publique dans beaucoup de pays, en stigmatisant les immigrés, auxquels ils font jouer le rôle de boucs émissaires, et en promettant, en vain, de restaurer la souveraineté nationale.
Cinquième proposition : la logique des relations d’influence*
Pour que tous les groupes de pression – représentant les multiples intérêts et les projets de toutes les catégories sociales qui interagissent dans une collectivité – puissent coexister pacifiquement dans le cadre d’un contrat social, il est nécessaire que l’État mette en place des dispositifs légaux et institués de gestion des conflits par la négociation (et non par la violence armée), permettant à ces groupes de discuter entre eux, d’établir des compromis et de faire garantir ceux-ci par le pouvoir politique.
Sous le régime du capitalisme industriel national, après plus d’un siècle de luttes, le mouvement ouvrier avait fini par obtenir des États qu’ils instituent de tels dispositifs – la concertation sociale –, grâce auxquels les syndicats ont pu négocier avec la bourgeoisie un grand nombre d’acquis sociaux, dans les domaines du travail, de l’éducation, de la santé, du logement et de la Sécurité sociale (indemnisation du chômage, pensions de retraite, assurance maladie invalidité, allocations familiales, pécule de vacances). C’est ce que l’on a appelé le « pacte social de l’État-providence » : en principe, il traitait avec égalité tous ceux qui étaient culturellement considérés comme également utiles au bien collectif. Ainsi, l’institutionnalisation des conflits entre les classes avait mis en marche une « dialectique de progrès » qui profitait aux deux parties : la bourgeoisie faisait des concessions à la classe ouvrière (progrès social), mais elle récupérait la diminution de la plus-value absolue* (résultant de ces concessions) par une augmentation de la plus-value relative*, et ce grâce à une croissance de la productivité du travail due à l’innovation technique. Progrès technique et progrès social s’engendraient ainsi réciproquement en un « cercle vertueux » (qui a bien fonctionné pendant une trentaine d’années après la Seconde Guerre mondiale : les « Trente glorieuses », avec pour point culminant les « Golden sixties »).
L’adoption du néolibéralisme par les États nationaux a remis en question le contrat social de l’État-providence. En effet, ce changement a affaibli les trois partenaires sociaux...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Copyright
- Titre
- Remerciements
- Préface – Est-il possible de libérer la vie des habitants de la Terre de la domination capitaliste mondiale ?
- Introduction
- Première partie – Comment fonctionne le capitalisme néolibéral ?
- Deuxième partie – Comment combattre le capitalisme néolibéral ?
- Conclusion – Être de gauche au XXIe siècle
- Glossaire
- Bibliographie sommaire
- Table des matières