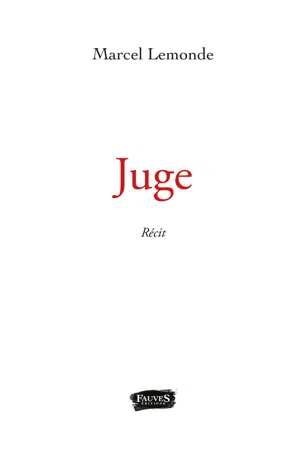![]()
1. POLICE
LYON, 1960
A quatorze ans, on est trop jeune pour se sentir concerné par la guerre d’Algérie. L’arrivée du phénomène « yé-yé » paraît infiniment plus intéressante. Je pris donc l’habitude, comme tout le monde, d’écouter quotidiennement Salut les copains sur mon transistor.
Une mauvaise chute à ski m’avait immobilisé pour trois mois : fracture du tibia. Adolescent plutôt timide, solitaire, je profitais de ce repos forcé pour vivre des aventures imaginaires en dévorant les romans scouts de la collection Signe de Piste, en particulier les aventures du Prince Eric et les Enquêtes du Chat-Tigre. L’auteur, Serge Dalens (ou Mik Fondal, de son vrai nom Yves de Verdilhac) était magistrat. Je ne le savais pas, tout comme j’ignorais qu’il s’agissait d’un homme de droite, d’extrême droite même : il finit par atterrir au Front National de Jean-Marie Le Pen, après avoir frayé avec les milieux intégristes favorables à l’Algérie française. Je l’ignorais à l’époque et aujourd’hui je le sais. Pourtant, même si je crois me situer maintenant plutôt à gauche (pour autant que l’on puisse trouver une définition acceptable de cette étiquette), je ne peux m’empêcher de penser que là n’est pas l’essentiel. Evidemment, son parcours et ses idées ne me rendent pas Verdilhac particulièrement sympathique. Mais ils ne suffisent pas à m’éloigner de Dalens. Celui-ci a donné à plusieurs générations de jeunes, le goût d’une « amitié chevaleresque transcendant les idéologies », comme l’écrira avec justesse Bertrand Poirot-Delpech lors de son décès.
Quel rapport avec mon entrée dans la magistrature ? Le héros des Enquêtes du Chat-Tigre était le neveu d’un juge d’instruction, ce qui l’amenait à pénétrer fréquemment dans un palais de justice. Ce détail a sans doute été déterminant : il m’a donné l’idée de pousser la porte du vieux Palais des « 24 colonnes », au bord de la Saône. Et, peu à peu, comme mon héros favori, plutôt que d’aller au cinéma quand il n’y a pas classe, je prends goût à passer des après-midi entières dans les salles d’audience. Ainsi, je découvre la vie. Passant du tribunal correctionnel à la cour d’assises, je regarde défiler la misère humaine, fasciné. J’admire l’éloquence de certains ténors du barreau. Je souffre avec les débutants, lorsqu’ils bafouillent péniblement. Je tremble (davantage terrorisé que scandalisé, hélas) devant le rictus haineux de certains procureurs. Je suis plutôt bon public, j’ai honte de le dire, toujours prêt à m’amuser d’un bon mot du président.
Certains de ces juges à la Daumier étaient odieux. Pourquoi ne m’ont-ils pas à tout jamais dégoûté de la magistrature ? Mystère. Peut-être inconsciemment me disais-je qu’il était possible de procéder différemment, que ce qui se jouait là était infiniment plus important que la personne du juge ? Toujours est-il que la fascination pour la justice l’emportait. Et tout cela se passait dans la salle même où, quelque trente ans plus tard, je devais présider la correctionnelle. J’y repenserai alors avec un certain amusement, mais aussi sans indulgence, me reprochant rétrospectivement un consternant manque d’esprit critique. Et me disant toujours qu’un adolescent est peut-être en train de m’observer dans le public.
Comment peut-on avoir envie de devenir juge ?.… Cette question, très vite je me la suis posée.
Hélas, après de longues années de réflexion et d’introspection, je crains fort qu’elle reste à jamais sans réponse. Pourquoi ai-je choisi de « soigner mes symptômes » de cette façon et non d’une autre ? Je ne sais toujours pas. Finalement, on a beau creuser, on reste à la surface des choses. On en arrive à se dire qu’après tout, il vaut mieux finir aux assises (comme président, bien sûr) qu’à l’hôpital psychiatrique.
En vérité, cette fameuse question n’est-elle pas proprement impensable tout simplement parce que le métier est lui-même impossible ? « Eduquer, Gouverner, Psychanalyser », telles étaient pour Freud les trois tâches impossibles. Il aurait pu ajouter « Juger », tant ce métier est inhumain. On connaît la formule de Malraux :
« Juger c’est, de toute évidence, ne pas comprendre puisque, si l’on comprenait on ne pourrait plus juger ».
Peut-être convient-il de la compléter par celle qui servait de règle de conduite au Président Bourriche, ce magnifique spécimen de juge correctionnel mis en scène par Anatole France dans Crainquebille. Formule toute simple :
« Il faut renoncer à comprendre mais il ne faut pas renoncer à juger ».
Vouloir juger est sans doute incompréhensible et il vaut mieux abandonner l’idée de savoir pourquoi on peut avoir envie de devenir magistrat, en se bornant à constater que, depuis la nuit des temps, les hommes réunis en société ont éprouvé le besoin de créer une administration appelée « justice » et qu’ils ont toujours trouvé des volontaires pour la faire fonctionner.
Au moins, s’il paraît impossible de répondre à la question pourquoi, essayons de raconter comment on devient juge, en s’en tenant aux faits, sans se préoccuper d’analyser. Les faits sont les suivants : je suis devenu juge, après un détour par la police, sous l’influence directe de plusieurs écrivains dont certains, très accessoirement, étaient aussi magistrats.
Lorsque je m’inscrivis à la Faculté de droit, j’étais encore bien loin de savoir ce que serait ma vie. Officiellement, je me préparais à devenir expert-comptable. Le cabinet de mon père m’attendait portes grand ouvertes, mais j’éprouvais une certaine aversion pour les chiffres et la gestion et n’avais aucune envie de m’engager dans cette voie. Il fallait donc trouver une solution de remplacement. Comme je manquais d’idées, je fuyais le problème dans le divertissement.
Je m’étourdissais dans diverses activités n’ayant que peu de rapport avec les études de droit : fréquentant assidûment les bistrots d’étudiants, jouant beaucoup au bridge et au poker, j’étais fort peu présent dans les amphithéâtres et lisais davantage de romans policiers que de revues de jurisprudence. Georges Simenon et Frédéric Dard ne me quittaient plus. A tel point que j’écrivis à ce dernier une lettre enflammée, dans laquelle je lui disais en gros « j’aime bien ce que vous faites », ce qui était sans doute assez prétentieux de la part d’un gamin comme moi. Toujours est-il qu’il y répondit très aimablement, écrivant que ma lettre était « ruisselante de gentillesses », qu’elle était « utile à un auteur, fût-il auteur de San-Antoniaiseries » et qu’elle lui permettait de « se sentir compris, donc moins seul ». J’en fus évidemment flatté. Nos relations en sont restées là mais je me suis toujours intéressé au personnage, très attachant. J’aimais bien sa façon de dire :
« Il est quand même ahurissant que les hommes aient aussi peu de temps à passer sur cette terre et qu’ils consacrent une telle énergie à s’emmerder les uns les autres !… ».
Et je comprends parfaitement son souci de placer sa tombe, au cimetière de Saint-Chef (Isère), de telle sorte que, debout, on puisse voir le Mont-Blanc.
Je n’ai pas continué à lire tous les San Antonio suivants, ayant beaucoup de retard à rattraper dans d’autres domaines. Mais cette cure initiale avait suffi pour que, peu à peu, se fît jour une vocation : j’allais devenir commissaire de police. L’idée que je me faisais du métier était somme toute assez simple : comme Maigret, je fumerais la pipe et je percerais tous les secrets de la psychologie humaine ; comme San Antonio, je ne craindrais personne dans l’action et les femmes tomberaient dans mes bras au premier regard.
Je n’étais pourtant pas totalement inconscient et voyais bien que la police avait une autre réalité : les fumées lacrymogènes de 1968 commençaient à faire pleurer les manifestants. Mais cela ne me gênait pas vraiment. Je voulais entrer dans la police judiciaire, la vraie, celle de mes héros favoris, et ne m’intéressais guère aux barricades. D’ailleurs si, pour devenir un super-flic, il fallait accepter de faire partie du même corps que les Renseignements Généraux et les CRS, et bien je l’acceptais. Après tout, mes fréquentations de la Fac de droit ne m’avaient pas vraiment préparé à apprécier les débordements gauchistes.
Certes, je ressentais confusément la pesanteur des années gaullistes, je vivais mal la télévision sous tutelle, je trouvais choquant que la justice fût aux ordres, bref, comme toute une génération, j’avais du mal à respirer dans une société bloquée. Cependant, je n’avais aucune envie de « jouer à la Révolution » avec les apprentis maos, trotskistes ou anars divers, qui tenaient alors le haut du pavé. J’avais comme le pressentiment qu’il y avait du danger dans l’air.
Bien des années plus tard, Renaud, dans l’une de ses plus jolies chansons (Son bleu), fera méditer en ces termes un ouvrier communiste victime de l’injustice sociale, dont le fils est parti faire la révolution au Nicaragua :
« Mon enfant a compris, mieux que moi, le bonheur de faire péter tout ça ».
Pour ma part, quoique fort peu politisé à l’époque, j’avais déjà plus ou moins la conviction que « le bonheur de faire péter tout ça » est finalement assez éphémère, que, même parée des atours de la générosité, la haine est mauvaise conseillère et que le réveil est difficile, au lendemain des grands soirs. Je devais le vérifier très concrètement par la suite lorsque j’aurais en face de moi les militants d’Action Directe et, évidemment à un tout autre niveau, les responsables Khmers Rouges.
C’est ainsi que, après avoir observé pendant un mois avec scepticisme les manifs étudiantes, je me joignis sans état d’âme à celle de tout le peuple de droite, le 30 mai 1968. Simple façon pour moi de dire qu’il était temps de siffler la fin de la récréation. Ce qui d’ailleurs ne m’empêchera pas quelque temps plus tard de fredonner, comme tout le monde, les chansons gentiment subversives de Georges Moustaki (« tout est possible, tout est permis… ») ou de Maxime Le Forestier (« j’crois qu’on engage dans la police, parachutiste… »). Les contradictions ne me faisaient pas peur.
Finalement, ayant à cette époque fait la connaissance de celle qui allait devenir ma femme, je suis parti avec elle à St Tropez. C’était en quelque sorte une autre façon de chercher, sous les pavés, la plage. La mer n’a jamais été aussi propre qu’en juin 68. Le sable était immaculé et il n’y avait personne à l’horizon. N’ayant lu ni Marcuse ni Reich, c’est tout à fait inconsciemment que je me disais que Sea, Sex and Sun était un programme révolutionnaire qui en valait un autre.
ST CYR AU MONT D’OR, 1970
Dans un récit plein d’autodérision, Pierre Jourde a expliqué que son service « militaire » avait pour l’essentiel consisté à faire semblant de classer des fanions dans le Fort de Vincennes. Le mien, accompli à la Base ...