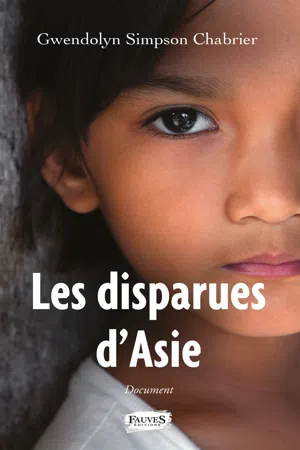![]()
CHAPITRE III
Exploitation des enfants
dans la société indienne
Le patriarcat en Inde
Au cours des siècles, les femmes et leurs progénitures ont été en Inde victimes du patriarcat. Le karma, sanctifié par l’hindouisme et légitimé par Manu, voulait que la femme soit prédisposée à une condition d’esclave, alors que l’homme était comparé à un saint, vénéré dans cette vie et dans l’autre. D’après Manu, un homme peut conquérir le monde s’il devient père d’un fils et l’éternité s’il devient grand-père d’un fils, et s’il devient arrière grand-père d’un fils, il connaîtra un bonheur éternel (Prabhu 242). Le rôle subalterne de la femme saute aux yeux dans le domaine privé et professionnel de toutes les communautés : elle doit constamment lutter pour affirmer son aspiration à l’égalité. L’Inde devient chaque jour plus consciente de la disparité entre les sexes et entre les castes et ce sera à travers l’éducation et la promulgation de lois que le pays pourra résoudre les flagrantes inégalités que subissent les femmes et leurs filles. À cet égard, Charles Fourier a signalé que l’on peut estimer le niveau d’une civilisation par la position sociale et politique de ses femmes. Si cela est vrai, on ne peut qu’espérer que les femmes puissent retrouver la position qui était la leur dans l’Inde ancienne, tout comme elle l’était d’ailleurs dans la Chine ancienne. Les mouvements féministes et les nombreuses associations qui défendent les droits des femmes comme SEWA se consacrent à pourvoir aux besoins et aux exigences de nombreuses femmes à travers tout le pays. Ainsi, grâce aux programmes d’alphabétisation et d’aide financière, les femmes réussissent à améliorer peu à peu leur condition et amènent la prochaine génération à une prise de conscience en créant les conditions d’une réelle amélioration de leur qualité de vie.
Il y a différentes théories décrivant la naissance du système des castes en Inde, toutefois on suppose qu’il naquit avec les colonisateurs Aryens à la peau claire et aux traits fins de la période védique qui, arrivés aux alentours de 1500 av.J.-C. par le nord de l’Inde à travers les montagnes de l’Hindou Koush, envahirent le pays durant deux siècles ; on présume que c’est alors qu’ils formulèrent la théorie des Varna. Ces conquérants aryens parlant le sanskrit venaient du sud de l’Europe ou du nord de l’Asie ; d’après les Védas, ils étaient agressifs et protégés par des divinités comme Agni, le dieu du feu, sacrificiel ou Indra, le dieu de la foudre. Il semble qu’ils arrivèrent en Inde sur des chars tirés par des chevaux et qu’ils écrasèrent les peuplades indigènes appelées, à cause de leur peau sombre, dasa ou dasyus dans les Védas et dans le Manusmrti. Les Aryens soumirent ces populations appartenant aux sociétés dravidiennes antérieures de la vallée de l’Indus et du Punjab et étendirent leurs conquêtes jusqu’aux plaines de Delhi. Dès lors, ces dasa primitifs à la peau foncée et au nez épaté furent réduits en esclavage ou asservis, à moins qu’ils ne réussissent à fuir dans les montagnes ou dans la jungle, en tous cas vers le sud.
Bien vite, les conquérants védiques semi-nomades constituèrent la structure de ce nouveau monde qu’ils avaient occupé dans le but de renforcer leur domination liée à la pureté de leur race pour la perpétuer. Le système des castes qu’ils avaient mis en place s’accordait parfaitement avec leur religion, car la théorie des Varna était partie intégrante des textes védiques. D’après le Purusha Sukta, l’un des derniers hymnes du Rig Véda, après le sacrifice de Purusa accompli par les dieux, c’est des différentes parties de son corps que proviennent les quatre varnas : les Brahmanes de ses mille têtes, les Kshatriyas de ses bras, les Varshyas de ses cuisses, et les Sudras de ses pieds ; la hiérarchie des castes étant déterminée par l’ordre décroissant des organes. De la même manière, les chants védiques trouvent leur origine dans son sacrifice.
La société indienne a évolué, fragmentée en quatre groupes hiérarchiques : d’abord les Brahmanes, des religieux et des savants, suivis par les Kshatriyas, des guerriers, des nobles et des politiciens ; puis, il y a les Varshyas, des paysans et des marchands et enfin, tout au bas de l’échelle, les Shudras, des serviteurs rétribués, qui étaient jadis des agriculteurs, des éleveurs ou des artisans dont le premier devoir était de servir les castes supérieures qui ne représentaient alors, comme de nos jours d’ailleurs, que 15 % de la population. Ces quatre varnas étaient nommés savarna. Les Intouchables par contre, appelés avarna ce qui signifie sans caste, restaient en-dehors du système : on les jugeait impurs, exerçant des métiers polluants ; ils étaient chargés de la crémation ou de l’entretien des latrines, ou bien c’étaient des porteurs de cadavres, des éboueurs, des cordonniers ou des balayeurs de rue.
Les membres des trois plus hautes castes se nommaient aussi des dvijas ou « deux-fois-nés ». Un jeune membre de ces castes, à l’âge de huit, onze ou douze ans, renaît, mais spirituellement ; on lui remet le fil sacré et on l’initie aux mystères de l’hindouisme ; il aura alors accès à l’étude des Védas et des autres textes sacrés.
Les femmes, quelle que soit leur caste, tout comme les Shudras et les Intouchables, restent des “une-fois-nées” ; selon la tradition, elles n’auront accès ni aux textes sacrés ni aux accessoires liés à la religion. Elles n’avaient autrefois même pas la possibilité d’espérer une meilleure condition après la réincarnation. Car d’après Manu :
XI. 36-37. Une femme n’est pas autorisée à accomplir les oblations prescrites par les Védas. Si elle le fait, elle ira en enfer.
L’hindouisme a toujours considéré les femmes moins pures que les hommes tout simplement parce que l’idée de souillure a toujours été liée aux menstruations, à l’accouchement et d’une certaine manière aussi au veuvage. Toutefois, dans les castes les plus basses, il n’y a jamais eu vraiment de distinction entre pureté et impureté, les femmes étant forcées de travailler pour gagner leur vie, contrairement aux femmes des castes les plus hautes. Qu’elles travaillent dans les champs, comme sage-femmes, comme femmes de ménage, ou dans des lieux de traitement des ordures pour ne citer que quelques exemples, on considère qu’elles sont plus exposées à la pollution.
Autrefois, avant les lois de Manu, non seulement les femmes pouvaient choisir leur mari et si elles étaient veuves elles pouvaient se remarier, mais en plus elles étaient profondément respectées dans la société. On a vu à travers les Shranta Sutras que les femmes, tout comme les hommes, répétaient les mantras des Védas et qu’on leur enseignait comment les lire. Elles fréquentaient les écoles, finissant même parfois à enseigner les Védas à leurs élèves filles. On appréciait leur aptitude à débattre avec l’autre sexe sur tous les sujets, y compris la religion, la philosophie ou la métaphysique. Ambedkar, le célèbre leader des Intouchables, estimait que ces lois qui neutralisaient les femmes et les Sudras leur avaient été imposées car il s’agissait des deux principaux groupes qui, à l’époque de la domination aryenne, cherchaient refuge dans la foi bouddhiste et il fallait donc les contrôler car ils menaçaient la religion brahmanique.
Si l’on étudie de plus près les lois du ManuSmriti, on comprend mieux dans quelle mesure les femmes à tout âge ont été dévalorisées et doivent lutter pour obtenir à nouveau respect et parité. C’est chez les Intouchables et les Sudras qu’elles sont le plus vulnérables, se trouvant au bas de l’échelle sociale, économique et religieuse. D’après les lois :
II. 213. Il est dans la nature du sexe féminin de chercher ici-bas à corrompre les hommes, et c’est pour cette raison que les sages ne s’abandonnent jamais aux séductions des femmes.
II. 214. En effet une femme peut en ce monde écarter du droit chemin, non seulement l’insensé, mais aussi l’homme pourvu d’expérience et le soumettre au joug de l’amour et de la passion.
En un mot, Manu a décrit les femmes comme des tentatrices diaboliques et séductrices ayant une influence néfaste sur les hommes. Il faut donc les tenir en captivité et les priver de toute autonomie. En plus d’être asservies à leur père, leur mari ou leurs fils, Manu a ajouté que :
V. 147. Une petite fille, une jeune femme, une femme avancée en âge ne doivent rien faire suivant leur propre volonté, même dans leur maison.
V. 149. Pendant son enfance, une femme doit dépendre de son père et pendant sa jeunesse, de son mari ; son mari étant mort, elle dépendra de ses fils ; si elle n’a pas de fils, des proches parents de son mari, ou, à défaut, de ceux de son père ; si elle n’a pas de parents paternels, du souverain ; une femme ne doit jamais se gouverner à sa guise.
De plus, les femmes n’avaient pas le droit de divorcer.
Selon Manu, une femme était en fait une appendice de l’homme, c’est-à-dire totalement contrôlée par lui. À propos du divorce, il faut préciser qu’un homme marié continuait d’être libre, ce n’est que la femme qui était liée à son mari, devenant à tous les effets l’esclave de son mari.
IX. 46. Une femme ne peut être affranchie de l’autorité de son époux, ni par vente, ni par abandon […]
Comme elle appartenait à son époux, que celui-ci la répudie ou la vende, elle restait liée à lui pour toujours et ne pouvait jamais, d’après la loi, devenir la femme légitime d’un autre homme même s’il l’avait achetée. Selon le ManuSmriti, une épouse devenait une esclave à tous les effets :
VIII. 416. Une épouse, un fils et un esclave sont déclarés par la loi ne rien posséder par eux-mêmes ; tout ce qu’ils peuvent acquérir, est la propriété de celui dont ils dépendent.
D’après le ManuSmriti, le mari était même autorisé à battre sa femme :
VIII. 298. Une femme, un fils, un domestique, un élève, un frère du même lit, mais plus jeune, peuvent être châtiés, lorsqu’ils commettent quelque faute avec une corde ou une tige de bambou.
Pour conclure, Manu a enfermé les femmes, surtout celles des castes les plus basses dans un système patriarcal sanctionné par la religion dans lequel l’époux, souvent bigame, était son Dieu :
V. 154. Même si la conduite de son époux est blâmable et qu’il se livre à d’autres amours, même s’il est dépourvu de qualités, une femme vertueuse doit constamment le révérer comme un Dieu.
Des siècles plus tard, les femmes en Inde, surtout celles des castes les plus basses, luttent sans relâche pour se libérer des entraves de Manu.
Cette admiration forcée pour les hommes, entérinée dès l’époque de Manu, apparaît aussi dans certaines coutumes religieuses des Dalits. Par exemple, les femmes mariées de la communauté des mahars, l’une des castes les plus basses, doivent jeûner deux fois par an pour assurer le salut de leur époux ; elles célèbrent leVat Savitri vers le mois de mai ou de juin en faisant sept fois le tour d’un bananier, arbre de culte, avec un cordon sacré “bénissant sept fois la chance d’être mariée avec le même mari”.
Un article paru en 2010 dans l’Economist se référait à la prédominance masculine de la population comme étant le résultat d’un “féminicide dû aux avortements des bébés de sexe féminin. Les motifs sont purement économiques : non seulement les salaires des hommes sont supérieurs à ceux des femmes mais en plus, ni l’Inde ni la Chine n’ont de plan de retraite universelle et c’est aux fils de pourvoir aux besoins de leurs vieux parents. Ils héritaient en fait les affaires et la fortune de la famille. Autrefois, seules les familles de sang royal observaient les règles de primogéniture et, dans le reste de la société, les fils se partageaient l’héritage à part égale. Bien que de nos jours, tout comme en Chine, les filles aient droit à l’héritage, il leur faut souvent bien du courage pour défendre leurs droits auprès des tribunaux. Il y a une vingtaine d’années le prix d’une épouse fut substitué par la dot : les femmes représentèrent alors un fardeau financier vu qu’elles signifiaient une dot et les frais d’un mariage, payé en général par leurs parents. Toutes proportions gardées, on s’attend souvent à une dot assez substantielle : dans les hautes classes plus riches et cultivées, les parents sont supposés acheter une affaire ou un appartement parfois même une voiture au futur marié. Dans les castes les plus basses, plus pauvres et peu instruites, les parents peuvent par exemple donner une contribution pour l’instruction du futur époux ou bien offrir des bijoux ou du bétail. Pendant ce temps-là, la jeune fille vit avec sa future belle-famille et n’aide pas ses parents. On a pu compter à Delhi, entre l’an 2000 et 2005 jusqu’à soixante-six “décès de dot” : l’épouse était assassinée par sa belle-famille qui estimait sa dot insuffisante. Ces “décès de dot” sont plus fréquents dans les hautes castes et on observe par contre de nombreux suicides ou de nombreuses tentatives de suicide chez les futures épouses Harijan. Souvent, ces jeunes mariées s’aspergent de kerosène et mettent le feu. Lorsqu’on les emmène à l’hôpital, elles déclarent en général que leurs brûlures sont le résultat d’un accident domestique. Quoique très nombreux, ces décès ne sont en général pas enregistrés.
Vu l’augmentation des avortements féminins, le gouvernement a approuvé en 1994, la loi PSPNDT (Pre-Natal Diagnostic Techniques Act) visant à interdire les tests à ultrasons à huit dollars permettant de connaître ...