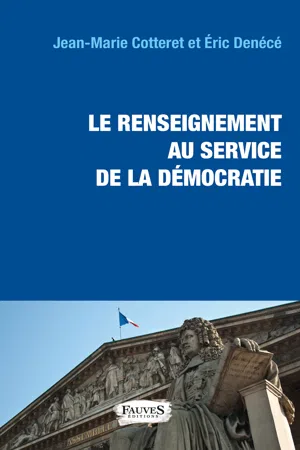![]()
Chapitre 1
Les évolutions récentes
du renseignement français
« Le renseignement est l’un des investissements les plus
rentables de l’État. Il est l’une des fonctions
fondamentales de la sécurité nationale de tout
État de droit et constitue une condition
nécessaire à la prospérité du pays. »
Michel Rocard, « Pour une politique de
renseignement » (Le Figaro, 6 mars 2008)
Depuis la chute de l’URSS et la fin de l’affrontement Est-Ouest, face aux évolutions de l’environnement international, les services de renseignement et de sécurité français se sont adaptés progressivement.
C’est la première guerre du Golfe (1991) et ses enseignements qui ont été le point de départ d’une prise de conscience plus affirmée du rôle du renseignement dans le monde d’après Guerre froide, seul capable de conférer une autonomie de décision au gouvernement lors des crises internationales. L’année 1992 vit ainsi la création de la Direction du renseignement militaire (DRM) et la mise sur pied du Commandement des opérations spéciales (COS).
L’autre événement majeur qui a conduit à une évolution du renseignement français est la lutte antiterroriste. Celle-ci n’a toutefois pas débuté avec les attentats du 11 septembre 2001, mais est une priorité des services du ministère de l’Intérieur depuis le milieu des années 1980. Le nouveau djihadisme a cependant accru cette tendance.
Depuis le milieu des années 1980, la France a cherché à s’adapter à l’évolution de la menace en créant des structures communes ou spécialisées au sein des ministères de l’Intérieur ou de la Justice (UCLAT, 14e section du parquet, etc.), en adaptant la législation antiterroriste : centralisation et spécialisation des poursuites, de l’instruction et du jugement concernant les affaires de terrorisme auprès du parquet antiterroriste de Paris. Les pouvoirs des enquêteurs ont par ailleurs été renforcés.
À partir de 1995, l’instabilité de la situation en Algérie, et ses conséquences pour notre sécurité ont conduit à une seconde phase d’adaptation. Les réformes de 1996 ont instauré de nouvelles dispositions juridiques antiterroristes : neutralisation préventive des réseaux grâce à la création de l’« infraction pour association de malfaiteurs en vue d’un acte terroriste », dans laquelle c’est le but poursuivi qui est condamnable et non plus l’infraction en tant que telle. Cela a permis de neutraliser et de condamner des réseaux terroristes avant leur passage à l’acte. Toutefois, la police judiciaire étant de plus en plus accaparée par le terrorisme domestique (Corses, Basques, etc.), ce sont les services de renseignement intérieur (RG, DST) qui s’investirent dans la lutte contre le terrorisme islamiste radical, en liaison constante avec le parquet et en développant la coopération internationale.
Puis, l’affaire du gang de Roubaix, en 1996, a été un élément révélateur de l’évolution de la menace, celle-ci n’étant plus liée aux terroristes du GIA algérien, mais à des Français de souche convertis à l’islam radical et à des immigrés maghrébins de la deuxième génération vivant sur notre sol ; tous ayant été formés et étant allés combattre en Bosnie ou en Afghanistan, et appartenant à une nébuleuse aux vastes ramifications internationales.
La montée en puissance des menaces a conduit à accroître la coordination des services anti-terroristes. Celle-ci s’est faite à la fois au niveau du ministère de l’Intérieur (UCLAT), du Premier ministre (CILAT) et de la présidence (CSI). Les réunions entre les autorités et l’ensemble des services concernés se sont révélées particulièrement utiles pour assurer l’évaluation de la menace, le partage des informations opérationnelles, la coordination des actions et pour préparer les décisions relatives à la planification de sécurité (plan Vigipirate).
Toutefois, les années 2000-2007 se sont caractérisées par une baisse des budgets consacrés au renseignement, alors même que depuis les tragiques événements du 11 septembre 2001, les besoins ne cessaient de s’accroître.
Les réformes du quinquennat Sarkozy (2007-2012)
C’est principalement à partir de 2007 et l’arrivée de Nicolas Sarkozy à l’Élysée qu’une nouvelle organisation et un nouvel encadrement du renseignement français a vu le jour.
Pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, le renseignement a fait l’objet d’un intérêt présidentiel. Déjà, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur (2002-2004 et 2005-2007), Nicolas Sarkozy avait tenté de procéder à certaines réformes : fusion de la DST et des RG, mise en place d’une commission parlementaire chargée du renseignement, etc. Mais ses différends personnels avec le président Jacques Chirac ne permirent pas leur aboutissement.
En 2007, aussitôt élu à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy relança ces initiatives. Il les compléta par une dizaine d’autres réformes qui furent menées à bien au cours des trois années suivant son arrivée à l’Élysée :
– Mise en place d’une délégation parlementaire pour le suivi des affaires de renseignement (2007) ;
– Fusion de la DST et de la DCRG au sein d’un nouveau service, la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) (2008) ;
– Création concomitante de la Sous-direction de l’information générale (SDIG) ;
– Publication du Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité nationale (2008) ;
– Création du Conseil national du renseignement (CNR) et de la fonction de Coordonnateur national du renseignement (2008) ;
– Réforme du Conseil de Défense et de Sécurité nationale (CDSN) (2008) ;
– Réforme du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) (2008) ;
– Création de nouvelles structures de renseignement et de sécurité intérieurs (ANSSI et SIRASCO, 2009) ;
– Amélioration de la formation et de la gestion des carrières, se traduisant notamment par la création d’une Académie du renseignement (2011) ;
– Accroissement des budgets du renseignement ;
– Enfin, introduction dans le projet de loi sur la sécurité intérieure (LOPSI) d’un article portant « Création d’un régime de protection des agents de renseignements, de leurs sources et de leurs collaborateurs », ainsi que des lieux classifiés et des archives sensibles.
Ces mesures ont été accompagnées par la nomination de professionnels reconnus à la tête des services du ministère de l’Intérieur (Bernard Squarcini pour la DCRI, Frédéric Péchenard pour la police nationale), ce qui n’a toutefois pas été le cas pour les autres services ni pour les organes de coordination, illustrant là le fort tropisme policier du nouveau président.
La première mesure relative au renseignement prise à l’occasion du nouveau septennat a été la création d’une Délégation parlementaire officialisée le 9 octobre 2007 par la loi n° 2007-1443. Cette création a été une évolution extrêmement positive. En effet, instaurer une démarche de suivi des affaires de renseignement par la représentation nationale était à la fois une nécessité pour notre démocratie et pour notre sécurité. Car, comme le déclarait François Fillon, alors Premier ministre, « l’action du renseignement est plus que jamais nécessaire. Mais plus que jamais aussi, l’idéal démocratique nous invite à la rigueur déontologique. Entre démocratie et renseignement, l’histoire nous apprend que les relations n’ont pas toujours été sereines ».
La Délégation, composée de huit membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, peut entendre tous les directeurs des services, tout membre des administrations œuvrant dans le domaine du renseignement et tout expert extérieur qu’elle souhaite. Ainsi, elle pourra confirmer aux deux chambres que le gouvernement et les services s’acquittent honorablement de leurs missions respectives. Sinon, il lui conviendra de dénoncer tout manquement à leurs obligations. Lorsque des dysfonctionnements seront observés, la commission n’interviendra pas. Elle alertera la présidence de l’Assemblée ou du Sénat afin que l’une ou l’autre en informe les autorités compétentes (présidence de la République, Premier ministre, ministre de la Justice, etc.). Mais ces dysfonctionnements ne seront pas communiqués à l’Assemblée. En fonction des faits observés, une commission d’enquête parlementaire pourra être mise en place, mais l’enquête et les propositions de sanction ne relèveront pas de la commission chargée du renseignement.
Au-delà de la transparence nécessaire dans une démocratie, la mise en place d’une telle délégation a permis le développement de la connaissance du rôle et des pratiques du renseignement auprès des parlementaires, qui ne s’en préoccupaient guère jusqu’à lors. Un contrôle parlementaire intelligent permet de sensibiliser les élus au renseignement et d’obtenir leur soutien afin de disposer des budgets nécessaires à leurs missions, sans pour autant porter atteinte à l’indispensable confidentialité nécessaire au succès de leurs entreprises. Mais les parlementaires doivent répondre à deux impératifs a priori antagonistes : apporter plus de transparence quant aux missions et aux moyens des services, sans toutefois perturber leur fonctionnement ni intenter au secret de leurs activités. Une chose est sûre : il ne s’agit aucunement de s’intéresser aux actions en cours. Les opérations clandestines de renseignement et d’action, comme le nom des sources secrètes, n’ont pas à être portées à la connaissance des parlementaires et encore moins à celle de l’opinion publique. La vie des officiers, des agents et les intérêts de la nation en dépendent.
La second...