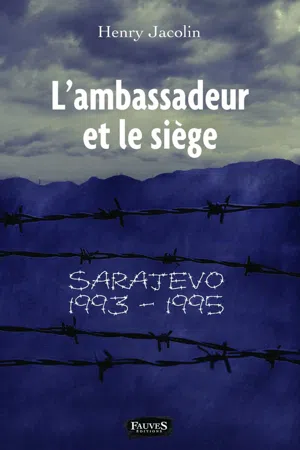![]()
1. De Fidji à Sarajevo
Fin 1992 – début 1993
La radio et la télévision de Sarajevo ont diffusé en boucle pendant toute la journée du 12 février 1993 la cérémonie de remise de mes lettres de créance au président de la République de Bosnie-Herzégovine, M. Alija Izetbegović. La cérémonie s’est déroulée à 10 heures 30 dans le palais de la présidence, qui abrite plusieurs ministères. Un avion militaire français, dans lequel j’avais embarqué à Orléans, m’avait amené directement à Sarajevo. J’y avais été accueilli par des casques bleus français de la Forpronu, qui m’avaient conduit dans un véhicule de transport blindé tout droit à la présidence, un gros bâtiment triste de style autrichien. Les premières images de Sarajevo s’impriment dans ma tête : maisons bordant l’aéroport entièrement détruites, franchissement d’un check point tenu par les Bosno-Serbes, carcasses de voitures le long de l’interminable avenue baptisée « allée des snipers », et surtout, personne dans les rues, une ville déserte, comme si elle était inhabitée.
Arrivé à la présidence, j’ai à peine le temps de remettre à la chef du protocole la copie figurée de mes lettres de créance, que je suis introduit dans le grand salon où le président m’attend, debout, entouré d’un grand nombre de personnes. Je reconnais le général Morillon, qui commande la Forpronu en Bosnie-Herzégovine (BH). Il a troqué ce jour-là le treillis vert olive des casques bleus pour son uniforme français.
Je prononce en serbo-croate la formule rituelle et remets mes lettres au chef de l’État. Applaudissements nourris, ce qui est plutôt insolite en pareille circonstance. Mais, pour ces hommes et ces femmes, qui avaient l’impression que le monde entier les avait oubliés, le fait qu’un grand pays européen ait accrédité un ambassadeur en BH, que la France reconnaisse comme allant de soi la République de BH, c’était l’amorce d’un espoir. La formule traditionnelle que j’avais prononcée était, dans cette circonstance exceptionnelle, bien plus que rituelle.
Le président m’installe alors face à lui pour un entretien en tête à tête, qui a duré une heure, et qui porte d’abord sur l’action de la France en BH. La veille, quatre soldats français de la Forpronu, dont l’un est mort, avaient été attaqués sur la piste de l’aéroport de Sarajevo. Il me demande de présenter ses condoléances au gouvernement français et m’indique qu’il a demandé une enquête sur cet incident (dont on ne savait pas encore qu’il avait été provoqué par l’artillerie bosniaque). Il se félicite de la décision de la France d’accréditer un ambassadeur en BH. Ma nomination, lui dis-je, s’inscrit dans la ligne des efforts déployés par la France pour tenter de rétablir la paix en BH : envoi de soldats français sous béret bleu, visite du Président de la République François Mitterrand à Sarajevo le 28 juin 1992, engagement actif de la France dans l’aide humanitaire, initiatives répétées de M. Kouchner, dont on attendait l’arrivée à Sarajevo, pour procéder à un échange de prisonniers. M. Izetbegović indique que tant le gouvernement que les organisations non gouvernementales françaises avaient fait preuve de beaucoup plus de sensibilité à l’égard de son pays que les autres nations.
Je demande ensuite au Président son sentiment sur les six points du plan américain de règlement du conflit, que Washington avait rendus publics deux jours avant. Question difficile dont je traite plus loin.
M. Izetbegović lance alors l’entretien sur la poursuite par les Bosno-Serbes de l’épuration ethnique et le blocage par ceux-ci de l’aide humanitaire en Bosnie orientale, qui constituait la préoccupation la plus urgente à Sarajevo. L’incapacité du Haut-Commissariat pour les Réfugiés de l’ONU (HCR) à acheminer cette aide avait provoqué à Sarajevo, dans les jours qui ont précédé mon arrivée, un sursaut d’indignation de l’opinion publique. Par solidarité avec leurs concitoyens de Bosnie orientale, les habitants originaires de cette région, qui s’étaient réfugiés à Sarajevo pour fuir les exactions des Bosno-Serbes, avaient lancé un mouvement de boycott de l’aide alimentaire fournie par le HCR. Cette initiative avait été reprise à son compte par le gouvernement de BH, qui y voyait un moyen de faire pression sur la communauté internationale. La poursuite de l’épuration ethnique en Bosnie orientale avait d’ailleurs provoqué la suspension le 10 février de la négociation à New York qui avait repris le 5 février.
Il faut accentuer les efforts pour faire parvenir l’aide alimentaire à la Bosnie orientale, me dit le Président. Vingt personnes y meurent chaque jour, faute de nourriture et de médicaments, car les convois du HCR sont bloqués par les tchetniks qui assiègent cette région. Ces convois devraient passer. Mais la décision de l’ONU n’est pas mise en œuvre avec assez d’énergie, comme cela avait été convenu. Il est donc nécessaire que soit votée une nouvelle résolution relative à la mission de la Forpronu, imposant que les convois d’aide humanitaire soient escortés, martèle le Président. Si le général Morillon discute avec les tchetniks, il perd son temps, car le seul programme des tchetniks est la purification ethnique. Le monde doit être informé du double jeu des Serbes.
C’est la raison pour laquelle, poursuit le Président, a été prise la décision de ne plus accepter l’aide humanitaire par solidarité avec les habitants de l’est qui n’ont jamais rien reçu. Cette décision n’est pas celle du gouvernement, mais celle spontanée du peuple de Sarajevo. Je tente de dissuader le Président Izetbegović de mettre en œuvre cette décision : « il ne sert à rien d’ajouter des affamés à d’autres affamés ». Mais il me répond que la morale et la logique ne font pas toujours bon ménage.
Ce boycott de l’aide alimentaire avait produit quelques remous dans la communauté internationale, puisque le HCR avait décidé unilatéralement le 17 février de suspendre la distribution de l’aide alimentaire, provoquant la colère du Secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros Ghali. Le Conseil de Sécurité a en effet voté le 21 février la résolution 807 autorisant les casques bleus à recourir à la force, ce qui a conduit les États-Unis, s’abritant derrière cette résolution, à décider le 23 février de parachuter des vivres en Bosnie orientale.
Rappelant, en prenant congé, que la France soutient le plan Vance-Owen, j’invite la BH à faire preuve d’une volonté de compromis pour permettre un arrêt du conflit. Je ne suis pas sûr d’avoir été écouté. J’ai le sentiment que les Bosniaques, ayant « empoché » la désignation par les Américains des Serbes comme agresseurs, continuent d’espérer que le blocage de la négociation à New York, la reprise des combats et la poursuite de l’épuration ethnique conduiront les pays occidentaux à tirer un jour la conclusion qu’impose désormais l’avancée que constitue l’équation Serbie = agresseur.
Je n’étais pas le premier ambassadeur à présenter mes lettres de créance. M’avaient précédé celui de la Croatie, qui s’était installé à Mostar, c’est-à-dire en zone contrôlée par les Bosno-Croates, mais qui résidait en fait la plupart du temps à Zagreb, et celui du Danemark. Le ministre des affaires étrangères de ce pays, qui présidait au premier semestre 1993 la Communauté Européenne, avait profité de la visite qu’il avait faite en janvier à Sarajevo pour amener avec lui l’ambassadeur du Danemark à Vienne et le faire accréditer en BH. Mais celui-ci, rentré à Vienne le même jour, n’est jamais revenu.
Le président François Mitterrand n’était pas un inconnu à Sarajevo. Il y avait fait une visite surprise le 28 juin 1992, sensible aux arguments des intellectuels français, notamment de Bernard-Henri Lévy, et fortement encouragé par Bernard Kouchner, ministre des affaires humanitaires. Il avait obtenu l’ouverture d’un couloir humanitaire. Dans l’avion qui le ramenait à Paris, il avait demandé que le Quai d’Orsay nomme un ambassadeur en Bosnie-Herzégovine. Le sort était tombé sur moi. Pas tout à fait par hasard. Car je connaissais bien la Yougoslavie. Grâce à une bourse de voyage Zellidja, j’avais parcouru ce pays en 1958 pour y étudier la géopolitique des chemins de fer. La direction des chemins de fer yougoslaves avait été très coopérative : elle m’avait remis un laisser-passer demandant aux cheminots de me faire bon accueil, offert un billet me permettant de sillonner ce pays du nord au sud, et donné l’autorisation de faire un millier de kilomètres sur des locomotives. C’est sur une locomotive à voie étroite et à crémaillère que j’ai effectué le parcours de Sarajevo à Mostar. En 1961, j’avais perfectionné à l’université de Zagreb l’étude du serbo-croate entreprise à l’école des langues orientales. Enfin, après avoir passé le concours d’Orient du Quai d’Orsay, j’avais été affecté à notre ambassade à Belgrade de 1972 à 1974. Chargé des relations avec la presse, j’avais visité les rédactions des journaux et de la télévision de toutes les républiques. J’avais suivi de près la crise du nationalisme croate en 1972, première manifestation du conflit qui allait ébranler ce pays vingt ans plus tard. J’étais alors à cent lieues de penser que je serais un jour le premier ambassadeur dans une Bosnie et Herzégovine indépendante !
Au début de septembre 1992, le directeur du personnel du Quai d’Orsay m’appelle à Fidji, où j’étais en poste depuis 1990, pour me proposer le poste d’ambassadeur en BH. Je demande quelques jours de réflexion pour en parler avec ma femme. Mais, dans mon for intérieur, j’avais déjà accepté. Ma femme, qui connaissait la Yougoslavie et qui parlait le serbo-croate, avait conscience des risques de ce poste. Pour la rassurer, je lui rappelle ce que Georges Kiejman, secrétaire d’État aux affaires étrangères, nous avait dit deux mois plus tôt, en juillet, lors d’un cocktail donné à l’occasion de la réunion des hauts fonctionnaires du Pacifique sud à Nouméa : « la guerre, elle ne durera pas plus de six mois ». Se fiant à son intuition, ma femme n’avait pas été convaincue. Mais elle a finalement accepté cette décision. J’en fais part aussitôt au directeur du personnel.
Dès lors, je suivais la situation en BH au jour le jour, constituant un dossier avec les articles du Monde et de Libération. Et je me préparais mentalement à rejoindre ce nouveau poste. Je ne pouvais faire état publiquement à Fidji de cette nomination, la règle voulant qu’elle ne soit annoncée qu’une fois obtenu l’agrément de la BH, lequel n’a été rendu public que le 8 janvier 1993. Aussi, le temps manquant, je n’ai pu aller faire mes adieux, dans les États où je représentais la France, sinon à Tonga qui n’était qu’à une heure de vol. Aller à Tuvalu ou à Nauru requérait deux ou trois jours, à Kiribati, qui était à 3 700 kilomètres, quatre ou cinq jours, car il n’y avait pas un avion quotidien. J’ai pu toutefois informer discrètement le Premier ministre de Tuvalu lors d’un dîner que je lui ai offert à la résidence à l’occasion d’une visite qu’il effectuait à Fidji.
Avant de partir, nous avons subi le cyclone Kina qui a ravagé Suva, la capitale, les 2 et 3 janvier 1993. Comme il avançait très lentement, signe précurseur de sa puissance, je faisais le point deux fois par jour avec le directeur de la sécurité civile et relayais l’information à Nouméa. Grâce à la coopération efficace du Haut Commissaire, Alain Christnacht, la France a été le premier pays de la région à faire atterrir à l’aéroport de Nadi un avion militaire porteur d’équipements de secours. Ce geste a été mis au crédit de notre pays, dont la politique en Océanie (essais nucléaires, « colonisation » de la Nouvelle Calédonie) était très critiquée par les États insulaires.
Tous mes interlocuteurs étaient conscients de ce qui m’attendait à Sarajevo. Le Premier ministre, Ratu Mara, un grand chef fidjien, à l’humour très britanni...