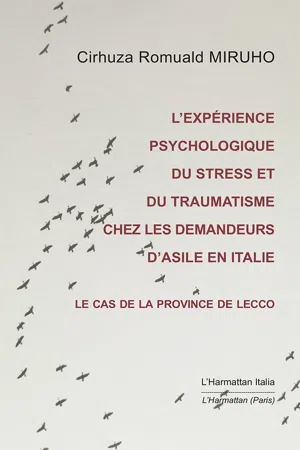
eBook - ePub
L'expérience psychologique du stress et du traumatisme chez les demandeurs d'asile
Le cas de la province de Lecco
- 158 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
L'expérience psychologique du stress et du traumatisme chez les demandeurs d'asile
Le cas de la province de Lecco
À propos de ce livre
Cet essai de recherche en psychologie clinique et en psychopathologie concerne le traumatisme du vécu des demandeurs d'asile dans les Pays d'accueil, avec une attention spécifique pour le cas de l'Italie du Nord. Selon l'auteur de cette étude, les migrants peuvent apprendre des stratégies pour mieux gérer leur condition de stress.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à L'expérience psychologique du stress et du traumatisme chez les demandeurs d'asile par Cirhuza Romuald Miruho en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Scienze sociali et Storia e teoria della psicologia. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
1. DÉFINITION DES CONCEPTS
IMMIGRÉ
Si « étranger » est la définition juridique d’un statut, « immigré » est avant tout une condition sociale, observe justement Abdelmalek Sayad.9
Le Larousse du XXe siècle dans son édition de 1931 donne comme définition du verbe immigrer : « venir se fixer dans un Pays étranger », et signale simplement l’usage du substantif « des immigrés ».10
Un migrant / immigrant est celui qui choisit de laisser volontairement son propre Pays d’origine pour chercher ailleurs un travail ou une meilleure condition économique. Il se déplace donc pour des raisons d’ordre économiques et sociales. Contrairement au réfugié (qui est celui à qui le statut de réfugié lui est reconnu à base de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés), il peut retourner à la maison en cas de sécurité.
Cette Convention définit à l’article 1 comme « réfugié » celui qui craint d’être persécuté pour des raisons de race, de religion, de nationalité, appartenant à un groupe social particulier ou à une opinion politique se trouve à l’extérieur du Pays dont il est citoyen et ne peut (…) tirer parti de la protection de ce Pays ; ou ne peut pas ou ne veut pas rentrer pour les raisons mentionnées ci-dessus.11
Parmi les immigrés demandeurs d’asile, beaucoup perdent leurs familles et amis, leur travail, leur logement, leur santé et parfois même leur santé mentale suite aux stress graves. Pour eux, l’inquiétude, la dépression et l’anxiété semblent être devenues un mode de vie. En effet, devenir immigré provoque chez beaucoup un véritable bouleversement psychique ainsi qu’une période de crise identitaire voire même de maturation psychologique. Le devenir immigré est une véritable crise d’identité au cours de laquelle sont réactivés des conflits antérieurs non résolus. Chaque immigré conçoit, vit cette réalité selon sa réalité présente et passée et cela selon son environnement mental, l’histoire de sa vie et ce qu’il ressent au-dedans de lui-même. Cela influence son développement ou sa vie « normal » ou « anormal ».
Sans la démocratie, ce sont des plans de pépinières d’immigrés qui s’arrosent tous les jours avec les conflits, les rébellions et autres formes de déstabilisation. Il existe plusieurs sortes d’immigrés, mais ce qui pose problème, c’est plutôt le large éventail d’immigrés qui viennent parce qu’il n’y a pas de stabilité politique dans leurs Pays. Il nous faut la démocratie, socle du développement des sociétés modernes. Avec cette réalité, nous avons une catégorie des immigrés par immigration choisie ou ceux qui ont choisis librement l’immigration et une autre catégorie appelée immigrés par immigration non choisie ou ceux qui ont été contraint par les événements, qui ont été obligés même sans eux à se trouver dans cette dernière catégorie. Ils n’ont pas choisi volontairement de se trouver dans cette situation. Autrement dit, il existe des immigrés par immigration volontaire et des immigrés par immigration involontaire. Quelque fois l’immigration s’impose comme un mal nécessaire quand elle s’impose à nous comme une issue pour espérer une vie normale.12 Nous avons aussi des immigrés qui ont quitté leurs Pays pour raison économique et d’autres qui ont fui les discriminations dont ils étaient victimes.13 À ce niveau, trois mots nécessitent une meilleure explication pour éviter certaines confusions. Il s’agit d’ASILE, REFUGE et ÉTRANGER.
ASILE, REFUGE, ÉTRANGER
L’asile désigne à l’origine une constellation de lieux sacrés servant de refuges à ceux qui se soustrayaient à un péril imminent. En grec ancien, asulos signifie « j’enlève, j’arrache ». Par la suite, la langue classique l’étendit « à tout lieu où l’on se met à l’abri d’un danger ». Et puis, au XVIIIe siècle, le mot a un sens affaibli, se référent essentiellement à des espaces consacrés à la vieillesse, aux infirmes et aux croyants, à des établissements de bienfaisance où l’individu part en retraite trouver protection et sérénité.
Le terme est ensuite utilisé pour désigner les espaces clos dédiés aux aliénés (« asile de fous »). En 1938, cette expression est remplacée par celle d’« hôpital psychiatrique », qui s’éloigne considérablement de la dimension de la paix, d’accueil inhérente au terme asile. L’asile, aujourd’hui encore, demeure néanmoins un lieu qui promet la sureté, et qui se destine à une population en situation précaire, et fragile.
On relève que dans l’évolution du mot asile, les dimensions de contrainte et d’enfermement se sont peu substituées à celles de repos et de paix. Enfin, et par extension, l’asile renvoie à un abri psychique, espace sécurisant destiné à un sujet en danger qui doit trouver un site pour continuer à vivre, un lieu protégé permettant l’accès à une paix psychique, pour s’extraire de persécutions externes ou internes.14
Le terme réfugié est issu du latin refugium – action de se retrancher et fuir –, et du verbe refugere qui signifie “reculer en fuyant, s’enfuir” et “chercher asile”. Il renvoie directement à la notion de refuge, un « lieu où l’on s’enfui, où l’on se retire pour être en sureté (…) et où se rendent les gens qui ne sont guère reçus ailleurs ».15 En ancien français, la racine de réfugié, refui, renvoie au fait de se soustraire hâtivement à un péril, à une menace, à quelque chose ou quelqu’un. Il est intéressant de relever que le radical fui signifiait au Moyen Age « encore vivant » résonnant ainsi avec la question de la survivance inhérente à la problématique des réfugiés. Pour autant, le verbe (se) réfugier s’utilise exclusivement à la forme pronominale : on se donne refuge à soi-même et par soi-même. Et si l’autre demeure indispensable à la délivrance d’un lieu sécurisant, sans une impulsion propre, le sujet ne pourra pas y accéder. Initialement, ce ne serait donc que par soi-même que l’on peut accéder à un tel abri.
Enfin, dans la littérature, le refuge est envisagé comme une quête pour habiter un lieu sécurisant, et véhicule fréquemment, dans le même temps, une dimension beaucoup plus incertaine qui appartient au registre de l’inconnu, voire de la mort. L’énoncé populaire : « il s’est réfugié dans la douleur » incarne ce paradoxe même où coexistent sauvetage et souffrance. Le refuge se constitue dès lors comme un objet ambivalent dans lequel la portée destructrice cohabite avec les notions de réconfort et de renaissance. Le réfugié entretient un double rapport au refuge, espace envisagé comme un site potentiellement réparateur et salvateur mais aussi vécu tel un lieu rejetant, mortifiant. L’expérience même de l’exil amplifie les séparations, les pertes et la douleur, tout en augurant dans le même temps d’une renaissance possible. Œdipe incarne cette figure du réfugié. Il s’est mutilé, continue pourtant à vivre mais souffre infiniment dans son exil, loin de son Pays et des siens.16
En effet, le terme réfugié recouvre la situation du demandeur d’asile aussi longtemps que sa demande de statut de réfugié n’a pas été accordée ou définitivement rejetée par les organismes décisionnels. Au regard de la Convention de Genève, il est donc considéré comme réfugié, qu’il bénéficie ou non de la reconnaissance de ce titre. Pourtant, on observe que dans la réalité juridique le terme réfugié est exclusivement réservé aux individus dont la qualité a été reconnue administrativement.17
Il est tout à fait évident que lorsque nous parlons des étrangers, de leur discrimination sociale, politique ou législative, ce n’est pas vrai pour les étrangers japonais, nord-américains, suisses ou autres étrangers qui tombent formellement dans la catégorie des « non-UE18 ». Même avant d’être discriminé dans ce cas, les migrants et les réfugiés sont victimes de discrimination par la langue que la société escorte pour les représenter. Un langage qui, tout en modifiant, maintient inchangée la caractérisation de ces êtres humains comme des étrangers : « immigrants », « non-UE », « clandestins », « irréguliers », « tiers monde », etc. Ces étiquettes, répandues à la fois dans le langage ordinaire, public, juridique, bureaucratique et politique, non seulement falsifient la réalité sociale et existentielle des migrants, mais catalysent toute sorte de sens négatif. Le migrant, grâce à ce langage d’exclusion, est, bien sûr, misérable, menaçant, disponible pour le crime.19
Qu’en est-il du statut juridique d’un étranger dans des arrangements constitutionnels ? L’étranger, en tant qu’homme, comparativement au citoyen du Pays d’accueil, bénéficie de ces droits reconnus dans les déclarations « universelles » sur les libertés fondamentales et les droits de l’homme. La déclaration historique des droits de 1789 stipule que « les hommes sont nés et restent libres et égaux en droits ». Ce qui énonce les deux fondements de la démocratie moderne : la liberté et l’égalité.20
DEMANDEUR D’ASILE
Le demandeur d’asile fait référence à un étranger qui fuit son Pays pour différentes raisons, il est inscrit dans une procédure visant à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié21 ou d’une autre forme de protection. Autrement dit, les demandeurs d’asile sont ceux qui, ayant quitté leur Pays d’origine et ayant demandé l’asile, attendent une décision de la Commission concernant la reconnaissance d’une forme de protection.22 Autrement dit, un demandeur d’asile est celui qui se trouve loin de son Pays et présente, dans un autre Pays, une demande d’asile pour la reconnaissance du statut de réfugié se référant à la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 ou pour obtenir autres formes de protection internationale. Jusqu’au moment de la décision finale de la parte des autorités compétentes, il est un demandeur d’asile et a droit à un séjour régulier dans le Pays de destination. Il n’est donc pas assimilable au migrant irrégulier ou clandestin même si il est dans le Pays d’asile sans documents d’identité valide.
Le demandeur d’asile qui est dans une précarité souvent généralisée ne cesse de demander. Quand le corps présente les stigmates de son vécu douloureux, il devient une cartographie de ses souffrances et des pertes multiples dont il n’a pas pu faire le deuil. Carapace de survie instaurée contre ses brisures traumatiques, le corps devient un site privilégié pour les affections traumatiques sans cesse actualisées par son parcours d’asile.23
2. LA RÉALITÉ « IMMIGRATION »
MOBILITÉ HUMAINE
La mobilité migratoire apparait comme un moyen d’affranchissement social et familial et comme un objectif de dépassement de soi.24 La mobilité, en tant que pratique géographique, occupe une place de plus en plus centrale dans le quotidien des individus migrants. Elle met en jeu son existence tout entière, en transformant sa façon d’être au monde, d’appartenir aux lieux, d’échanger avec les autres. Elle transforme cet être au Monde en créant un rapport dialogique entre individu et monde fondé sur la négociation, avec un projet, une stratégie et un certain capital à exploiter. Elle transforme cet être au monde en produisant une nouvelle spatialité, fondée sur la pluralité des appartenances géographiques et sur une tension dynamique permanente entre les lieux composant la géographie du migrant. Elle transforme cet être au monde en créant de nouveaux référents identitaires et culturels, fondés sur une éthique de la mobilité, qui sont appropriés et transmis par les migrants.
Cette place nouvelle de la mobilité, comme pratique, comme capital et comme culture, dans la vie quotidienne et dans la construction identitaire des migrants pose de façon urgente et particulièrement aigüe un problème plus général, dépassant probablement l’échelle des groupes migratoires.25
La mobilité n’est pas seulement une valeur : elle est presque obligatoire dans certains domaines. La mobilité est entrée silencieusement dans notre horizon quotidien.26 Une des implications de la mobilité est inévitablement la pluralité : nationale, linguistique, ethnique, culturelle, religieuse, raciale, des coutumes, de l’alimentation, des vêtements, des manières de comprendre la famille et les relations de genre, des échos et ainsi de suite.
La pluralité produit à son tour de nouvelles rencontres, et les nouvelles rencontres produisent aussi des heurts. Ainsi, la mobilité produit la pluralité, et la pluralité produit (aussi) des conflits : beaucoup dus au mécanisme des « identités réactives ».
Malgré les appels d’identités réactives, l’une des conséquences i...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Collana - Collection PSYKHÉ
- Titre
- Copyright
- SOMMAIRE
- SIGLES PRINCIPAUX
- PRÉFACE
- INTRODUCTION
- 1. DÉFINITION DES CONCEPTS
- 2. LA RÉALITÉ « IMMIGRATION »
- 3. STRESS ET TRAUMATISME CHEZ L’IMMIGRÉ
- 4. LE VÉCU DES IMMIGRÉS DEMANDEURS D’ASILE
- 5. LA SITUATION DES IMMIGRÉS EN ITALIE
- CONCLUSION ET PROPOSITIONS POUR L’AVENIR
- NOTES
- BIBLIOGRAPHIE