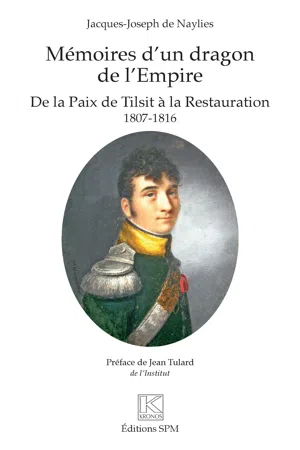![]()
Chapitre II
Mémoires sur la guerre d’Espagne
pendant les années 1808, 1809, 1810 et 1811
par le vicomte de Naylies
colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
commandeur de la Légion d’honneur
Seconde édition
1835
![]()
Avertissement
Peu de mois avant la campagne d’Austerlitz, j’entrai comme soldat dans le 19e régiment de dragons que je rejoignis en Allemagne. Pour conserver le souvenir des principaux évènements de la guerre, je recueillis dès-lors quelques notes sous la forme d’un journal que j’ai continué pendant dix ans passés hors de France. Ayant été plus de trois ans en Espagne, et ce pays étant moins connu que les autres parties de l’Europe, je me suis décidé à publier la partie de ces mémoires qui concerne l’Espagne et le Portugal.
Je n’ai jamais eu la prétention d’écrire l’histoire de la guerre, ma position ne le permettait pas ; j’ai seulement planté quelques jalons, donné des notes qui pourront servir peut-être un jour à l’historien de la guerre d’Espagne : c’est à cela que se borne mon ambition. On conçoit aisément qu’un sous-lieutenant vivant dans l’atmosphère de son régiment, ou de sa division tout au plus, ne pouvait être initié aux grands mouvements stratégiques, ou saisir l’ensemble des opérations militaires.
Des observations destinées à moi seul, écrites le plus souvent au bivouac et au milieu du tumulte des armes, seraient peu dignes d’intérêt si toutes les particularités de cette guerre désastreuse n’avaient pas un caractère de nouveauté qui excite la curiosité ; c’est à la faveur de ce sentiment que j’espère être traité avec moins de rigueur. On aura aussi peut-être quelque indulgence pour un militaire qui, pendant une campagne très active, a souvent dérobé à son repos des instants qu’il a consacrés au travail. Je rapporte les faits comme je les ai vus, et la vérité la plus impartiale m’a toujours guidé.
J’ai rendu justice aux Espagnols, j’ai admiré leur fidélité, leur patriotisme et cette héroïque constance qui a fait, de la défense de Saragosse, par exemple, un des grands évènements des temps modernes ; mais aussi j’ai flétri les cruautés qui ont déshonoré la guerre. Si parfois des représailles, qu’on pourrait rigoureusement appeler justes, des rapines ou des exactions souillaient l’uniforme français, j’en ai signalé les auteurs ; si je ne les ai pas nommés, l’armée ne les en a pas moins connus.
J’ai été heureux de pouvoir rapporter les traits de générosité et d’humanité qui ont honoré les deux parties dans cette sanglante lutte. La pensée aime à se reposer sur de pareils souvenirs, comme le voyageur fatigué jouit de la fraîcheur d’un oasis dans les sables du désert.
![]()
Introduction
L’Espagne, par son heureuse position et la fertilité de ses provinces, pourrait être l’État le plus florissant d’Europe si le caractère des habitants leur permettait de s’adonner à l’agriculture et au commerce. Elle appartint successivement aux Carthaginois, aux Romains, aux Goths et enfin aux Maures qui la conservèrent près de 700 ans.
La Maison d’Autriche cessa d’y régner en 1700, après une domination de deux siècles.
Charles-Quint et son fils, Philippe II, avaient porté au plus haut degré la gloire de la nation. Les Espagnols surpassaient tous les autres peuples par leur courtoisie, leur valeur, leur discipline et cette galanterie qu’ils tenaient des chevaliers castillans et maures qui avaient illustré ce délicieux pays. S’ils eurent des rivaux, on ne les trouva qu’à la Cour de François Ier ; mais ce beau temps de la monarchie ne fut pas de longue durée ; cet esprit chevaleresque, cet amour du merveilleux, se perdirent bientôt ; on ne les trouva plus que dans les romans, et les Espagnols n’eurent plus même cette gloire militaire qui, dans le XVIe siècle, les avait placés au premier rang.
En 1700, la France donna un Souverain à ce Royaume ; un petit-fils de Louis XIV monta sur le Trône, et treize ans d’une guerre sanglante lui en assurèrent la possession. Le règne paisible des successeurs de Philippe V avait fait jouir les Espagnols d’un siècle de bonheur, sous le gouvernement de la Maison de Bourbon, lorsque la perfidie de Napoléon arracha le sceptre à cette famille et vint plonger l’Espagne dans les horreurs de la guerre la plus désastreuse.
Le traité d’alliance de 1796 avait rétabli, entre la France et l’Espagne, l’union troublée par trois ans de guerre ; cette dernière puissance prodigua dès lors à son alliée ses ressources, ses trésors, et l’on vit ses flottes jointes aux escadres françaises balancer la puissance maritime des Anglais et leur vendre cher la victoire de Trafalgar. L’accord le plus parfait semblait régner entre les deux États ; mais la loyauté et la bonne foi étaient le partage de l’un, la perfidie et le parjure servaient de politique à l’autre. La paix de Tilsit venait d’être signée et Napoléon avait déjà conçu le dessein de s’emparer de la Péninsule. Pour l’exécuter plus aisément, il tira d’abord de l’Espagne, sous divers prétextes, un corps de quinze à dix-huit mille hommes, aux ordres du marquis de la Romana, qu’il envoya dans le nord de l’Allemagne.
Voulant aussi semer la dissension dans la Famille Royale, il profita de l’éloignement que manifestait le Prince des Asturies pour un mariage que lui proposait le Roi son père avec la Princesse de la Maison de Bourbon, belle-sœur du Prince de la Paix, et lui fit naître par ses envoyés l’idée de s’allier à sa famille en épousant la fille de Lucien Buonaparte ; ces intrigues donnèrent lieu à une lettre du Prince des Asturies à Napoléon : à peine fut-elle écrite que ce Prince fut arrêté et détenu à l’Escurial et l’on fit son procès comme coupable du crime de lèse-majesté ; enfin le Prince de la Paix, son ennemi mortel et le principal moteur de ces machinations, s’employa ouvertement pour réconcilier le père et le fils, et Ferdinand eut sa liberté. Sur ces entrefaites, arriva à Madrid le traité conclu à Fontainebleau, le 27 octobre 1807, par E. Izquierdo ; il portait que vingt-huit mille Français entreraient en Espagne pour se joindre à douze mille Espagnols, et qu’on occuperait le Portugal. Napoléon avait décidé par ce même traité qu’une partie de ce royaume serait donnée au roi d’Étrurie, en échange de la Toscane dont il venait de s’emparer, que les Algarves et l’Alentejo passeraient en souveraineté héréditaire au Prince de la Paix, et que le reste serait en dépôt jusqu’à la fin de la guerre. Formant ainsi, selon son caprice, le plus bizarre assemblage de pouvoirs et montrant son insatiable désir de conquêtes, Napoléon voulait franciser une portion du Portugal, comme il avait transformé en préfectures françaises Erfurt, Hambourg, Brême, etc. Les Français entrèrent en Espagne mais, sans aucun prétexte plausible, ils occupèrent les places fortes de la Catalogne et de la Navarre ; le cabinet de Madrid s’aperçut alors, mais trop tard, de la mauvaise foi de Napoléon. Le bruit que la Cour voulait quitter la Métropole pour se rendre en Amérique occasionna la plus grande fermentation qui éclata dans les évènements d’Aranjuez. L’emprisonnement du Prince de la Paix et l’abdication de Charles IV s’en suivirent, et Ferdinand fut reconnu roi d’Espagne, avec toute l’ivresse qu’inspire un bonheur inespéré. Ce prince envoya une députation de Grands d’Espagne à Napoléon pour lui faire part de son avènement au trône et lui demander la continuation de la bonne intelligence qui régnait entre les deux cours. Napoléon, qui n’attendait pas une pareille issue des trames qu’il avait ourdies en secret, répondit d’une manière évasive aux envoyés et s’achemina vers Bayonne. Cependant Murat entra dans Madrid, affectant de parler de l’union qui devait régner entre les deux peuples mais, feignant de ne pas croire à l’abdication volontaire de Charles IV qui en effet avait protesté deux jours après contre cet acte solennel, il ne voulut pas reconnaître Ferdinand VII, jusqu’à ce qu’il eût reçu des ordres de Napoléon. Celui-ci employa tout le raffinement de la perfidie pour faire tomber dans le précipice un prince dont la loyauté ne pouvait soupçonner la générosité de son allié. Le général Savary fut envoyé à Madrid, et assura le roi Ferdinand que l’Empereur était prêt à le reconnaître comme souverain des Espagnes, et engagea Sa Majesté par les plus pressantes sollicitations à venir au-devant de Napoléon qui devait être déjà au-delà de Bayonne pour se rendre à Madrid. Le Roi, cédant à de si vives instances, se mit en marche pour Burgos et de là pour Vittoria, malgré l’avis de son Conseil et de ses plus fidèles serviteurs. La même fourberie, qui avait amené ce Prince dans cette dernière ville, l’attira bientôt à Bayonne où se trouvait Napoléon. Lors de leur première entrevue, les deux souverains s’embrassèrent avec les démonstrations les plus affectueuses ; mais quelques instants après que le Roi fut rentré dans ses appartements, Savary vint lui annoncer que son Maître voulait faire régner en Espagne un prince de sa Maison et en exclure les Bourbons. Le malheureux Ferdinand ne put qu’opposer un noble courage et la conduite la plus ferme à l’indigne trahison qui l’avait conduit dans le piège. Ne pouvant rien obtenir de la noble résistance du jeune roi, Napoléon chargea Murat de faire partir pour Bayonne le roi Charles et la Reine. Le Prince de la Paix eut sa liberté et fut conduit en France, où arrivèrent aussi les vieux souverains. On sait qu’alors Charles IV protesta contre son abdication, força son fils à lui remettre la couronne qu’il céda, par une renonciation solennelle, à Joseph, frère de Napoléon.
Ainsi se consomma cette infâme trahison dont la renommée publia les détails dans la péninsule ; elle fit naître, dans tous les cœurs espagnols, l’horreur qu’inspire la violation de ce qu’il y a de plus sacré chez les hommes. L’exaltation fut portée à son comble et le désir de la vengeance anima la population entière ; l’explosion fut générale lorsqu’on vit la reine d’Étrurie forcée de quitter le palais des rois et partir pour Bayonne. Alors le sang coula dans les rues de Madrid et dans plusieurs villes du royaume ; des Français, établis en Espagne depuis bien des années mais devenus l’objet de l’exécration publique, furent les victimes de la fureur du peuple. Le cri de vengeance se fit entendre des Pyrénées à Cadix, et les armées françaises se virent entourées d’autant d’ennemis qu’il y avait d’habitants en Espagne. Le maréchal Moncey échoua dans le projet de s’emparer de Valence ; le général Dupont, qui s’était porté en Andalousie avec 18 000 hommes, capitula, le 20 juillet, à Baylen ; Madrid fut évacué, et les Français se replièrent sur Burgos.
Napoléon, sentant la nécessité d’envoyer de nouvelles troupes en Espagne, voulut, avant de retirer ses forces du Nord, sonder les dispositions de l’Autriche et de la Russie et entamer des négociations avec l’Angleterre : alors eut lieu le congrès d’Erfurt. L’Angleterre ne voulut pas la paix et l’Autriche, tout en paraissant goûter les projets de l’ambitieux Napoléon, résolut dès lors la guerre qu’elle déclara trois mois après.
Les troupes qui étaient en Pologne et en Silésie reçurent ordre de marcher vers la France. La quatrième division de dragons, dont mon régiment faisait partie, quitta Breslau à la fin du mois d’août et nous arrivâmes à Bayonne le 16 novembre.
Quoique trompés sur les motifs et sur l’injustice de la guerre que nous allions entreprendre, nous n’apportions pas, en entrant en Espagne, la confiance du soldat français qui marche à l’ennemi. Couverts des lauriers de Iéna et de Friedland, nous ne pouvions nous défendre de réflexions, mêlées d’inquiétude, à l’aspect d’un peuple entier levé pour soutenir ses droits. Une obéissance passive nous conduisit mais, pour la première fois, nous connûmes un autre sentiment que celui de la gloire.
![]()
De novembre 1808 à mars 1809
Entrée en Espagne, marche sur Madrid par Vittoria et Burgos, combat de Somosierra, prise de Madrid, l’Escurial, ses curiosités, catéchisme espagnol fait depuis 1808, Avila, Benavente, affaire des chasseurs de la garde devant cette ville, poursuite des Anglais, leur retraite, combat devant la Corogne, embarquement et perte des Anglais, Saint-Jacques de Compostelle, séjour en Galice, projet de passer le Minho à Tui pour entrer en Portugal, village d’Uma, désarmement de quelques cantons, je suis envoyé en mission à Porriño, insurrection en Galice, travaux des Portugais sur la rive gauche du Minho, le 2e corps ne pouvant franchir ce fleuve devant Tui, le remonte pour le passer sur le pont d’Orense, combat devant Morentàn, incendie de ce village et de plusieurs autres, arrivée à Ribadavia, affreux tableau d’une guerre nationale, trait d’humanité et de courage d’un curé espagnol, reconnaissance des Français, le deuxième corps arrive à Orense, il y attend son artillerie, bivouac de Cabianca, amusements de nos soldats, l’armée passe le Minho et arrive sur les frontières de Portugal, engagement avec les Portugais sur les bords de la Tamega.
À quelque distance de Bayonne s’offre un spectacle magnifique. L’immense océan borne une partie de l’horizon ; la citadelle, les riches bords de l’Adour et des coteaux couverts de vignes présentent le plus beau coup d’œil et les sites les plus pittoresques, tandis que la longue chaîne des Pyrénées complète ce brillant paysage. Nous traversâmes Saint-Jean-de-Luz, dont les vieilles murailles sont continuellement battues par la mer, et nous atteignîmes bientôt les bords de la Bidassoa, qui sépare les deux royaumes. On voit sur cette rivière la petite île des Faisans, célèbre par les conférences de Don Louis de Haro et du cardinal Mazarin qui y signèrent la paix en 1659.
Nous arrivâmes tard à Irun, première ville d’Espagne ; nous eûmes beaucoup de peine à nous faire recevoir de nos hôtes. Des portes très épaisses, des fenêtres grillées et de longs corridors frappèrent d’abord nos regards. Ces objets sinistres et le mauvais accueil des habitants ne nous donnèrent pas une idée très avantageuse...