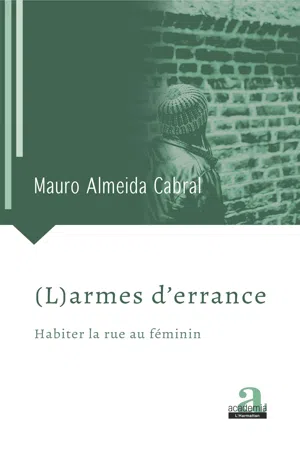
- 174 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Cet ouvrage invite le lecteur dans le quotidien des habitantes de la rue. Au travers de récits déployés, l'auteur donne à comprendre les rapports qu'entretiennent ces femmes au temps et à l'espace dans la grande précarité. Les systèmes de relations et les modes de (sur)vie mettent en lumière des logiques de débrouille et d'ajustements qui viennent contrecarrer les conduites à risques et les dangers affrontés quotidiennement par ces femmes.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à (L)armes d'errance par Mauro Almeida Cabral en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Scienze sociali et Politica. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
Scienze socialiSujet
Politica
PARTIE 1
La co-errance du praticien-chercheur
1. Des circonstances de l’ethnographie…
« Le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie. »
Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire.
Parler des circonstances de l’ethnographie revient à réfléchir sur les évènements qui sont à la source de cette recherche, à dévoiler une partie de ma trajectoire sociale et des expériences professionnelles qui ont été à l’origine de la présente mise en réflexion. Écrire sur ces évènements passés m’a permis de rassembler ces souvenirs dispersés et de les clarifier d’un point de vue chronologique. Pour commencer, je propose un bref récit narratif au contenu biographique qui débute en Amazonie brésilienne18 où j’ai vécu des expériences dépaysantes qui ont confirmé mon intérêt pour l’anthropologie. Ensuite, j’évoquerai ma réalité actuelle d’éducateur spécialisé19 dans une fonction d’éducateur de rue au Luxembourg au cours de laquelle j’ai rencontré de nombreuses situations éducatives qui ont éveillé mon intérêt pour ce monde social particulier.
1.1. Décentrement d’un premier terrain lointain
« Je hais les voyages et les explorateurs », c’est ainsi que commence le célèbre livre Tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss (1984[1955]). Et pourtant, c’est bien en voyageant que j’ai exploré des territoires psychiques et géographiques qui m’étaient jusqu’alors inconnus. J’ai découvert le monde de l’anthropologie bien avant d’en connaître la teneur scientifique lorsque j’ai rencontré le Peuple Yanomami20 en Amazonie brésilienne pour la première fois. Cette expérience fut certainement l’une des plus fortes que j’ai pu vivre du haut de mes vingt-six ans : aller sur « le terrain »21 a été une expérience particulièrement intense et inoubliable à la fois. J’en digère encore certaines sensations aujourd’hui, certaines rencontres, certains vécus, et la présente mise en récit vient apporter une forme de distanciation après ce premier engagement qui remonte à près de sept ans désormais.
L’étendue de ce voyage m’a cependant fait douter de ma démarche à quelques reprises, surtout lorsque mes pensées étaient corrompues par l’imaginaire collectif d’une partie de mon entourage qui réduisait l’Amazonie à des maladies parasitaires (paludisme, onchocercose, etc.) ainsi qu’à des dangers imminents d’origine animalière (candirú, piranha, surucucu, jaguar, caïman, etc.)22. Par ailleurs, l’ethnographie de l’anthropologue américain Napoleon Chagnon (1977[1966]) qui dépeint les Yanomami comme un « peuple féroce » est venue ajouter une couche d’incertitudes à la préparation de ce voyage. Ce stigmate attribué venait clairement discréditer l’humanité de ces personnes que je m’apprêtais à rencontrer :
Il va de soi que, par définition, nous pensons qu’une personne ayant un stigmate n’est pas tout à fait humaine. […] Afin d’expliquer son infériorité et de justifier qu’elle représente un danger, nous bâtissons une théorie, une idéologie du stigmate, qui sert parfois à rationaliser une animosité fondée sur d’autres différences, de classe, par exemple (Goffman, 1975).
Les Yanomami ne seraient donc pas « tout à fait humains », puisque « sauvages » car ils sont dans « un état de guerre constant » selon Napoleon Chagnon. Cette réification réduit ce peuple à des êtres inférieurs au reste de la société humaine, incapables de gérer des conflits comme des personnes dites « civilisées », c’est-à-dire sans violence physique. Elle semble cousine des idéologies colonialistes et capitalistes dont la normativité a pour effet de réduire la diversité culturelle autant que d’empêcher l’émergence de modes de vie « alter-natifs ». Combien de fois ai-je entendu l’atrocité suivante qui témoigne avec justesse d’une époque colonialiste révolue, mais tant présente dans les représentations sociales actuelles : « Un bon Indien est un Indien mort » ?
La lecture d’une partie de cette ethnographie (1977) déclenchait autant d’énervement que d’étonnement en moi :
The fact that the Yanomamö live in a state of chronic warfare is reflected in their mythology, values, settlement pattern, political behaviour, and marriage practices. […] There are a few problems, however, that seem to be nearly universal among anthropological fieldworker, particularly those having to do with eating, bathing, sleeping, lack of privacy and loneliness, or discovering that primitive man is not always as noble as you originally thought.
Comment expliquer le manque de nuances des propos de cet anthropologue qui parle essentiellement en termes de certitudes et non d’hypothèses ? En quoi un observateur externe, incarné par le chercheur, peut-il se permettre d’expliquer un terrain lointain avec les mêmes représentations conceptuelles qu’il utiliserait pour un terrain proche qui lui est familier ? La notion de « noble » relève, selon moi, d’une lecture ethnocentrique23 dans le sens où le chercheur semble concevoir ce peuple selon ses propres projections. D’ailleurs, le psychiatre Jean-Claude Métraux (2007) rappelle que l’observateur doit procéder à un « deuil de sens » du sens donné dans sa culture d’origine à certaines expressions qui peuvent, à tort, être considérées comme étant universelles ; ce n’est qu’ainsi qu’une reconnaissance mutuelle, c’est-à-dire l’opposé du mépris et de la méconnaissance, pourra s’opérer selon l’auteur.
Les mots que l’on utilise pour décrire une personne, un lieu ou encore un évènement ne sont donc jamais « innocents » puisqu’ils portent en eux des histoires mortes dont personne n’a plus forcément conscience, mais également des connotations qui, elles, sont bien présentes d’après le sociologue Stéphane Beaud et l’anthropologue et sociologue Florence Weber (2010). Dès lors, si violence il y a, je me demande dans quelle mesure celle-ci ne réside pas davantage dans le regard de l’anthropologue et les mots qu’il emploie pour décrire les Yanomami plutôt que dans les pratiques culturelles et sociales de ce peuple24.
Je n’avais pas un statut de spécialiste de la question indigène lors de ce voyage, et je ne l’ai toujours pas, encore moins celui d’un anthropologue expert des peuples amazoniens et cette position m’a permis de me renseigner sur certaines croyances et philosophies indigènes. Stéphane Beaud et Florence Weber (2010) soulignent qu’il existe cependant des inconvénients inhérents au fait de se rendre sur le terrain de la sorte : « Sachez tout de même qu’aller sur le terrain sans base théorique n’est pas sans risque en soi, mais vous nuira considérablement lors de la phase d’interprétation des matériaux recueillis. C’est alors qu’il vous faudra rattraper ce retard ».
La formation d’éducateur spécialisé et l’obtention du certificat universitaire « santé mentale en contexte social : multiculturalité et précarité »25 m’ont permis de réduire « ce retard », et surtout, de donner du sens aux expériences que je venais de vivre. D’ailleurs, j’apprendrai rapidement que le « sens » est un terme élémentaire dans le monde de l’éducation spécialisée : « l’éducateur entre dans son métier tout comme l’Autre entre dans la vie : par le sens » (Gaberan, 2013). Ainsi, la quête de sens et les questionnements éthiques m’animent depuis cette expérience amazonienne. Après ce détour un brin égocentrique synthétisant ce premier terrain lointain, je vais désormais introduire le monde social qui traverse mon quotidien professionnel dans une fonction d’éducateur de rue.
1.2. Points de basculement
En m’engageant sur le terrain de la rue dans un contexte urbain, je pensais rencontrer des habitants de la rue, certes, sans décliner ce terme au féminin pour autant. Dans mon imaginaire d’alors, ces personnes correspondaient à un certain « profil », à une certaine catégorie véhiculée non seulement par ma propre ignorance de la question, mais aussi par les discours sociétaux divers : un homme « SDF » est « forcément » barbu, édenté au visage ridé, porte des vêtements troués et répugnants, aime noyer sa peine dans l’alcool et passe ses journées sur un banc public à côté des pigeons qu’il n’hésite pas à nourrir à coup de pain rassis.
Un jour, Bruno et moi discutons autour d’un café dans un accueil de jour et il me fait part de son besoin de prendre une douche : « Il me faut une douche, mec. C’est la galère… Je suis arrivé au point où je peux plus sentir mon odeur ! Tu crois qu’il y a moyen de m’inscrire [pour prendre une douche] ? ».
Sachant que l’horaire était dépassé, Bruno voulait que je négocie son inscription avec l’équipe éducative afin qu’il puisse prendre une douche ce jour-là. Je lui confirme que sa demande a été acceptée et qu’il pourra s’occuper de son hygiène corporelle dans une heure. Il me fait signe de le suivre dans un coin près des toilettes et avant d’arriver sur place, il commence à chuchoter :
Tu sais, Fatima et moi, on dort dans une vieille bagnole. C’est la merde pour dormir, y’a pas de place pour mettre les coussins et tout. Enfin, bref, je m’inquiète pour Fatima… Elle passe beaucoup de temps à la rue pendant la journée et c’est pas bien. Moi, ça va, je me débrouille, j’suis un mec. Mais pour une fille, c’est dangereux. J’ai peur qu’il lui arrive quelque chose… Tu peux l’aider tu crois ?
Bruno partage l’idée suivante : la rue est dangereuse pour une femme et il a peur qu’il puisse arriver « quelque chose » à sa compagne. En tant qu’homme, il estime avoir plus de facilités à se débrouiller. De quels dangers voulait-il parler exactement ? S’agit-il d’une simple remarque à caractère sexiste qui enlèverait toute capacité d’agir aux femmes en situation d’errance ou plutôt d’angoisses fondées sur des expériences qu’il a vécues au cours de sa propre trajectoire ? Quoi qu’il en soit, il n’est pas question d’entrer dans une pensée dichotomique en essayant de trouver laquelle de ces deux hypothèses est la plus crédible, mais de maintenir une posture réflexive afin de rencontrer ces questionnements qui viennent ajouter de la complexité au monde social de la rue. Cette interaction est venue secouer et mettre en perspective mes propres représentations au sujet du public que j’étais amené à rencontrer en tant qu’éducateur spécialisé. En y réfléchissant de près, j’avais une représentation fragmentée et stigmatisée des personnes que j’accompagnerais. Bien évidemment, la formation d’éducateur spécialisé m’avait notamment invité à me distancier de mes propres préjugés et à conscientiser les valeurs qui me sont chères. Toutefois, j’ai certainement manqué de vigilance lorsqu’inconsciemment, je me préparais à travailler avec des « hommes de la rue » auxquels j’associais des réalités sous-jacentes diverses : consommer de l’alcool, se reposer dans des sacs de couchage en pleine rue, faire la manche sur les grands boulevards urbains, marcher avec des sacs innombrables sur soi, transporter ses affaires personnelles dans des charriots de supermarché, avoir des dents en très mauvais état et ainsi de suite.
1.2.1. L’errance androcentrique26
Cet échange avec Bruno est venu éveiller ce qui m’était jusqu’alors inconscient : la question du genre n’est pas un simple « détail » dans la construction de l’accompagnement psycho-éducatif qu’un éducateur spécialisé peut proposer. Et pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est un homme qui a attiré mon attention quant à cette question lorsqu’il m’a fait part, en toute confiance, de son inquiétude.
À l’issue de cette rencontre remontant à plus de six ans aujourd’hui, je me suis intéressé de près à la manière dont les femmes peuvent percevoir la vie à la rue. En tant qu’homme, il me paraît difficile d’appréhender avec justesse les difficultés que peuvent traverser ces femmes dans un tel contexte, c’est pourquoi j’ai voulu objectiver cette question, et les processus sous-jacents, en questionnant la littérature. Or, je me suis vite rendu compte que la question du « sans-abrisme » et de l’errance n’étaient que rarement déclinées sous leur forme féminine. Ceci rendait difficile l’accès à des informations de qualité à ce sujet.
Karine Boinot (2008), psychologue clinicienne, commence son article par le questionnement suivant :
Cette question et les réflexions qui suivent sont issues d’un constat effectué suite à différents travaux de recherche portant sur les personnes en errance : rares sont les fois où il y a conjugaison au féminin. On ne parle que de vagabond, de clochard, d’errant ! D’où la question-titre : la précarité serait-elle asexuée ?
La sociologue Audrey Marcillat (2014) en arrive au même constat et avance que « les recherches se faisaient jusqu’alors à partir d’un certain androcentrisme ». Marine Maurin (2016), docteure en sociologie, avance qu’il existe peu d’enquêtes qui se sont intéressées essentiellement aux situations « des femmes sans-abri » et rappelle qu’en Occident, le nombre de femmes dans une telle situation ne cesse d’augmenter, bien que les femmes encourent un « risque moindre […] de se trouver sans abri », selon la statisticienne et sociologue Maryse Marpsat (1999). Par ailleurs, des données quantitatives sur les femmes en situation d’errance sont rares sur le terrain luxembourgeois, et à ce jour, je n’ai rencontré aucune étude qualitative qui s’intéresse exclusivement à ce public cible sur ce terrain de recherche.
Dans une démarche réflexive, le concept d’errance mérite d’être approfondi et mis en dialogue avec les descriptions dites classiques et pourtant aliénantes selon moi : « sans-abri », « sans domicile fixe » (SDF), « sans logis », ou encore « sans-papiers » pour ne citer que ceux-là. Définir une personne à partir de ce qui lui fait défaut – selon qui ? – est symptomatique d’une lecture ethnocentrique qui fait l’amalgame entre ce qu’une personne possède, ou ne possède pas (avoir), et ce qu’elle est, respectivement ce qu’elle n’est pas (être). Au Canada, le terme « itinérance » est le plus souvent employé et désigne une construction sociologique qui englobe des problématiques variées mêlant alcoolisme, santé mentale, toxicomanie ou encore prostitution (Roy et Hurtubise, 2007).
En m’intéressant de près à l’étymologie de ce terme, le Larousse en ligne explique que l’errance est le fait de marcher longtemps sans but et direction précis27. J’ai été frappé qu’au sens littéraire, errer devient synonyme d’erreur : tomber dans l’erreur. Symboliquement, est-ce que l’errance est perçue en tant qu’une erreur humaine ? Si tel est le cas, qui devient l’erreur : la personne en situation d’errance ou l’errance elle-même ? La langue française utilise également ce terme pour désigner un chien qui n’a pas de maître et qui est voué à la solitude : le chien errant. Reste à savoir si le « maître » ne pourrait pas être un travailleur social au final, où le « chien » incarnerait la métaphore d’une personne en errance dont une « p...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Transitions sociales et résistances
- Titre
- Copyright
- Remerciement
- Exergue
- Introduction générale : Ville nue et dénuement symbolique
- PARTIE 1 : La co-errance du praticien-chercheur
- PARTIE 2 : Le monde social de la rue
- Ceci n’est pas une conclusion…
- Postface
- Bibliographie
- TABLE DES MATIÈRES