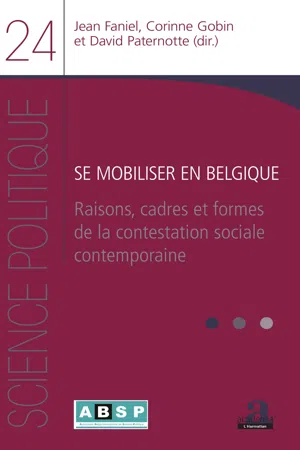
eBook - ePub
Se mobiliser en Belgique
Raisons, cadres et formes de la contestation sociale contemporaine
- 270 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Se mobiliser en Belgique
Raisons, cadres et formes de la contestation sociale contemporaine
À propos de ce livre
Pour quoi et pourquoi se mobilise-t-on en Belgique? Quelles sont les particularités du cadre institutionnel et socio-politique belge qui influencent l'action des mouvements sociaux? Quelles formes prend la contestation? Telles sont les questions que soulève cet ouvrage collectif. Il s'agit non seulement de comprendre ce que le cadre belge fait aux mobilisations, mais aussi de mettre en évidence ce que les mouvements sociaux apportent au système belge dans son ensemble.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Se mobiliser en Belgique par Jean Faniel,Corinne Gobin,David Paternotte en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politics & International Relations et Politics. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
L’ENGAGEMENT ALTRUISTE DANS LA LUTTE DES MIGRANTS
Youri Lou Vertongen
La Belgique connaît à intervalles réguliers des mobilisations collectives en faveur des droits des migrants : occupations des universités et grèves de la faim (2008-2009), marches des Afghans (2013), Caravane européenne des migrants (2014) et, plus récemment, occupation du Parc Maximilien durant la « crise de l’accueil des réfugiés » de l’été 20151. Ces mobilisations semblent toutes être caractérisées par des collaborations entre, d’une part, des acteurs migrants réunis au sein de collectifs éphémères qui initient une mobilisation (manifestations, occupations, grèves...) et, d’autre part, des associations composées de personnes belges ou en séjour régulier qui entretiennent des relations de solidarité avec ces migrants (à travers une aide logistique, une campagne de sensibilisation ou en jouant les intermédiaires avec les pouvoirs publics). Ce chapitre entend approfondir la question de l’engagement solidaire des seconds, mobilisés pour une cause dont ils ne sont pas les bénéficiaires directs. Pour ce faire, il revient sur les mouvements de lutte des sans-papiers en Belgique observés entre 1974 - date de la « fermeture théorique des frontières » (Martiniello, Rea 2012 : 27) - et 2009 - date de la dernière campagne massive de régularisation des sans-papiers.
Plusieurs questionnements sont à l’origine de ce chapitre. Comment expliquer que des acteurs qui ne sont a priori pas concernés par l’issue d’une mobilisation collective décident néanmoins de s’y engager ? Cette solidarité correspond-elle à un acte purement gratuit ou peut-on observer chez les acteurs solidaires de la « cause des sans-papiers » (Siméant 1998) en Belgique des formes de rétribution qui contrebalanceraient le coût de leur engagement ? Afin d’y apporter des éléments de réponse, je commencerai par dresser un état de la littérature sur les raisons de l’engagement, en insistant particulièrement sur la notion d’« action altruiste » mise en avant par Florence Passy (1998). Dans un second temps, j’examinerai les mutations des caractéristiques propres aux soutiens des migrants en Belgique en explorant trois périodes de forte mobilisation (1974, 1999 et 2009). Cette perspective historique permettra d’identifier les groupes institutionnels engagés de façon récurrente aux côtés des migrants (associations, syndicats, partis) et les raisons structurelles de leur soutien. En troisième lieu, je comparerai les raisons de l’action altruiste telles que décrites par F. Passy avec celles des acteurs issus des comités de soutien éphémères à travers l’analyse d’entretiens réalisés auprès de membres du Collectif contre les expulsions (CCLE) et du Comité d’actions et de soutien (CAS). En conclusion, je reviendrai sur les principaux apports de cette analyse.
1. Les raisons de l’engagement
Dans son entendement classique, l’engagement dans un mouvement de protestation est un processus qui convertit en actes une sympathie politique pour une cause conflictuelle (Neveu 2011 : 6). Or, pour Mancur Olson (1978), l’empathie pour une cause et l’engagement qui s’ensuit ne vont pas nécessairement de pair. Un comportement guidé par une rationalité instrumentale laisserait aux autres le coût de l’engagement pour privilégier la stratégie du free riding, permettant de bénéficier de la mobilisation des autres sans s’engager soi-même. Pour expliquer que des personnes s’engagent malgré tout, M. Olson avance l’idée d’« incitations sélectives » qui seraient à même de compenser le « coût de l’engagement » chez les groupes mobilisés (tels que des avantages individuels et statutaires ou, à l’inverse, des contraintes ou des sanctions).
Dès les années 1970, John D. McCarthy et Mayer N. Zald observaient deux types d’engagement au sein d’un mouvement social (McCarthy, Zald 1977). Ils utilisaient l’expression de « militants par conscience » (conscience constituents) pour décrire ces personnes engagées dans une mobilisation sans être personnellement concernées par ses revendications. À cette première catégorie, J. D. McCarthy et M. N. Zald opposaient les « bénéficiaires potentiels » (potential beneficiaries), concernés en personne par les revendications du mouvement. Pour autant, Annie Collovald (2002) met en garde contre un enjolivement de l’engagement des militants par conscience, qui ne prendrait pas en compte les rétributions perçues par ces militants mobilisés pour la cause de l’autre. Dans cette même perspective critique, l’étude d’Alessandro Pizzorno (1990) invalide les notions olsoniennes « d’incitations sélectives » pour les remplacer, dans le contexte de l’engagement solidaire, par ce qu’il nomme « incitations de solidarité », soulignant ainsi une forme de rétribution symbolique de certains militants par conscience. Non seulement l’engagement dans un mouvement de contestation offrirait à l’acteur la conviction qu’il agit en accord avec ses valeurs morales, mais il lui assurerait également l’occasion de communier avec d’autres individus partageant les mêmes systèmes de valeurs. Les incitants mis en évidence par A. Pizzorno sont donc davantage liés à la sociabilité des acteurs qu’à un gain matériel à tirer de l’engagement pour la cause d’un autre.
Cet auteur invite à penser les motivations de l’engagement solidaire autrement que sur la base d’une rationalité purement instrumentale. C’est l’hypothèse privilégiée par F. Passy dans son ouvrage sur l’« action altruiste » (1998). Elle estime que pour saisir les motivations de l’engagement solidaire, il faut l’aborder de manière duale : sur un plan « structurel » (contextualisant l’engagement afin de ne pas considérer l’acteur qui s’engage comme socialement désincarné et supposant une « prédisposition à l’engagement ») et sur un plan « intentionnel » (renvoyant aux opportunités qui justifient la décision de s’engager). Le niveau structurel permet d’examiner les potentialités de l’acteur à s’engager en fonction de son contexte socioculturel (système de valeurs...) et relationnel (personnes côtoyées dans le mouvement, place occupée dans celui-ci, etc.). À partir de ces éléments, l’acteur évalue les possibilités et les contraintes à l’œuvre lors de la concrétisation de son engagement. C’est ce que F. Passy nomme l’« intentionnalité de l’acteur » qui rationalise ses motivations à agir (1998 : 20-21). Les interactions entre acteur et milieu sont le point pivot entre le structurel et l’intentionnel. Ce chapitre s’appuie sur la perspective de F. Passy envisageant les dynamiques structurelies et intentionnelles comme moteurs de l’engagement altruiste et l’applique au cas des soutiens à la lutte des sans-papiers en Belgique.
2. Trois moments de mobilisation : 1974, 1999 et 2009
Depuis 1974 et la décision unilatérale de la Belgique de fermer ses frontières à la suite de la crise pétrolière, les mouvements de contestation autour des questions migratoires suivent une « trajectoire en dents de scie » (Bietlot 2007 : 97), alternant moments d’anomie sociale et moments d’effervescence politique. Cela est à mon sens la conséquence d’au moins deux phénomènes propres au contexte belge. Premièrement, il n’existe pas de politique migratoire définissant des critères clairs et permanents de régularisation (Adam et al. 2002). Ces régularisations se font le plus souvent sur une base individuelle et plusieurs associations citoyennes assimilent cette procédure à un « jeu de loterie » (Siréas 2005). Seules trois campagnes de régularisation, massives mais ponctuelles, ont été effectuées à la suite de mobilisations : en 1974, en 1999 et en 2009. Ces « réajustements » - dont l’objectif était la remise à zéro des compteurs de l’immigration clandestine - n’auraient eu de sens « que /s’ils] représentai[en]t la première étape d’une révision globale des politiques de l’immigration. Or il n’en fut rien. Une fois clôturées, [ces campagnes ont] occulté pour un temps la présence des sans-papiers dans l’espace public mais [ont laissé] sans solution la reproduction de la clandestinité » (Bietlot 2007 : 101). Deuxièmement, il n’existe pas de structure organisationnelle permanente qui maintienne une visibilité de la contestation autour des phénomènes migratoires en Belgique (Barrou 2014). Les collectifs qui se mobilisent autour de ces enjeux sont le plus souvent éphémères et dessinent une historicité fragmentée. Ces deux éléments expliquent pourquoi collectifs et associations de soutien varient d’une mobilisation à l’autre.
2.1. La régularisation de 1974
Jusque dans les années 1980, les phénomènes migratoires étaient appréhendés essentiellement au travers du prisme du travail. La régulation des « travailleurs immigrés » était une prérogative du ministère du Travail2. Prétextant une aggravation de la crise économique, le gouvernement Tindemans II décide, le 1er août 1974, l’arrêt officiel de l’immigration destinée au travail. En contrepartie, et sous la pression des grévistes de l’église Saints-Jean-et-Nicolas3, le gouvernement procède à une régularisation massive de travailleurs immigrés (Alaluf, De Schutter 2003 : 94). Cette campagne de régularisation se fait grâce à une large médiation des organisations syndicales (CSC et FGTB) dont le rôle est, d’une part, de former politiquement les militants issus de l’immigration en les incluant dans la communauté des travailleurs et, d’autre part, d’amoindrir le poids du patronat dans l’opération de régularisation (Rea 2000).
Entre 5 000 et 8 000 dossiers sont traités sur les 40 000 « travailleurs immigrés » présents sur le territoire en 1974 (Alaluf, De Schutter 2003 : 95). Sous la protection des syndicats, ce résultat a été le fruit d’une collaboration entre collectifs de migrants réunis sous la bannière du Mouvement des travailleurs arabes (MTA), soutenus par le curé de l’église Saints-Jean-et-Nicolas et les comités de soutien citoyens.
2.2. La régularisation de 1999
Dans le courant des années 1980, l’arrêt de « l’immigration pour le travail » ne permet l’accès au territoire que par la demande d’asile, le regroupement familial, le visa étudiant ou le visa touristique. Une nouvelle structuration de la migration - avec l’arrivée de femmes et d’enfants -, qui diffère de celle des années 1960-1970, fait alors son apparition (Alaluf, De Schutter 2003 : 97). Les questions migratoires passent en conséquence de l’autorité du ministère du Travail à celle du ministère de l’Intérieur et les instances syndicales, dont le soutien aux immigrés était jusqu’alors prépondérant, perdent leur influence au profit d’une constellation associative de soutien humanitaire aux réfugiés et demandeurs d’asile4.
À partir de 1996, avec l’avènement des « lois Vande Lanotte » - inspirées de la Convention d’application des accords de Schengen et qui entendent restreindre l’accès au territoire et renforcer la répression des illégaux -, nombre de nouvelles associations voient le jour. Citons, d’une part, le Mouvement national pour la régularisation des sans-papiers et réfugiés (MNRSPR)5, qui se bat pour la régularisation de « plusieurs catégories d’étrangers » (Mawet 2005 : 32) et non plus uniquement pour des travailleurs. D’autre part, des collectifs plus radicaux et parfois moins institutionnels, comme le Collectif de résistance aux centres pour étrangers (CRACPE) ou le Collectif contre les expulsions (CCLE), qui dénoncent « les lois inhumaines en vigueur en Belgique (...) et revendiquent] une régularisation générale, collective, inconditionnelle et non limitée dans le temps » (Beauchesne 2001 : 259).
Ces nouvelles structures de pression et de soutien relancent la perspective d’une mobilisation collective des sans-papiers et plusieurs collectifs de migrants voient ainsi le jour autour d’occupations d’églises à partir de 1997. Ces occupations mènent très souvent à des grèves de la faim qui exacerbent le sentiment d’urgence de régularisation massive. Un dernier élément, et non des moindres, accélère la procédure de régularisation. Le 22 septembre 1998, l’homicide par étouffement de Sémira Adamu par les policiers chargés de son expulsion provoque un émoi populaire sans précédent. L’intensification du mouvement d’occupations d’églises et la démission du ministre de l’Intérieur Louis Tobback (SP) contraignent le gouvernement à une régularisation massive - mais ponctuelle et individuelle - de 42 000 dossiers (Vandermeersch 2001).
2.3. La régularisation de 2009
Si elle permet la régularisation de milliers de personnes, la campagne de 1999 n’instaure aucun critère permanent de régularisation. De nouvelles situations de « séjours irréguliers » apparaissent et les occupations d’églises et de bâtiments publics par les sans-papiers déboutés se multiplient. En 2006, l’Union de défense des sans-papiers (UDEP) et des cabinets d’avocats rédigent une proposition de loi au nom de l’UDEP établissant des critères permanents de régularisation6. Écolo accepte de déposer cette « proposition de loi UDEP » à la Chambre des représentants. Cette démarche s’appuie sur pas moins de quarante-sept occupations liées à l’UDEP entre 2005 et 2006 et déployées dans plus de vingt villes de Belgique (Bietlot 2007 : 111). Malgré cette intense mobilisation, il faut attendre mars 2008 et l’accord de gouvernement Leterme I pour voir poindre la possibilité d’une régularisation sur la base des « attaches durables », critère avancé par la proposition de loi de l’UDEP. Annemie Turtelboom (Open VLD), nommée ministre de la Politique de migration et d’asile, est chargée de mettre l’accord en œuvre. Alors qu’un groupe de sans-papiers entre en grève de la faim à l’église du Béguinage, dans le centre de Bruxelles, l’UDEP organise une autre occu...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- COLLECTION « SCIENCE POLITIQUE »
- Titre
- Copyright
- INTRODUCTION - LA BELGIQUE DES MOUVEMENTS SOCIAUX
- CHAPITRE 1 - L’ENGAGEMENT ALTRUISTE DANS LA LUTTE DES MIGRANTS
- CHAPITRE 2 - LES MOBILISATIONS « BLANCHES » : D’UNE CRISE DE LEGITIMITE A L’EMERGENCE DE « NOUVEAUX MOUVEMENTS EMOTIONNELS » ?
- CHAPITRE 3 - CONTESTER PAR LA CONSOMMATION ? CONSOMMATION CRITIQUE ET ALIMENTATION LOCALE
- CHAPITRE 4 - LE DROIT A L’AVORTEMENT : UNE MOBILISATION PERSISTANTE
- CHAPITRE 5 - LES RELATIONS ENTRE SYNDICATS ET PARTIS POLITIQUES : UN FREIN A LA MOBILISATION SOCIALE ?
- CHAPITRE 6 - SE MOBILISER DANS UNE ETHNOFEDERATION : LE CAS DES MOUVEMENTS DE FEMMES ET LESBIGAYTRANS
- CHAPITRE 7 - MILITER DANS UNE DEMOCRATIE CONSOCIATIVE ET PILARISEE. L’EXEMPLE DU MOUVEMENT GAY ET LESBIEN
- CHAPITRE 8 - LA MANIFESTATION COMME OUTIL DE LA CONTESTATION. HISTOIRE ET PARTICULARITES DE SON USAGE EN BELGIQUE
- CHAPITRE 9 - LA GREVE EN ENTREPRISE APRES LA CRISE FINANCIERE DE 2008 : NOUVELLE DONNE OU ACCENTUATION DES TENDANCES PASSEES ?
- CHAPITRE 10 - LE MOUVEMENT FLAMAND DANS LA RUE : UN MOUVEMENT DE MASSE ?
- CHAPITRE 11 - LE MOUVEMENT ETUDIANT FRANCOPHONE : DECLIN OU EVOLUTION ?
- ONT CONTRIBUE A CET OUVRAGE
- Table des matières