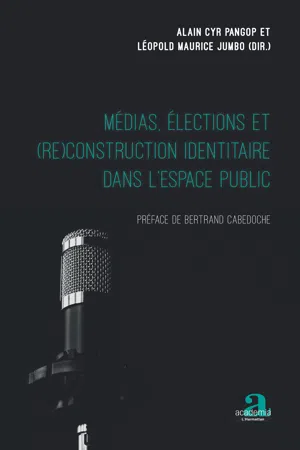
eBook - ePub
Médias, élections et (re)construction identitaire dans l'espace public
Préface de Bertrand Cabedoche
- 286 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Médias, élections et (re)construction identitaire dans l'espace public
Préface de Bertrand Cabedoche
À propos de ce livre
Les politiciens sensibles au moindre frémissement électoral et aux courbes d'évolution des sondages, ne peuvent plus négliger ses tendances reflétées par la presse. Les canaux d'information leur servent de véhicule de services interactifs. La presse protectrice de la démocratie est désormais le garde-fou des démocraties en dérive, puisqu'elle joue un rôle déterminant dans le processus de décision politique. Par un travail de décryptage, le présent ouvrage éclaire sur la confrontation entre médias, élections et identités.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Médias, élections et (re)construction identitaire dans l'espace public par Alain Cyr Pangop,Léopold Maurice Jumbo en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences sociales et Politique. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
Sciences socialesSujet
Politique5e PARTIE
Éducation des électeurs et surveillance des opérations libres des médias dans l’accès direct à la couverture des élections
Chapitre X
Vers un fact-checking participatif : permettre aux citoyens de se réapproprier la politique119
À compter des années 2000, d’abord aux États-Unis, puis en Europe ainsi qu’en Afrique aujourd’hui, une pratique journalistique originale a commencé à faire parler d’elle : le fact-checking politique. Elle consiste, pour les médias et les professionnels de l’information, à vérifier la véracité de propos tenus par des responsables politiques ou d’autres personnalités publiques et à en exposer les éventuelles incohérences et/ou mensonges, dans des formats d’articles et des rubriques dédiés. En France, Les « Décodeurs » du Monde, le « Désintox » de Libération et d’Arte, « L’œil du 20 heures » de France 2, le « Vrai du Faux » de France Info, le « Vrai-Faux de l’Info » d’Europe 1 en sont les avatars les plus pertinents actuellement. En Afrique, le pure-player Africa Check est l’un des principaux médias en charge de ce travail.
Toutefois, comme son appellation anglo-saxonne le laisse entendre, le fact-checking n’est en rien une nouveauté. Il émane directement de la tradition de vérification des faits étatsunienne. Là-bas, les médias ont d’abord pratiqué un fact-checking fondé sur la vérification exhaustive et systématique des contenus journalistiques avant parution ; ses origines remonteraient à la création du magazine Time, en 1923.
Quant à la version « moderne » du fact-checking, dans laquelle des équipes réduites de journalistes fact-checkers sont missionnés pour repérer, au sein des tribunes offertes à des personnalités (interviews radio ou TV, meeting, etc.), les affirmations qui semblent se prêter le mieux à un travail de vérification, en fonction de leur intérêt propre (sujet d’actualité, polémique, etc.) et de leur intérêt journalistique (occasion de faire le point sur un thème donné, thématique jugée accrocheuse, etc.), elle prête régulièrement le flanc à la critique. Ce fut notamment le cas en 2016, lorsque, à la suite du vote du Brexit au Royaume-Uni et de l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, beaucoup d’observateurs des médias et de journalistes ont considéré que le fact-checking politique était sans effet sur l’information et les opinions et que nous étions entrés dans une « ère de la post-vérité ».
Le fact-checking politique des années 2000 manquerait ainsi de pertinence et présenterait de très nombreux biais méthodologiques et éthiques. À quoi bon, en effet, lorsqu’on est un média d’information généraliste, aller piocher dans la sphère publique une déclaration plutôt qu’une autre ? Pourquoi décider le lundi de s’intéresser à un porte-parole du Front national plutôt que du Parti Socialiste ? Comment choisir de publier une citation dont on peut prouver qu’elle est fausse plutôt qu’une autre dont on pourrait montrer qu’elle est vraie ? Etc.
D’autant que les « échantillonnages » journalistiques en matière de fact-checking ne permettent au citoyen de bénéficier d’une information exhaustive : tel mensonge, proféré par un politique dans la matinale de telle radio, sera contredit sur le site Internet de tel autre média ; telle vérité étonnamment vraie, issue d’une émission de débat télévisé, n’obtiendra confirmation que dans la rubrique de fact-checking de telle autre chaîne… Quasiment aucun média ne vérifie ainsi les contenus politiques de ses propres colonnes ou émissions. Les citoyens qui en sont des habitués peuvent donc continuer à y être désinformés.
Entendons-nous bien, notre objectif ici n’est pas de remettre en cause le fact-checking en tant que pratique de vérification, car elle est consubstantielle au travail du journaliste. Nous préférons questionner la pertinence du modèle de fact-checking tel qu’il est actuellement mis en œuvre dans les principaux médias français (nous allons le décrire) : les médias sont-ils les mieux placés pour produire et diffuser des contenus de fact-checking ?
Car, s’il ne permet pas aux médias de regagner vis-à-vis des citoyens la crédibilité que, bien souvent, les aléas de leur situation économique (capitalistique) et éditoriale leur ont fait perdre, peut-être est-ce parce qu’il fait l’objet d’un mésusage de la part des journalistes. Le fact-checking politique pourrait bien révéler toute sa pertinence en marge des médias traditionnels et à la faveur du développement du Web participatif, tel qu’il est né.
N’est-ce pas aux citoyens de s’emparer du fact-checking politique pour en faire un outil d’information plus exhaustif, moins partial et donc réellement pertinent pour le plus grand nombre ? Ils le font déjà, dans une certaine mesure, lorsqu’ils restent fidèles à ce qu’ont pu être les premières tentatives de fact-checking « moderne », notamment aux États-Unis, mais également en France.
Ainsi, le fact-checking a déjà été expérimenté, plus discrètement, sous d’autres formes, participatives notamment, parfois appelées crowd-checking ou « fact-checking citoyen ». Certaines continuent de l’être d’ailleurs. Et d’autres initiatives, encore émergentes, organisées pour tenter de juguler la propagation des fake news et false news, après les événements de 2016, semblent également emprunter au fact-checking participatif. C’est ce que nous allons explorer ici.
Dans un premier temps, nous nous attacherons à décrire ce que représente aujourd’hui le fact-checking dans le paysage médiatique français, qui reste notre terrain de recherche privilégié, afin d’identifier ses principaux acteurs et leurs objectifs, leur mode de fonctionnement aussi.
Puis, nous montrerons que le fact-checking, comme son appellation anglo-saxonne le laisse entendre, n’est en rien une nouveauté. Il émane directement de la tradition de vérification des faits dans le journalisme américain. Et, de ce fait, il a déjà derrière lui une histoire relativement longue (une centaine d’années) qu’il nous appartiendra d’évoquer pour mieux en comprendre les fondements. Nous verrons ainsi que de sa création au début du XXe siècle à sa résurgence au début des années 2000, il s’est généralement affirmé comme une tradition journalistique avant tout. Nous pourrons alors interroger les biais de cette pratique, les limites qui, à l’aune de son histoire et de ses différents avatars actuels, font qu’elle n’est pas une pratique totalement satisfaisante, aux yeux des professionnels comme des citoyens.
Nous pourrons enfin montrer en quoi des tentatives participatives s’avèrent ou non prometteuses pour produire un fact-checking plus performant.
X.1. Le fact-checking, aujourd’hui, en France
Le fact-checking est une pratique journalistique qui a commencé à faire parler d’elle en France à compter de la campagne présidentielle de 2012. Dans le paysage journalistique français, cette « vérification des faits » consiste à mesurer la véracité de propos tenus par des personnalités publiques, essentiellement par des responsables politiques. L’objectif est de déceler dans leurs propos d’éventuelles incohérences et/ou mensonges et d’en rendre compte à travers des articles et des rubriques dédiés.
Concrètement, les journalistes fact-checkers repèrent, au sein des tribunes offertes à ces personnalités (interviews radio ou TV, meeting, etc.), les affirmations qui semblent le mieux se prêter à un travail de vérification « factuelle ». Cela en fonction de l’intérêt propre de ces citations (est-ce un sujet d’actualité ?, l’occasion de faire le point sur un thème, thématique accrocheuse ?, une source de polémique ? etc.), en fonction également de leur caractère « vérifiable » (existe-t-il des rapports, des données ou des archives – par exemple – facilement accessibles dans le temps imparti à ce travail de vérification ?).
En France, depuis 2008, ces rubriques sont particulièrement mises en avant par les journaux, radios et chaînes de télévision qui les ont adoptées. Certainement parce que ces articles de vérification semblent renouer avec les aspects les plus nobles du journalisme et sont généralement alimentés en contenus fiables, fruits d’enquêtes poussées et de longs recoupements d’informations. Le format classique d’un article ou d’une chronique de fact-checking est généralement le suivant : « Untel a déclaré tel jour dans tel média, telle information… Eh bien c’est vrai/faux/plutôt vrai/plutôt faux, etc. »
Nous ne présenterons pas ici un panorama exhaustif des initiatives conduites en France dans ce domaine. Mais nous pouvons citer les exemples de celles qui ont aujourd’hui plusieurs années d’existence, qui revendiquent explicitement un travail de fact-checking et qui disposent des plus larges audiences dans ce domaine.
Ainsi, le quotidien Libération a, le premier, décidé de consacrer en 2008 une rubrique au fact-checking stricto sensu, sous l’appellation Désintox pour en faire « observatoire des mensonges et des mots du discours politique », à travers un blog et, parfois même, des articles repris dans la version papier du journal. À compter de septembre 2012, Désintox devient même un programme TV dans l’émission d’information 28 minutes, diffusée sur la chaîne franco-allemande Arte. La rubrique, qui ne s’intéresse qu’aux fausses déclarations, s’y présente de la manière suivante : « Désintox est la première rubrique française de fact checking. Elle relève les inexactitudes ou les mensonges délibérés dans les discours des politiques. En quatre ans, l’équipe de la rubrique a corrigé des centaines de chiffres ou déclarations, en balayant avec impartialité l’ensemble du spectre politique. »120
Le quotidien Le Monde a lui aussi créé une rubrique de fact-checking, en 2009, sous l’appellation Les Décodeurs. Depuis le 10 mars 2014, Les Décodeurs disposent même d’une chaîne spécifique sur le site Internet LeMonde.fr, qui propose, outre la simple vérification de la parole des politiques, de la data-visualisation, des graphiques et un travail de contextualisation des principaux faits d’actualité. Le mot d’ordre de la chaîne est « Venons-en aux faits ». Ils présentent ainsi leur travail : « Les Décodeurs du Monde.fr vérifient déclarations, assertions et rumeurs en tous genres ; ils mettent l’information en forme et la remettent dans son contexte ; ils répondent à vos questions. »121
Du côté des médias audiovisuels, la ch...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Copyright
- Titre
- Comité scientifique
- Préface Vers la constitution d’un espace public sociétal et médiatique ?
- Introduction générale
- 1re PARTIE – Les récits médiatiques, lieux des imaginaires de l’Autre et de Soi en contexte électoraliste
- 2e PARTIE – Les récits médiatiques comme espace d’expression, de combat et de force identitaires
- 3e PARTIE – Le rôle des processus d’identification dans l’élaboration médiatique d’une figure héroïque
- 4e PARTIE – La fictionnalisation du processus électoral et la fabrication de l’opinion publique
- 5e PARTIE – Éducation des électeurs et surveillance des opérations libres des médias dans l’accès direct à la couverture des élections
- Bibliographie générale
- Présentation des contributeurs
- Table des matières