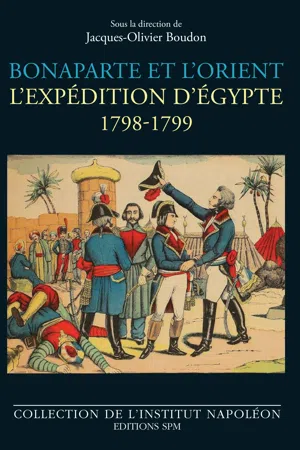
- 172 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Deux cent vingt ans après son lancement, l'expédition d'Égypte continue à fasciner. Vraie découverte scientifique, elle a aussi été une conquête coloniale, pensée comme telle, qui s'est du reste prolongée après le départ de Bonaparte. Ce volume propose des regards neufs sur l'expédition, depuis le rêve oriental de Bonaparte et son approche de l'islam jusqu'aux codes utilisés par l'armée sur place, en passant par le rôle de la flottille organisée sur le Nil pour conquérir la haute Égypte, l'action de Berthier et de Marmont, le spleen de l'armée, l'administration du pays, pour finir par une réflexion sur la question d'Orient et la mémoire de l'expédition telle que Napoléon a voulu la construire en dictant sa vision des événements passés.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Bonaparte et l'Orient par Jacques-Olivier Boudon en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Histoire et Histoire du monde. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
HistoireSujet
Histoire du mondeAUX ORIGINES DE LA QUESTION D’ORIENT : L’EXPEDITION D’ÉGYPTE DANS L’OPINION PUBLIQUE FRANÇAISE
par Jean-François Figeac
La question d’Orient trouve ses prolégomènes avant le XIXe siècle. Les historiens et géopoliticiens ont ainsi depuis longtemps montré qu’elle prend ses origines probablement lors de la guerre turco-russe de 1768-17741. Cette borne chronologique, outre son caractère arbitraire, doit être nuancée au regard de l’opinion publique. De plus, elle pose problème du point de vue de l’histoire des idées. En effet, elle ne rend pas compte du processus de conceptualisation de l’expression, qui ne pourrait se résumer à une date.
Certes, le souci de publicité dans la diplomatie française fut très prégnant à partir du ministère de Vergennes, il n’en demeure pas moins que l’Expédition d’Égypte marqua un moment tout à fait nouveau et inédit dans la place qu’avait la question d’Orient dans l’opinion publique. Lors de la campagne de Bonaparte, toute une série d’auteurs et de publicistes qui n’avaient pas de liens matériels avec la Sublime Porte se mirent à émettre des jugements et des réflexions destinés à soutenir ou à critiquer la pertinence d’intervenir en Orient. Cet intérêt ne se créa pas ex nihilo et les années de la fin du Directoire et du début du Consulat, qui marquèrent une première forme de démocratisation de la question d’Orient, avaient été l’expression d’une fascination croissante pour cette région du monde au cours du XVIIIe siècle, à travers l’orientalisme savant chez les élites2, l’attirance pour l’antiquité gréco-romaine3 et égyptienne4 dans les milieux lettrés, l’esprit de croisade dans l’entourage du pouvoir, mais également dans les milieux populaires5 ou l’exotisme littéraire à travers le succès que connaissaient Les Mille et une Nuits traduites par Antoine Galland et publiées à partir de 17046. L’Expédition d’Égypte marqua donc l’aboutissement d’un processus en gestation depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, en même temps qu’elle en inaugura un autre. En effet, pour la première fois, on ne réfléchit plus seulement sur un Orient spéculatif, objet d’un savoir théorique ou de l’imagination, mais sur un Orient réel et concret, objet de rapports de force internationaux. Ainsi, l’Expédition d’Égypte allait marquer la transition d’une pensée sur l’Orient à une pensée sur la question d’Orient.
L’Expédition d’Égypte, en bouleversant des siècles de tradition diplomatique et en superposant les équilibres orientaux aux rapports de force européens, créa ainsi de manière définitive la question d’Orient qui commençait à être pensée comme telle.
JUSTIFIER UNE NOUVELLE POLITIQUE ORIENTALE
En intervenant en Égypte, la France du Directoire tenta de redessiner les équilibres diplomatiques par la rupture avec la tradition politique de la monarchie qui se fondait sur trois piliers : l’alliance de revers avec l’Empire Ottoman, notamment face aux Habsbourg, des relations commerciales privilégiées en direction des Échelles du Levant grâce aux capitulations (bien que la France soit concurrencée en la matière dès le XVIIe siècle) et enfin le protectorat des chrétiens d’Orient.
La Sublime Porte, d’alliée, devint une rivale de la France en Orient, ce qui nécessita tout un travail de justification destiné à donner du sens à la campagne d’Égypte, une fois que la nouvelle de la véritable destination de la flotte partie de Toulon fut connue de la presse. Une partie de l’opinion publique estimait que l’intérêt stratégique d’une intervention en Orient était particulièrement douteux, que ce soit la droite cryptomonarchiste ou la gauche néo-jacobine7, tandis que certains partisans du général Bonaparte commençaient à colporter le bruit d’une volonté de Talleyrand et des directeurs d’éloigner le vainqueur d’Arcole dont le prestige ne cessait de croître au sein de l’armée comme du peuple8. L’inquiétude et l’incertitude dont témoignait la presse dès le début octobre 1798, après l’annonce de la défaite d’Aboukir, montraient que le projet interventionniste, bien qu’ancien dans la diplomatie et très prégnant dans l’opinion avant l’expédition grâce à Volney9, avait néanmoins connu un recul lié aux péripéties révolutionnaires10, ce qui doit garder tout historien de conclusions téléologiques selon lesquelles l’Expédition d’Égypte serait la conséquence logique et inévitable d’une progression de la curiosité orientaliste et du paradigme interventionniste en France au XVIIIe siècle. Il devint dès lors nécessaire pour les partisans de l’aventure de Bonaparte de recréer une géopolitique française en Orient. « L’inexplicable expédition d’Égypte », pour reprendre les mots qu’un publiciste prête à Tronchet, dans une brochure publiée à l’automne 179811, devait avoir un sens, tandis que le même souci de justifier la défense du sultan ottoman s’écrivait parallèlement outre-Manche.
L’entreprise de justification du bien-fondé de l’Expédition d’Égypte dans l’opinion publique française suit plusieurs types d’arguments, qui peuvent se recouper, mais aussi rentrer en contradiction entre eux. Ainsi il n’exista pas durant l’Expédition d’Égypte un courant interventionniste, mais une multiplicité de points de vue qui se firent écho et qui étaient aussi bien issus des mutations de la pensée politique sur l’Orient au cours des Lumières que de la conjoncture révolutionnaire. Dans ce foisonnement des idées, trois axes structurants sont destinés à rationaliser « cette folie »12.
Le premier, directement hérité de la philosophie des Lumières, consiste à mettre en avant l’idée du despotisme consubstantiel au sultanat ottoman. Théorisée par un consul anglais à Smyrne du nom de Paul Rycaut dans The History of the Present State of the Ottoman Empire (1668), l’idée de despotisme turc connut une grande postérité au siècle des Lumières via Montesquieu13. Le concept, naguère philosophique, était désormais abandonné aux poètes et aux panégyristes de l’expédition, qui cherchèrent à mettre en avant ce qu’ils considéraient comme une lutte de la civilisation contre la barbarie14. Néanmoins, certains publicistes n’hésitèrent pas à mettre en valeur l’impéritie du gouvernement turc, dont l’incapacité à se réformer aurait était la cause de l’anarchie de l’Empire ottoman. Cette critique fut présente y compris chez des gens qui étaient initialement favorables à un respect et à une protection du sultan. Ce fut notamment le cas de Charles-Louis Houël. D’abord prêtre, puis directeur de l’imprimerie française de Constantinople et publiciste, il était chef de division au ministère de la Guerre fin 1798. Durant son séjour dans l’Empire ottoman, il soutint et seconda la politique de la France révolutionnaire pour que Sélim III fasse ses réformes et se présentât comme un disciple des diplomates Aubert-Dubayer et Ruffin qui tentaient de mener à bien cette politique de modernisation. Mais, après son retour en France, il sembla faire le constat désabusé de l’infructuosité de cette stratégie et employa dans une brochure l’oxymore de « despotique anarchie turque »15 qui aurait motivé l’intervention française en Égypte. En effet, en raison du despotisme des beys, le commerce français aurait été entravé. Pour lui, l’Expédition d’Égypte ne s’était pas faite contre la Porte mais pour protéger la Porte face au désordre qui aurait régné dans l’Égypte des mamelouks.
Cette analyse contrastée, qui fait de l’Empire Ottoman un fautif, mais aussi une victime montrait bien que l’ingérence française devait se faire dans le cadre d’un maintien de la souveraineté ottomane selon une partie de l’opinion. Ainsi, l’argument de la défense de la légitimité ottomane contre des beys jugés être des usurpateurs fit florès. En effet, l’Expédition d’Égypte avait été conçue de telle manière que la France ne s’exposât pas à la critique du non-respect du droit des gens. Les exactions dont étaient victimes les marchands français de la part de Mourad et Ibrahim Bey16, ainsi que l’absence d’une réelle souveraineté ottomane sur l’Égypte devaient justifier à elles seules une intervention française. C’est ce que les directeurs et l’état-major tentèrent de mettre en avant, Bonaparte devant rencontrer et donner une lettre au pacha, représentant de la légitimité ottomane, dès son débarquement en Égypte17. Cette idée que le général corse n’était finalement que le bras armé du sultan fut abondamment relayée dans l’opinion. Ce fut notamment le cas chez le polygraphe Jean Chas, selon lequel toute la campagne française en Égypte, mais aussi en Syrie, doit être lue comme une volonté de libérer le territoire ottoman de la sécession menée respectivement par les beys et par Djezzar Pacha : « La cour ottomane cherchait depuis longtemps à humilier les beys d’Égypte qui s’étaient affranchis de sa domination. En punissant ces usurpateurs, Bonaparte servait la France, et vengeait le divan »18. Si la France avait ainsi pu échouer à convaincre la Porte du bien-fondé de sa mission, la faute en incombait entièrement, selon ces auteurs, à Talleyrand à Paris et à Ruffin à Constantinople19. En tout cas, cette déconvenue de la diplomatie ne devait en rien ternir ce qui était vu comme un succès géopolitique, à savoir une possibilité d’ancrage territorial de la France en Orient.
En effet, l’importance accordée à l’influence française en Orient constitua l’argument majeur des hagiographes de l’Expédition d’Égypte. Pétris d’une philosophie du progrès héritée des Lumières, ils mettaient ainsi en avant le concept de régénération, emblématique de la pensée révolutionnaire20, les savants devant permettre le progrès matériel et moral du pays. Ce discours fut relayé dans la presse, et particulièrement dans La Décade philosophique, littéraire et politique aux m...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- DANS LA MÊME COLLECTION
- Titre
- Copyright
- Les auteurs
- INTRODUCTION
- LE REVE ORIENTAL DE BONAPARTE
- LES CODES SECRETS DE LA CAMPAGNE D’ÉGYPTE
- LA FLOTTILLE DU NIL DANS LA CAMPAGNE DE HAUTE ÉGYPTE
- MARMONT ET BERTHIER LORS DE LA CAMPAGNE D’ÉGYPTE
- LES SOLDATS DE L’ARMEE D’ÉGYPTE
- BONAPARTE ET L’ISLAM
- L’ADMINISTRATION DE BONAPARTE EN ÉGYPTE
- LES SAVANTS, INGENIEURS ET ARTISTES DE L’EXPÉDITION D’ÉGYPTE, MÉDIATEURS DE L’ORIENT
- AUX ORIGINES DE LA QUESTION D’ORIENT : L’EXPEDITION D’ÉGYPTE DANS L’OPINION PUBLIQUE FRANÇAISE
- L’ÉCRITURE DES MEMOIRES DE NAPOLEON SUR LA CAMPAGNE D’ÉGYPTE
- Table des matières