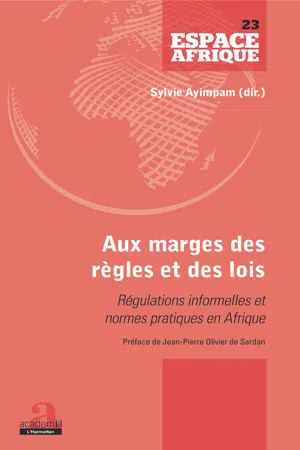
eBook - ePub
Aux marges des règles et des lois
Régulations informelles et normes pratiques en Afrique - Préface de Jean-Pierre Olivier de Sardan
- 332 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Aux marges des règles et des lois
Régulations informelles et normes pratiques en Afrique - Préface de Jean-Pierre Olivier de Sardan
À propos de ce livre
La mondialisation a pour conséquence un affaiblissement de la souveraineté des États-nations qui a ouvert la voie à une multiplication de sphères d'actions informelles, non légales voire illégales. En Afrique, l'«informalisation» des institutions se réalise sous la forme d'arrangements, de conventions, d'usages qui s'écartent des «normes officielles». Ce sont ces processus de régulation informelle que cet ouvrage - le premier en français sur les «normes pratiques» - explore en profondeur.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Aux marges des règles et des lois par Sylvie Ayimpam en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Social Sciences et Politics. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
Social SciencesSujet
PoliticsTROISIÈME PARTIE
Normes légales et
régulations pratiques
Chapitre 9
Le pluralisme normatif en matière familiale.
Contrainte ou opportunité pour l’État
du Sénégal ?
•
Marième N’DIAYE
Le Code de la famille (CF) constitue une entrée privilégiée pour analyser la question du pluralisme des normes et sa gestion par l’État en Afrique. En effet, la plupart des législations en la matière traduisent un jeu sur différents systèmes normatifs (droit étatique, coutumes, normes religieuses, droit international), généralement source de tensions entre les différents acteurs, à savoir : acteurs étatiques, religieux et associatifs (plus particulièrement les associations de défense des droits des femmes). Dans la République laïque du Sénégal, prendre le Code de la famille comme objet d’étude apparaît d’autant plus pertinent qu’il constitue le seul texte dans l’arsenal juridique qui se base sur une pluralité de sources de droit. Le traitement particulier réservé au droit de la famille s’explique principalement par la forte dimension identitaire qu’il revêt dans un pays au sein duquel l’Islam, religion majoritaire, a une influence très forte à la fois sur le champ politique et sur les modes de vie et mœurs de la société (Coulon 1988, O’Brien 2002).
Au moment de l’indépendance, le Sénégal s’est distingué des pays voisins en faisant le pari du pluralisme : le Code de la famille, adopté en 1972, se base en effet sur différentes sources de droit : le droit civil français et la « coutume wolof islamisée ». Ce terme, consacré par le législateur, renvoie au droit musulman sénégalais1, considéré comme le plus petit dénominateur commun aux 69 coutumes recensées. Le droit musulman n’intervient cependant que dans deux domaines : à titre principal pour le mariage (la polygamie est consacrée régime de droit commun par l’article 116), à titre d’exception pour la succession (l’article 571 offre la possibilité aux croyants qui le souhaitent de voir leur succession dévolue selon le droit musulman). Le pluralisme ainsi défini reste donc un pluralisme inégalitaire, le droit musulman faisant essentiellement figure d’exception au droit commun. En intégrant le droit musulman sous le label de « coutume wolof islamisée », le législateur a en effet bel et bien procédé à une disqualification des règles religieuses qui lui a permis de légitimer la subsidiarité ou la subordination de la coutume par rapport aux règles de droit écrites. S’il y avait une volonté manifeste de ne pas heurter certaines croyances ou modes de vie, il n’en reste pas moins que l’État entendait faire du droit de la famille un « droit outil » (Botiveau 2006), c’est-à-dire un droit moteur des évolutions sociales, un droit vecteur de modernisation et de démocratisation, en adéquation avec le projet politique des élites issues de l’Indépendance.
Du point de vue de l’État, le droit de la famille sénégalais peut ainsi renvoyer à une situation de pluralisme normatif – entendue comme situation au sein de laquelle « une pluralité de systèmes de normes coexistent, qu’ils puissent être unifiés ou non, placés dans un rapport hiérarchique ou non, et que les citoyens sont susceptibles, selon le modèle du “forum shopping”, de les utiliser alternativement mais aussi de les “assembler” et de les cumuler » (Darbon 2008 : 15). Du point de vue de l’individu, la possibilité de pouvoir choisir entre différentes options traduit en soi l’existence d’un pluralisme juridique – entendu comme la reconnaissance du pluralisme de la norme positivée (c’est-à-dire affirmée comme norme de droit par les instruments de validation juridique) et validée comme telle par les professionnels du droit (Tamanaha 1993) – au moins comme potentialité (Adonon e.a. 2003).
L’objet de cet article est d’étudier les effets de cette situation de pluralisme normatif sur l’autorité de l’État sénégalais, entendu comme un État à la légitimité et aux capacités limitées. Comment un tel État peut-il faire valoir son pouvoir d’injonction – c’est-à-dire sa capacité à produire un ordre qui soit accepté par l’ensemble de la société – dans un contexte de pluralisme normatif2 ? En soi, s’interroger sur la réalité de l’État en Afrique, sur le processus d’institutionnalisation de l’État au Sud ou encore sur l’État en action, n’est pas nouveau. L’intérêt de la réflexion réside dans l’introduction de la problématique du pluralisme normatif qui, sous différentes formes, caractérise le phénomène juridique dans l’ensemble des États postcoloniaux (Darbon 1997 : 114). Comme dans la plupart de ces États, l’État du Sénégal se voit confronté à un fossé très net entre « ordre juridique formel » et « ordre juridique réel » qui met à mal son autorité (Kouassigan 1977, Wing 2008). L’incapacité de l’État à faire coïncider le droit avec les attentes de la société traduit sa difficulté à s’institutionnaliser en tant qu’« entreprise réussie de domination qui détient le monopole de la contrainte physique légitime et revendique à ce titre celui de la production de droit » (Darbon, 2008). Le « pluralisme soft » (Belley 2002) – consistant à associer une concession à la négociation sur le contenu normatif à une dureté dans le domaine procédural – n’a pas suffi à faire de la norme légale la norme légitime, témoignant de la mise en échec d’un pluralisme pensé sur un mode unitaire à partir du monopole étatique. Dans les faits, le droit de la famille n’apparaît que comme une norme parmi d’autres, voire une norme peu ou pas mobilisée3.
Ainsi, le pluralisme en matière familiale renverrait plutôt en pratique à la version hard du pluralisme, qui part du principe qu’il n’y a pas de domination d’un ordre sur un autre. Selon Vanderlinden, cette définition s’applique « lorsqu’un individu est soumis, de gré ou de force, simultanément à plusieurs ordres juridiques considérés comme intrinsèquement égaux, même si certains sont plus envahissants que d’autres » (Vanderlinden 1997 : 31). Contrairement au postulat de la version soft du pluralisme, ici l’État ne peut pas jouer le rôle de chef d’orchestre puisqu’il est considéré comme inapte à comprendre le fonctionnement de tous les instruments présents dans l’orchestre. La différence entre ces deux conceptions se fonde donc sur « la représentation de la place de l’État dans la vie juridique ou, plus exactement, la reconnaissance d’un monopole de l’État dans la production des normes sanctionnées par lui et qui sont globalement qualifiées comme étant “le Droit”« (Leroy 2003 : 10). Le décalage entre le degré effectif de pluralisme et la place qui lui est attribuée officiellement par l’État traduit en fait tous les enjeux de pouvoir que recèle la maîtrise de la production de la norme juridique pour l’État. En effet, les ordres en concurrence avec l’État, et plus précisément les ordres religieux, proposent comme lui un système englobant qui, par définition, implique la disparition ou la subordination des ordres concurrents. Dire le droit constitue une caractéristique fondamentale du pouvoir (Spellenberg 1997), d’où les luttes entre l’État et ces groupes pour s’attribuer, à défaut du monopole, la centralité de la production juridique.
Tout l’intérêt de l’étude tient donc à cette confrontation entre l’ambition politique affichée par l’État d’imposer une norme comportementale familiale normalisée à une société largement construite sur la base de systèmes normatifs différenciés et éloignés du projet étatique. En nous basant sur un travail de recherche sociologique4, nous montrerons que, contrairement aux idées reçues, l’État s’institutionnalise et se construit non pas « malgré » le pluralisme normatif mais bien « avec » lui. Nous verrons que si le pluralisme a pu contrarier les ambitions des élites politiques post indépendance en matière de construction nationale et de modernisation (I), il n’en reste pas moins que l’État a appris sur le long terme à tirer avantage de ce pluralisme pour asseoir progressivement son autorité par un effet de spill over sur l’ensemble du territoire (II).
Les ambitions de l’État sénégalais indépendant contrariées par la prégnance du pluralisme des normes en matière familiale
Les élites politiques du Sénégal indépendant ont développé un projet politique fondé sur les idées de construction nationale et de modernisation, avec l’État comme maître d’œuvre (La Palombara 1963). Le Code de la famille était pleinement inscrit dans cette optique : il devait progressivement unir l’ensemble de la communauté nationale à travers un même droit et aider à promouvoir des valeurs jugées plus en conformité avec la modernisation du pays. De ce point de vue, les autorités politiques s’inscrivaient dans la théorie de la modernisation et dans celle du courant « droit et développement » qui, dans les années 1960-1970, considéraient le développement comme « un processus évolutif conduisant inévitablement à l’établissement d’institutions politiques, économiques et sociales similaires à celles qui existent en Occident » (Delpeuch 2006 : 127). Le droit apparaissait alors comme l’instrument privilégié de l’État pour exercer son autorité et s’implanter dans la société. Or, le droit étatique s’est heurté à la réalité du pluralisme normatif, ce qui a renforcé sinon révélé les faiblesses structurelles de l’État.
Les ambitions affichées : unité nationale, modernisation et « État intégral »5
Le pluralisme hégémonique caractérisant le Code de la famille devait permettre d’effectuer en douceur la transition d’une société « traditionnelle » vers une société « moderne » – la modernité s’entendant ici comme l’alignement sur les normes occidentales (Kouassigan 1977). De ce point de vue, les débats parlementaires autour du projet de loi traduisent parfaitement l’ambition du législateur : ainsi, dans son rapport, le ministre de la Justice insistait sur le caractère impératif d’une telle législation dans le cadre de la construction du Sénégal indépendant (Diop 1972 : 1). À côté de l’argument de l’unité nationale, ce sont les idées de développement et de modernité qui constituaient le deuxième volet de justification des autorités politiques. Le rapporteur de la Commission de la Législation rappelait ainsi que l’une des cinq consignes auxquelles avait dû se plier le comité des options était de « respecter les valeurs traditionnelles mais de supprimer les habitudes anachroniques ou mal adaptées à la politique de développement économique et social » (Touré 1972 : 218). La fonction unificatrice et novatrice dévolue au Code de la famille transparaissait clairement dans les propos du Président Senghor au sujet du Code de la famille sénégalais. Il affirmait que le code avait sa part « dans les grandes mutations nécessaires à la participation de [la] société dans l’édification du monde de demain » (Diack 1977). La réalité pluriethnique était considérée comme incompatible avec « l’avènement d’une communauté de pensée et de vie juridiques, élément essentiel à l’existence d’une nation » (Kouassigan 1977 : 129).
Les enjeux de la loi dépassaient donc la question de la gestion des rapports familiaux et concernaient plus largement le type de société que les autorités politiques entendaient faire advenir. En se plaçant sur le terrain de la construction nationale et de la modernisation du pays, les nouvelles élites au pouvoir mettaient ainsi en œuvre de nouvelles sources de légitimation pour justifier leur stratégie de bouleversement des rapports de force dans le champ politique. Mais, derrière la rupture symbolique affichée par l’État dans l’élaboration du code, on trouvait une politique du droit de la famille beaucoup plus modérée, qui traduisait par son contenu une conception plus incrémentale qu’héroïque du changement social. Pour l’État, l’enjeu était d’agir sur le procédural afin de se voir reconnaître comme seule autorité suprême. Cependant, si à court terme il s’agissait pour l’État d’affirmer sa domination, les questions de transformation sociale et de construction de la Nation renvoyaient à un processus de long terme dont la réussite dépendait de la réalisation du premier objectif. ...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Préface Sur le concept de normes pratiques, son histoire et son utilité - Jean-Pierre Olivier de Sardan
- Avant-propos Le jeu des normes au quotidien en Afrique - Sylvie Ayimpam
- Introduction La régulation informelle et les normes pratiques de l’action collective en Afrique - Sylvie ayimpam, Jacky bouju
- Première partie Pluralisme normatif et accès aux ressources
- Deuxième partie Légalités et violence des règles effectives
- Troisième partie Normes légales et régulations pratiques
- Table des matières