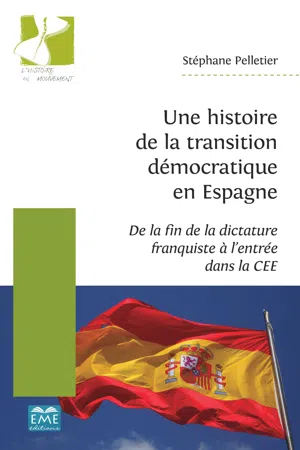
eBook - ePub
Une histoire de la transition démocratique en Espagne
De la fin de la dictature franquiste à l'entrée dans la CEE
- 116 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Une histoire de la transition démocratique en Espagne
De la fin de la dictature franquiste à l'entrée dans la CEE
À propos de ce livre
En 1975, Francisco Franco meurt et son régime dictatorial de presque quatre décennies disparaît avec lui. Commence alors ce que les historiens appellent «la transition démocratique». Elle permet à l'Espagne de passer d'un régime autoritaire à une démocratie libérale. Cet ouvrage interroge les fondements mêmes de cette période clé de l'histoire espagnole, en s'intéressant aux principaux acteurs du changement et à la façon dont cette transition s'est produite avec l'intégration dans la CEE comme horizon.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Une histoire de la transition démocratique en Espagne par Stéphane Pelletier en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Histoire et Histoire du monde. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
HistoireSujet
Histoire du mondeChapitre III
Construire la démocratie
1. La réforme politique d’Adolfo Suárez
Adolfo Suárez est incontestablement l’homme clé de cette nouvelle période de l’histoire espagnole qui s’ouvre à l’été 1976 et qui conduira le pays à se doter d’une nouvelle constitution, adoptée par voie référendaire le 6 décembre 1978. À cette époque, Suárez est loin de compter parmi les figures les plus en vue de l’élite franquiste. On peut même dire qu’il s’agit d’un homme de second plan, d’un technocrate du régime qui manque de charisme. Il fut tout d’abord gouverneur civil de Ségovie puis directeur général de RTVE, la radio-télévision espagnole, entre 1969 et 1973. Il préside un temps l’UDPE (Unión del Pueblo Español), une formation politique créée pour perpétuer le franquisme après Franco. À la mort de ce dernier, il occupe la charge de délégué du gouvernement à la compagnie nationale Telefónica. En dépit de son appartenance indiscutable au franquisme puisque toute sa carrière politique s’est déroulée au sein du parti unique du régime, le Movimiento Nacional, Suárez apparaîtra bientôt comme un partisan de l’ouverture, qui réussit à imposer dans la sphère politique une image de libéral. Son âge relativement jeune et son physique avenant constituent pour lui autant d’atouts supplémentaires. Adolfo Suárez sera capable de mener à bien une politique de transition entre le système dictatorial et un régime démocratique dont l’Espagne était privé depuis presque quarante ans. Il décide donc de conduire cette démocratisation graduelle en utilisant les institutions légales du franquisme et en pratiquant une réforme dialoguée avec l’opposition démocratique. En cela, il est secondé par Fernando Abril Martorell, qui sera plusieurs fois ministre sous les quatre législatures de l’UCD, la coalition de tendance démocrate-chrétienne fondée par Adolfo Suárez en mai 1977.
Les réformistes, avec l’acquiescement du roi Juan Carlos, vont mettre en place une véritable transformation politique mais en respectant la légalité, c’est-à-dire l’héritage du régime franquiste. Cette Transition espagnole, objet de nombreuses études et qui fut si souvent citée en exemple aux yeux du monde, notamment en Amérique latine au moment de la disparition des dictatures militaires du cône Sud dans les années 1980, s’est produite de façon relativement consensuelle parce que les forces politiques antagoniques ont souscrit comme « un pacte du silence » sur le passé. Dans leur majorité, les Espagnols ont accepté de se délester du poids d’un passé traumatique avec tout ce qu’il comprenait de rancœurs, de douleurs, voire de haines accumulées au fil du temps. Pour certains, dont le sociologue et ancien membre de la Junta Democrática José Vidal-Beneyto, il s’est agi ni plus ni moins d’une « ablation totale de la mémoire » qui a permis l’auto-transformation du franquisme et la légitimation démocratique de son élite économique et de sa classe politique. Ce pacte implicite de « réconciliation nationale » souscrit entre les élites politiques des camps opposés reçoit le soutien inconditionnel des États-Unis, de l’URSS et du Vatican. En effet, la communauté internationale craint plus que tout que les deux Espagnes ennemies ne se déchirent de nouveau et il faut reconnaître qu’un tel risque existait bel et bien. C’est la raison pour laquelle l’historiographie de la Transition parle soit de démocratie octroyée, soit de rupture négociée. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un processus de démocratisation par le haut, rendu possible grâce à la connivence croissante des modérés des deux bords politiques. Les secteurs les plus libéraux issus de la dictature contrôlent le processus de changement politique, en négociant ce qu’ils estiment être négociable avec une opposition démocratique qui n’est pas en mesure d’imposer la rupture bien qu’elle y ait indéniablement contribué. De fait, le déséquilibre des forces en présence ne pouvait être plus évident. D’un côté, une droite héritière de la dictature qui contrôlait tous les appareils du pouvoir et la majorité des médias et, de l’autre, les partis de gauche qui avaient incarné la résistance au franquisme et qui venaient à peine de sortir de la clandestinité. Relativement faible et très divisée, l’opposition accepte les règles édictées par le régime transitoire qu’incarnent Adolfo Suárez et Torcuato Fernández Miranda, le président des Cortes, avec l’aval de Juan Carlos. Au grand dam des opposants historiques au franquisme, le début du processus de transition vers la démocratie ne passe pas par la constitution d’un gouvernement provisoire de coalition réunissant les principales forces politiques de droite et de gauche et qui aurait convoqué une Assemblée constituante afin de décider de la forme de l’État à venir. La singularité de la Transition espagnole tient au fait que rien de cela ne s’est produit. Il n’y a pas eu de rupture réelle mais une réforme à partir du régime antérieur. C’est là le sens de la voie choisie par Adolfo Suárez, ne pas porter atteinte au régime précédent tout en permettant de passer à autre chose. Cette situation de fait provoque un véritable désenchantement chez nombre d’anciens républicains espagnols qui n’acceptent pas (et comment ne pas le comprendre !) que les responsables du déclenchement de la Guerre civile et de la dictature de presque quatre décennies qui lui a fait suite échappent à toute forme de procès, fût-ce symboliquement. La prétendue « réconciliation nationale » qui se produit alors va différer la confrontation des Espagnols avec leur passé. Lors de la Transition et pendant les quatorze années de gouvernement socialiste, entre 1982 et 1996, il n’y aura aucune politique de réparation à l’égard des victimes de la Guerre civile et de la dictature. Pour beaucoup d’Espagnols, le rejet de la dictature et des violations des droits de l’Homme dont elle s’est rendue coupable ne s’est pas inscrit comme une évidence dans la construction de leur culture politique. Il faudra attendre la fin des années 1990 et le début des années 2000 pour que cette question fasse pleinement irruption dans la sphère publique et politique, souvent de façon très passionnelle, comme dans le cas de l’exhumation des fosses communes de la Guerre civile et lors des nombreux débats qui déboucheront sur la promulgation de la Loi de la mémoire historique le 30 octobre 2007, sous le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero, soit trente ans après le début de la Transition démocratique.
Adolfo Suárez fut en fait le premier président du gouvernement nommé réellement par Juan Carlos depuis sa proclamation en tant que roi. Le moins que l’on puisse dire est que cette nomination prit de court toute la classe politique ainsi que l’opinion publique dans son ensemble. La décision de choisir Adolfo Suárez provoqua la stupeur, voire la franche opposition de la classe politique. En effet, nombreux étaient ceux qui pensaient que le choix de Juan Carlos allait se porter sur José María de Areilza, ministre des Affaires étrangères dans le précédent gouvernement d’Arias Navarro mais qui avait manifesté dans le passé une certaine hostilité à l’égard de Franco. Le choix définitif de Juan Carlos en faveur de Suárez ne peut se comprendre que si l’on tient compte du rôle joué par Torcuato Fernández Miranda, ancien précepteur du roi et protecteur de Suárez, nommé par Juan Carlos en décembre 1975 président des Cortes et du Conseil du royaume. À n’en pas douter, il s’agit là d’une des figures importantes de la Transition démocratique, un agent de liaison en quelque sorte, un fidèle du palais qui était convaincu que le franquisme sans Franco n’était pas viable. Comme le prévoyait la Loi organique de l’État (1967), le Conseil du royaume proposa trois noms au roi (Gregorio López Bravo, Federico Silva et Adolfo Suárez) qui correspondaient aux trois composantes du franquisme : un technocrate, un catholique et un phalangiste. Torcuato Fernández Miranda, avec un sens aigu de la diplomatie, réussit à faire accepter son candidat à un Conseil du royaume composé d’officiers, d’évêques et de phalangistes purs et durs, au nom de l’ouverture inéluctable du régime. Adolfo Suárez a alors quarante-trois ans et il appartient à la même génération que le roi avec qui il partage plusieurs passions, les deux hommes allant même jusqu’à se tutoyer. Au-delà de cette anecdote, ils partagent le souci de faire évoluer le système politique en le réformant de l’intérieur (Il faut aller de la loi à la loi comme le déclarait Fernández Miranda). La réforme consiste à faire voter par les Cortes une loi ayant une portée constitutionnelle et à la faire approuver ensuite par voie référendaire. Cette équation sous forme d’hara-kiri va transformer la vie politique espagnole et conduire progressivement à un système de démocratie représentative.
Le premier gouvernement formé par Adolfo Suárez est composé en majorité de ministres assez jeunes, ce qui témoigne d’une volonté de tourner la page. Adolfo Suárez n’avait que trois ans quand commença la Guerre civile. Il appartient donc à une génération espagnole beaucoup moins marquée par les préjugés idéologiques que la génération précédente. Dans un premier temps, le nouveau chef du gouvernement supprime définitivement le ministère de l’Information, l’un des symboles forts du franquisme. Le démantèlement de l’édifice franquiste peut commencer mais tout se fera en douceur car les tenants de l’immobilisme veillent au grain. L’approbation par les Cortes franquistes de la Loi pour la réforme politique le 18 novembre 1976 marque un net changement avec la période antérieure car Adolfo Suárez parle dorénavant clairement de démocratie et il souhaite créer les instruments nécessaires « afin que ce mot puisse s’exprimer avec authenticité » au sein de la société, selon ses propres termes. Cette loi fondamentale, rédigée notamment par Torcuato Fernández Miranda, Landelino Lavilla et Alfonso Osorio, fut approuvée par 425 députés (procuradores selon la terminologie des Cortes franquistes encore en vigueur), 59 votèrent contre et on releva 13 abstentions. C’était un succès écrasant mais qui avait supposé de longues et d’intenses négociations en amont entre le gouvernement et les procuradores qui, dans leur majorité, avaient compris que la conjoncture était désormais favorable au changement. Plus généralement, la réforme de l’État mise en place par le nouvel exécutif est le résultat de véritables débats au sein de la commission mixte (gouvernement et Conseil du Movimiento Nacional). En premier lieu, il faut neutraliser la droite franquiste, le « bunker », qui exerce un contrôle sur le processus engagé et qui pourrait faire capoter la réforme du fait de sa réelle capacité d’obstruction tant au sein du Conseil du royaume que dans les rangs du Conseil du Movimiento Nacional. En outre, Adolfo Suárez instaure une politique de dialogue avec les partis politiques de l’opposition en accordant notamment une première amnistie aux prisonniers politiques. La Loi pour la réforme politique prévoyait le maintien de l’institution monarchique, la transformation des Cortes franquistes en deux chambres (un Congrès des députés et un Sénat) élues au suffrage universel direct et disposant de véritables pouvoirs législatifs. L’article premier affirmait les notions de « démocratie » et de « souveraineté du peuple ». Le texte de la loi prévoyait son adoption par référendum. Or, l’opposition démocratique était divisée car si les secteurs les plus modérés acceptaient la tenue d’un référendum et faisaient campagne pour le oui, les forces de gauche prônaient l’abstention, à l’instar de la Platajunta créée quelques mois auparavant. La campagne pour le référendum se déroula dans un climat d’agitation politique et de violence qui provoqua la mort de plusieurs Espagnols lors de heurts violents entre des manifestants et la police qui n’avait rien perdu de ses pratiques très répressives. Finalement adoptée à une très large majorité lors du référendum du 15 décembre 1976, avec 94 % de suffrages favorables et une participation de 77,7 %, la Loi pour la réforme politique constitue une pièce maîtresse dans l’évolution complexe de l’Espagne vers la démocratie. La Couronne commence alors à bénéficier d’une légitimité rationnelle, impensable peu de temps auparavant, et elle récupère aussi symboliquement sa légitimité traditionnelle aux yeux d’une majorité d’Espagnols.
Fort des résultats du référendum, le gouvernement est dorénavant en mesure de mettre en pratique le démantèlement des institutions de la dictature et de préparer la tenue des premières élections libres. Aussi le premier conseil des ministres de l’année 1977 décrète-t-il la suppression pure et simple de la Loi de juridiction de l’ordre public. Puis cette entreprise de démantèlement touche les organismes les plus importants de la dictature : le Conseil national et le secrétariat général du Movimiento Nacional, dissous le 1er avril soit le jour de la victoire de Franco en 1939, ainsi que le tristement célèbre Tribunal pour l’ordre public (TOP) ou encore l’Organisation syndicale. Les Espagnols assistent bel et bien à l’enterrement du régime de Franco. On peut parier que personne ne versa de larme à cette occasion à l’exception des partisans inconditionnels d’un régime obsolète dorénavant rejeté par la plupart de la population. De plus, la Loi pour la réforme politique conférait au gouvernement présidé par Adolfo Suárez une réelle légitimité qui allait lui permettre de préparer les premières élections démocratiques après quarante ans de vie politique dépourvue de tout pluralisme. Car si l’Espagne n’était plus une dictature militaire, elle n’était pas encore une démocratie bien qu’elle en prît le chemin.
2. La Loi d’amnistie et les premières élections démocratiques
Quelles sont les forces en présence sur l’échiquier politique au début de l’année 1977 ? En premier lieu, il faut compter avec les partis historiques. Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), le Parti communiste (PCE) pour les formations d’audience nationale et les partis nationalistes, le Parti nationaliste basque (PNV) pour le Pays basque et ERC en Catalogne, c’est-à-dire la formation nationaliste de la gauche républicaine créée en 1931. S’ajoutent à ces derniers le jeune Parti socialiste populaire d’Enrique Tierno Galván (PSP), fondé en 1969, ainsi que de nouveaux partis nationalistes ou indépendantistes qui sont apparus en Catalogne, au Pays basque mais aussi en Galice, en Andalousie ou dans le Pays valencien.
À la veille de la Transition, le PSOE se remet à peine de ses propres divisions internes entre direction historique en exil (incarnée par Rodolfo LLopis) et jeunes rénovateurs de l’intérieur (Felipe González, Alfonso Guerra, Manuel Chaves). Afin d’apparaître comme la principale force de la gauche, le PSOE se doit avant tout d’unifier la famille socialiste. Cela peut expliquer pourquoi aucun accord n’est conclu avec les autres formations antifranquistes avant la création plutôt tardive de la Platajunta puisqu’elle ne se produit qu’en avril 1976. Pour sa part, le gouvernement entreprend tout d’abord de légaliser les partis politiques, à l’exception du PCE dont le secrétaire général est, depuis 1960, Santiago Carrillo. Il faut reconnaître que la légalisation du PCE représente l’un des problèmes les plus délicats à résoudre. Le gouvernement n’a pas la tâche facile car d’un côté il craint la réaction violente de l’armée et de la droite, et de l’autre, l’opposition démocratique n’acceptera pas d’aller plus en avant dans les négociations sans la légalisation du PCE, parti qui symbolise la résistance au franquisme et qui doit, par conséquent, avoir pleinement droit de cité dans cette Espagne en mutation. Le pouvoir en place vit une crise politique intense dont la démission avec perte et fracas du ministre militaire de la Marine, l’amiral Gabriel Pita da Veiga, un ami intime de Franco qui entendait manifester ainsi son anticommunisme viscéral, constitue un signe évident. Cependant, le pouvoir doit absolument légaliser le PCE pour que la tenue des premières élections libres soit acceptée par l’opinion publique espagnole et internationale. L’absence du PCE lors des premières élections post-franquistes aurait signifié à court terme l’échec des réformistes regroupés autour d’Adolfo Suárez tant au plan national qu’aux yeux des démocraties du reste du monde, attentives à l’évolution de l’Espagne.
Puisqu’il faut donner des gages de crédibilité, le 1er avril le gouvernement prend la décision de dissoudre le Movimiento Nacional, c’est-à-dire le parti unique du régime franquiste. Le 9 avril, en pleine Semaine sainte et pendant la nuit du dimanche de la Résurrection (le symbole est manifeste) la légalisation du PCE est rendue publique par un décret gouvernemental. Immédiatement, l’armée, par l’intermédiaire de son Conseil supérieur, émet une vive protestation mais accepte finalement cette mesure au nom de la « discipline et du patriotisme ». En échange et afin de contenir le courroux de certains hauts gradés, le gouvernement d’Adolfo Suárez exige une reconnaissance sans ambiguïté de la monarchie et de l’unité de l’Espagne qui passe symboliquement par une acceptation du drapeau national bicolore (rouge et jaune d’or). Ainsi, le PCE renonce au drapeau républicain tricolore et, par là même, à l’instauration d’un régime républicain en Espagne. Pour les communistes regroupés autour de Santiago Carrillo, l’urgence consiste donc à tourner rapidement la page de la dictature, quitte à renoncer à certains principes tactiques, stratégiques et symboliques, voire idéologiques. Les tractations, pour complexes qu’elles soient, n’en sont pas moins claires : reconnaissance mutuelle mais uniquement dans le cadre de la monarchie. Si le PCE n’avait pas reconnu la monarchie, la Transition eût été difficile, voire impossible. Pour mener à bien cette transition politique, le choix ne reposait donc pas entre monarchie et république mais bel et bien entre dictature et démocratie. En mai 1978, alors que les débats autour de la rédaction de la Constitution battent leur plein, Santiago Carrillo affirme que « mettre sur le tapis la question de la république, ferait courir le risque d’une aventure catastrophique au cours de laquelle nous n’obtiendrions pas la république et nous perdrions la démocratie. » Et le leader communiste d’ajouter que « choisir l’option républicaine équivaudrait à forcer le maintien du blocage entre réformistes et ultras et à différer sine die la sortie de la dictature20. »
Quelle était l’attitude des socialistes à cet égard ? Le questionnement sur la nature d’un État postfranquiste avait déjà traversé le PSOE en exil, quelque trente ans auparavant, puisque l’un de ses leaders historiques, Indalecio Prieto, alors fermement opposé à la ligne de Juan Negrín, avait envisagé en 1948 la possibilité de constituer un front antifranquiste avec les monarchistes réunis au sein de la Confédération des droites monarchistes, des fidèles de don Juan de Borbón, le père de Juan Carlos21. Au début de la Transition, le comportement du PSOE vis-à-vis de la monarchie fut à tout le moins ambigu. In fine, le PSOE ne souhaitait pas renverser la monarchie, il voulait surtout élargir son espace électoral au détriment des communistes du PCE. L’une des obsessions de la direction du PSOE était d’éviter à tout prix une évolution à l’italienne, à savoir une gauche dominée par un parti communiste majoritaire (le PCI d’Enrico Berlinguer obtenait alors des scores d’environ 30 % aux élections générales italiennes).
Quoi qu’il en soit, face à la légalisation du PCE les secteurs les plus réactionnaires de la société et a fortiori des forces armées ne se privent pas d’exprimer leur profonde répulsion face à cette évolution qui voit les subversifs d’hier, devenir de simples adversaires politiques. Ceux que l’on persécutait, emprisonnait, torturait et condamnait il y a peu au nom de la lutte contre la « subversion rouge », pour le dire avec les termes de la propagande franquiste, deviennent soudain de respectables opposants politiques qui siègent aux Cortes. La pilule est dure à avaler pour plus d’un et elle le sera d’autant plus que deux jours plus tard, le gouvernement Suárez décide de légaliser les centrales syndicales de gauche, ce qui entraîne ipso facto la démission du général De Santiago de ses fonctions de vice-président à la Défense, en septembre 1976. Cette démission fait suite à celle du ministre de la Marine. Pour les forces réactionnaires, chaque pas que fait le gouvernement vers la démocratie est vécu comme une trahison. L’entrée du Parti communiste dans le cadre politique légal, puisqu’il cesse d’être le parti clandestin de la résistance au franquisme, marque véritablement la fin d’une ère et le début d’une voie démocratique, certes encore balbutiante mais sur laquelle l’Espagne se trouve désormais résolument engagée. Selon Santiago Carrillo lui-même, la légalisation du Parti communiste a représenté « l’acte le plus sérieux de rupture avec le passé ». Quant à Adolfo Suárez, il prend le risque de jouer à ce moment là contre une partie de son propre camp, c’est-à-dire contre la droite ultra et la majorité de l’armée. Mais c’est un pari réussi puisque les militaires restent cantonnés dans leurs casernes et n’entreprennent aucune action séditieuse dans les heures et les jours qui suivent la nouvelle de la légalisation du PCE et des syndicats de travailleurs. Ne serait-ce que pour cette raison, Adolfo Suárez peut légitimement apparaître comme l’une des figures fondamentales de la transition vers ...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Copyright
- Titre
- Introduction
- Chapitre I. La lente agonie du régime franquiste
- Chapitre II. le franquisme sans Franco
- Chapitre III. Construire la démocratie
- Chapitre IV. Une transition parsemée d’embûches
- Chapitre V. La consolidation de la démocratie représentative
- Épilogue
- Chronologie
- Bibliograhie
- Table des matières