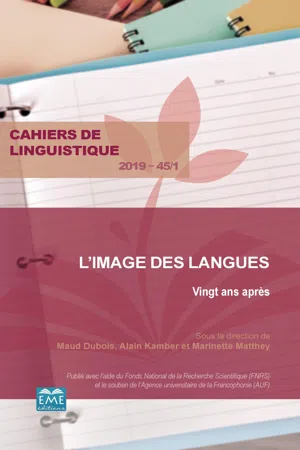
- 270 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Contributeurs: Marinette MATTHEY, Alain KAMBER, Maud DUBOIS, Philippe HUMBERT, Alexei PRIKHODKINE, Laurent GAJO, Anne-Christel ZEITER, Antonia VEILLON, Henri BOYER, Bénédicte PIVOT, Sara COTELLI KURETH, Liliane MEYER PITTON, Simone MARTY, Martina ZIMMERMANN, Annette BOUDREAU, Etienne MOREL, Clara MORTAMET, Marion DIDELOT, Isabelle RACINE, Alice KRIEG-PLANQUE
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à L'image des langues par Maud Dubois,Alain Kamber,Marinette Matthey en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Languages & Linguistics et Linguistics. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
LinguisticsLA VARIATION AU CŒUR DES REPRÉSENTATIONS
« Pas d’place pour les fote d’ortho » : la réparation en *et l’accomplissement situé des représentations langagières dans la communication par WhatsApp
Etienne MOREL
Université de Neuchâtel/Zurich
1. Étudier les pratiques graphématiques :
ortho et néo pour qui ?
L’échange de textos par le biais d’applications installées sur les téléphones intelligents occupe une place centrale dans les interactions quotidiennes : en juillet 2017, la messagerie instantanée WhatsApp comptait environ 1 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde et permettait l’échange de 55 milliards de messages par jour1. Quoique très appréciée par les utilisateurs, la communication par texto2 est aussi une source d’inquiétudes en ce qu’elle semble défier les normes de la langue telles qu’elles ont été institutionnellement mises en place et telles qu’elles sont diffusées et défendues par les institutions, notamment par l’école. Dans une récente enquête menée par les universités de Berne et Neuchâtel auprès de 631 participants3 à propos des représentations sociales sur l’orthographe dans le contexte de l’écrit numérique, le jugement à propos de l’impact de l’utilisation de WhatsApp sur la maitrise de l’orthographe est sévère : 60,5 % (N=307)4 des participants sont d’accord ou plus ou moins d’accord pour dire que les services de messagerie numérique ont une mauvaise influence sur les compétences des individus en termes d’orthographe.
Si les participants à l’enquête affirment majoritairement attacher de l’importance à l’orthographe, il est intéressant de noter que les attentes normatives des participants sont nettement plus élevées pour les Francophones que pour les autres langues : à la question quelle importance ils attachaient à leur propre orthographe dans la communication par WhatsApp, 76,2 % (N=147) des Francophones indiquent y porter beaucoup ou énormément d’importance, alors que 64,8 % (N=46) des Italophones, 64,4 % (N=40) des Germanophones et 46,8 % (N=37) des Dialectophones donnent la même réponse (pour une présentation détaillée de l’enquête, voir Morel & Natale 2019)
Le fait que l’orthographe française, peut-être plus que celle d’autres langues encore, puisse être considérée comme une « question sociale » (Paveau & Rosier 2008) s’explique en grande partie par les tensions qui découlent de la combinaison de principes phonographiques et idéographiques qui lui sont propres (Blanche-Benveniste & Chervel 1969). En français, l’orthographe ne se limite en effet guère à rendre la prononciation d’un élément (principe phonographique), mais elle encode des informations supplémentaires par des ressources purement graphiques (principe idéographique). Il s’agit notamment d’informations d’ordre grammatical, de morphogrammes grammaticaux, liés à la désinence verbale (tu marches) ou nominale (de bons livres). D’autre part, l’orthographe française encode aussi souvent des informations d’ordre dérivationnel et étymologique, elle recourt donc également à des morphogrammes lexicaux (Catach 1980) ; à titre d’exemple, le mot tard contient la lettre d qui, bien que non prononcée, permet de renvoyer à la racine latine du mot (tarde) et de maintenir une certaine homogénéité graphique à l’intérieur de la même famille dérivationnelle (notamment avec l’adjectif tardif ou le verbe retarder).
Cette tension entre phonographie et morphographie devient particulièrement visible dans un contexte communicationnel comme celui du texto, qui est souvent associé à la rapidité et à la spontanéité : c’est dans un tel contexte que les participants, pour des raisons liées à l’efficacité, mais aussi à la créativité, procèdent à des modifications orthographiques diverses. Ainsi, en plus de recourir à des procédés abréviatifs et expressifs avec impact sur l’identité sonore des éléments concernés, les participants peuvent également omettre (ils parle pour ils parlent), permuter (méson au lieu de maison) ou même ajouter des graphèmes (seau riz pour sorry) sans que cela ait forcément une influence sur la prononciation présumée de l’item (voir Béguelin 2012 ; Cougnon & Fairon 2014 ; Panckhurst 2009 ; Reinkemeyer 2013).
Contrairement aux idées reçues, la recherche s’accorde à dire que ces types de variation graphématique ne représentent pas un danger pour la maitrise de l’orthographe par les individus (Cougnon et al. 2017) et qu’elle ne mérite donc pas la réprobation sociale dont elle fait souvent l’objet. En réalité, elle serait une ressource de valorisation sociale permettant aux participants de s’inscrire dans une même catégorie collective et de s’afficher comme membres pleinement légitimes d’un certain groupe social (Jaffe et al. 2012 ; Morel 2017). Ce constat est corroboré par le fait que les participants sont le plus souvent capables d’identifier les normes de l’écrit momentanément pertinentes et qu’ils déploient alors les ressources qui sont en adéquation avec celles-ci (Cougnon et al. 2017). Ainsi, les scripteurs sauraient faire la différence entre différents types d’écrit, notamment entre un écrit traditionnel (Bernicot et al. 2015) et, par exemple, un écrit conforme aux attentes sociales de la communauté de « texteurs ». Cependant, alors que la recherche a souligné, de façon certes adéquate, la légitimité de la variation graphématique, elle a également contribué, de manière plus problématique, à échafauder une vision bien homogène à propos des pratiques graphématiques considérées comme propres à la communication par texto : la recherche concourt en quelque sorte à renforcer des représentations sociales hautement stéréotypées à propos de pratiques langagières prétendument caractéristiques pour ce contexte communicationnel.
En effet, lorsqu’il s’agit de décrire la variation graphématique, la recherche mobilise des concepts tels que la nouveauté (d’où le terme néographie), l’acceptabilité (Meredith & Stokoe 2014), l’écriture non conventionnelle (Anis 2007) et distingue entre textismes, intentionnés et légitimes, et ratages orthographiques, implicitement sous-entendus comme problématiques (voir Maskens et al. 2015). Ce faisant, elle court le risque de décrire la variation en appliquant des dispositifs de catégorisation en soi hautement normatifs, utilisés en surplomb des activités auxquelles s’adonnent les participants et en négligeant la manière dont les pratiques sont catégorisées, en tant que déviantes ou non, nouvelles ou non, légitimes ou non, par les participants eux-mêmes.
L’analyse des détails de l’interaction peut alors offrir un complément descriptif intéressant en ce qu’elle donne à voir la manière dont les représentations sociales de la langue sont localement mises en pratique. Si l’on considère l’exemple (1), tiré d’un large corpus de messages WhatsApp (voir infra pour une présentation du corpus), on observe comment l’étude des structures mêmes de l’interaction peut servir de base à une telle approche praxéologique des représentations linguistiques (Petitjean 2011).

Dans le message [3], le participant corrige un item du message précédant ([2] faut) en envoyant un nouveau message contenant l’élément corrigé accompagné d’un astérisque (faux*). Par la reprise, il montre à son interlocuteur que l’item qu’il corrige est potentiellement problématique et rend par là visible quelles sont les attentes normatives localement valables. C’est précisément en nous intéressant à ce type d’activité interactionnelle que nous explorerons ici les implications d’une perspective praxéologique sur les représentations sociales liées à « l’écrire juste ».
L’activité corrective réalisée par le recours à l’astérisque peut être comprise comme disposition spécifique du phénomène interactionnel appelé réparation. La réparation peut être définie comme suit :
« […] a conversational mechanism by which a speaker interrupts the ongoing sequence of talk in order to deal with problems in hearing, speaking, or understanding. »5 (Schegloff et al. 1977, 363)
À l’instar de Schegloff et al. (1977), nous utiliserons le terme de réparation plutôt que celui de correction en ce qu’il est à la fois plus englobant et plus descriptif. La correction présuppose d’une part qu’une erreur ait été faite et d’autre part que cette erreur soit remplacée par un élément correct. En réalité, la réparation est souvent aussi effectuée en l’absence d’erreur et un remplacement de l’erreur par un item correct n’est pas toujours proposé (Schegloff et al. 1977, 363). Par ailleurs, la question de la perspective sur le statut du réparable en tant qu’erreur avérée ou non pose problème : Meredith & Stokoe (2014, 186) considèrent par exemple que la correction est une classe de réparation spécifique où l’élément réparé contient une « erreur effective » (actual error). L’existence d’une norme objective, indépendante de l’activité située des participants, est alors prise comme point de départ de la distinction. Nous préférons ici subsumer notre objet d’étude sous l’étiquette de la réparation et utiliserons cette ressource analytique pour décrire non pas ce qui doit être considéré comme faux du point de vue du chercheur, mais pour comprendre ce qui est traité comme réparable par les participants eux-mêmes (repairable ou trouble source ; Schegloff et al. 1977, 363).
La question centrale de cette recherche est de comprendre quand les participants recourent à la réparation et comment ils y procèdent pour comprendre également pourquoi ils le font. Pour notre corpus et au vu de l’importante composante purement idéographique de l’orthographe française, il se pose la question de savoir si les participants réparent principalement lorsque la réparation a un impact sur l’identité phonographique de l’élément (Meredith & Stokoe 2014, 192) ou si la réparation porte également sur le « surplus orthographique » (Blanche-Benveniste 2003, 345) donc sur ces éléments idéographiques (morphogrammes grammaticaux et lexicaux) qui ne sont a priori pas essentiels à la compréhension du message. Si...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Copyright
- Titre
- Cahiers de Linguistique
- Sommaire
- Introduction
- DU CADRE POLITIQUE À L’INDIVIDU APPRENANT
- POLITIQUES LINGUISTIQUES EN CONTEXTE
- BILINGUISME VÉCU, PERCEPTION DES LANGUES EN CONTACT
- LA VARIATION AU CŒUR DES REPRÉSENTATIONS
- Un bouquet de revues de linguistique française