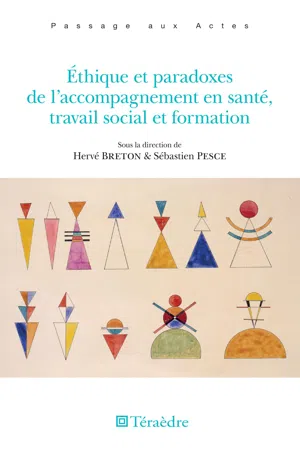![]()
Première partie
Éthique de l’accompagnement en santé et éducation thérapeutique
![]()
Prendre part et agir dans le monde : l’accompagnement des personnes utilisatrices à la gouvernance des services de santé mentale au Québec
Michèle Clément
En 2005, le gouvernement du Québec s’est doté d’un Plan d’action en santé mentale (MSSS, 2005) ayant pour objectif, entre autres choses, de valoriser et de mettre en œuvre la participation des usagers aux dispositifs de gouvernance des services de santé mentale. Pour répondre à cette orientation, le milieu communautaire s’est investi dans une démarche d’accompagnement afin de permettre aux personnes utilisatrices de services de se constituer en regroupement autonome et d’acquérir les habiletés nécessaires pour prendre part aux débats qui ont lieu au sein de ces dispositifs. Dans le présent texte, je me propose de revenir sur cet accompagnement et de dégager les principaux enjeux éthiques qui en ont résulté.
La démarche proposée est la suivante : je reviendrai d’abord sur le contexte dans lequel a émergé au Québec la participation publique des personnes utilisatrices de services de santé mentale (PUS-SM dans la suite de ce texte) ainsi que sur les acteurs mobilisés par cette participation. J’insisterai par la suite sur les alliances qui se sont tissées au fil du temps entre les PUS-SM et le milieu communautaire ainsi que sur les mesures d’accompagnement déployées par ce dernier afin de permettre aux PUS-SM de s’organiser en regroupements distinctifs et de s’intégrer aux dispositifs de gouvernance. J’illustrerai enfin comment l’arrivée de l’utilisateur de services en tant que figure spécifique de représentation au sein de la gouvernance a partiellement transformé les rationalités avec lesquelles ils avaient jusqu’ici fonctionné, de même que les liens qu’ils ont historiquement entretenus avec le milieu communautaire. Ce sera également le moment de revenir sur les tensions et les contradictions de l’accompagnement offert aux PUS-SM, mais aussi sur les questions éthiques qui en résultent désormais.
La participation publique en santé mentale : contexte et acteurs
Depuis plusieurs décennies, la participation publique à la gouvernance est une des valeurs phares du système de santé au Québec (Forest et al., 2003 ; O’Neill, 1992). Celle-ci est encadrée par des méthodes mises en place par l’État, lequel « (.) invite des citoyennes et citoyens à participer, à divers degrés, à la prise de décision, à titre d’acteurs de la société ancrés dans des pratiques (professionnelles, politiques ou communautaires) et des contextes sociaux ou politiques spécifiques, ou à titre d’individus représentatifs de la population » (Conseil de la santé et du bien-être, 2004 : 14). La participation agit donc à l’intérieur du système – ici celui de la santé – et consiste à prendre part au processus de décision publique avec un pouvoir plus ou moins étendu.
Ce type de participation remonte à la naissance même du système de santé au Québec, quoique c’est beaucoup plus tardivement qu’il s’est développé dans le champ de la santé mentale (OMS, 1989). En effet, si les initiatives d’implication des PUS-SM à la gouvernance du système de santé remontent aux années 1980, ce n’est qu’avec le Plan d’action en santé mentale de 2005-2010 (PASM) que leur participation s’est réellement officialisée et est devenue incontournable dans le champ de la santé mentale. Dans ce plan, on y retrouvait un énoncé à l’effet que « le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les agences de la santé et des services sociaux (ASSS) et les Centres de santé et de services sociaux (CSSS) s’assureront [à l’avenir] d’obtenir la participation d’utilisateurs de services en santé mentale, de représentants des familles ou de proches dans l’exercice de planification et d’organisation des services qui les concernent » (MSSS, 2005 : 16).
Ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) signifie par cette directive c’est que les PUS-SM sont désormais des acteurs incontournables, spécifiques et distinctifs dans la gouvernance du système de santé et, de ce fait, ne sont plus assimilables à leur traditionnel interlocuteur qu’a été le milieu communautaire, lequel a pendant longtemps porté leur voix dans les exercices de gouvernance. Jusque-là, il importe de le souligner, il n’y avait que très peu de regroupements d’individus se définissant en tant qu’« usagers des services de santé mentale ». Certes, plusieurs groupes d’entraide existaient et l’implication de ceux que l’on nomme aujourd’hui « usagers » ou « personnes utilisatrices de services » a toujours été importante au sein des groupes communautaires (groupes associatifs). Mais, contrairement aux États-Unis et à plusieurs pays d’Europe, avant 2015 il n’y avait pas au Québec d’entités associatives se définissant en rapport explicite avec le système public de soins et services en santé mentale, exception faite toutefois des comités d’usagers et de résidents. Ces derniers, rappelons-le, ont pour mandat d’œuvrer à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie à l’intérieur d’un établissement spécifique. Par conséquent, ils n’avaient aucune implication objective dans la gouvernance générale du système public de soins et services en santé mentale.
Outre la reconnaissance des usagers en tant que groupe distinct, la directive du PASM 2005-2010 citée plus haut vient également affirmer, quoique de manière implicite cette fois, qu’il existe un savoir spécifique – un savoir d’expérience – associé au fait d’avoir vécu et utilisé des services publics pour un problème de santé mentale et que ce savoir est profitable aux exercices de gouvernance. En partageant ce savoir, la personne peut faire part de ses souffrances, de sa maladie, de son point de vue sur les services et les soins. Le cas échéant, elle témoigne également de son expérience dans les organismes communautaires et des diverses préoccupations qu’elle peut avoir : pauvreté, consommation, expériences professionnelles, habitation, stigmatisation, etc. (Godrie, 2016). En d’autres termes, on reconnaît que la mise en récit de ce savoir expérientiel est suffisamment forte et riche pour engager des changements au cœur même du système de soins (Absil & Van Leberghe, 2013) ; il s’agit d’un savoir complémentaire et supplétif.
Pour répondre à la convocation qui leur a été faite via la directive du PASM, les PUS-SM ont toutefois dû « » s’organiser » collectivement pour assurer leur représentation dans les dispositifs de gouvernance ; le « cas par cas » a fait place aux regroupements d’usagers. C’est avec l’appui et l’accompagnement indéfectibles du milieu communautaire que les PUS-SM ont pu cheminer dans cette direction et s’organiser en regroupements. Aujourd’hui, d’ailleurs, la plupart des régions du Québec possèdent une entité associative de PUS-SM se définissant dans un rapport explicite avec le réseau public de soins et services en santé mentale (Clément et al., 2012).
Le fait d’être organisé en regroupements et associations a pour effet de donner au savoir d’expérience une dimension collective. Désormais, dans les dispositifs de la gouvernance, les PUS-SM ne parlent plus au « je », mais au « nous ».
[...] [le savoir d’expérience] [...] comprend une dimension collective de par les similarités entre les différentes expériences sur le plan des symptômes, de l’expérience de soins dans le RSSS [réseau de la Santé et des Services sociaux] ou des conséquences sociales de la maladie. En plus d’avoir une valeur pour la personne et ses proches, l’expérience contribue à la création d’un nouveau savoir (Godrie, 2016) qui pourra constituer un levier important d’autodétermination pour toutes les personnes atteintes d’un trouble mental et les membres de leur entourage. Ce nouveau savoir est aussi d’une grande richesse, tant du point de vue clinique que du point de vue organisationnel. (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2016 : 5)
Reposant sur les résultats d’études réalisées cinq ans après la mise en œuvre du PASM de 2005, lesquelles avaient pour objectif de faire un état de la situation de la participation des PUS-SM dans les dispositifs institutionnels de gouvernance (Clément, 2012 ; Clément et al., 2012), je propose ici de revenir plus spécifiquement sur l’exercice d’accompagnement des PUS-SM par le milieu communautaire. Au préalable, il importe toutefois de préciser l’alliance historique existant entre eux.
Les PUSM et le milieu communautaire : une alliance historique
La désinstitutionalisation des services de santé mentale est le point de départ d’une alliance forte entre les « ex-psychiatrisés », comme on les appelait à l’époque, et le milieu communautaire. C’est à ce moment qu’en étroite collaboration avec les PUS-SM le milieu communautaire s’engage dans un mouvement de contestation des hôpitaux psychiatriques et du modèle biomédical centré sur la maladie, les symptômes et le traitement (Lecomte, 2008 ; Rodriguez del Barrio et al., 2006). De ce mouvement – et c’est là un trait distinctif du Québec – émerge une multitude d’initiatives développées sous la gouverne d’un « ailleurs » et d’un « autrement », ce que l’on peut retraduire par le fait que l’hôpital et le traitement traditionnel de la maladie mentale font partie du problème, et qu’il faut par conséquent créer et valoriser un « ailleurs » comme lieu de traitement et un « autrement » comme façon de faire. À cela, il faut aussi ajouter la place importante que va prendre la question de la défense de droits des personnes vivant avec un trouble mental dans le milieu communautaire. Depuis toujours, en somme, le milieu communautaire s’est révélé être un allié naturel des PUS-SM et a joué pour elles le rôle de porte-parole devant l’institution psychiatrique et le système de santé en général.
Autre trait marquant l’alliance entre le milieu communautaire et les PUS-SM est la place historiquement donnée à ces dernières dans les structures administratives et de fonctionnement des organismes. Dans ce contexte, on peut définir la participation des PUS-SM comme un processus social d’implication volontaire dans des activités formelles et informelles ainsi que dans des discussions à des fins de changement ou d’amélioration de la vie des participants (Bracht, 1990). Même s’il existe une très grande variabilité dans l’étendue de la participation au sein des organismes du milieu communautaire (Duperré, 2010), la plupart d’entre eux leur réservent des sièges dans les conseils d’administration. Il n’est pas rare, non plus, que les PUS-SM soient impliquées dans la formation et le recrutement du personnel. Parfois aussi, elles participent à la planification et à l’évaluation des services.
Au cœur de cette mouvance, il ne faut pas oublier l’importance prise par les groupes d’entraide issus du milieu communautaire, lesquels valorisent le récit de soi, mettent l’accent sur l’écoute, le soutien affectif et le partage d’informations (RRASMQ, 2009 ; Self-Help Resource Centre, 2013). Bien que l’objectif des groupes d’entraide ne soit pas de se rassembler pour participer à la gouvernance du système de santé, mais plutôt de partager des expériences et en guérir, on peut néanmoins affirmer qu’ils ont été les premières formes spécifiques et distinctives d’associations de PUS-SM (Diamond et al., 2003).
L’alliance entre les PUS-SM et le milieu communautaire, datant du début des années 1960, va cependant prendre une nouvelle orientation suite à l’adoption du Plan d’action en santé mentale de 2005-2010 (MSSS, 2005), en ce sens que le milieu communautaire s’est engagé dans une initiative d’accompagnement en vue de coaliser sur une base autonome les PUS-SM.
Accompagner la reconnaissance et le pouvoir d’agir des PUS-SM
La participation des personnes utilisatrices de services et des membres de leur entourage est une pratique inscrite dans la loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), de même que dans d’autres documents qui encadrent le réseau public québécois de la santé et des services sociaux. Ainsi, la LSSS : « [...] établit un mode d’organisation des ressources humaines, matérielles et financières destiné à assurer la participation des personnes et des groupes qu’elles forment au choix des orientations, à l’instauration, à l’amélioration, au développement et à l’administration des services [...] ».
Toutefois, avant l’adoption en 2015 du PASM, lorsque le milieu institutionnel souhaitait la présence d’une ou de plusieurs PUS-SM dans ses dispositifs de participation, il s’adressait aux organismes communautaires ; c’est eux qui en assuraient le recrutement. Les PUS-SM ainsi mobilisées s’impliquaient alors sur une base personnelle dans les lieux où leur présence était souhaitée, c’est-à-dire qu’elles participaient en mettant en valeur leurs propres perceptions, points de vue et expériences. Aucun rôle particulier ne leur était en fait conféré, aucune attente particulière ne leur était exprimée tandis que leur présence demeurait largement contingente.
La directive du PASM stipulant que les établissements « devront désormais s’assurer de la présence des PUS-SM dans les exercices de planification et d’organisation des services » va toutefois changer cette pratique. La présence des PUS-SM ne peut plus être hasardeuse et arbitraire. Elle doit désormais répondre à de nouvelles règles. D’abord, elles sont reconnues en tant qu’actrices spécifiques, distinctes et incontournables de la gouvernance. C’est dans ce contexte qu’elles ont dû se doter d’un fonctionnement rendant compte non plus du point de vue personnel d’une PUS-SM, mais bien du point de vue collectif « des » PUS-SM et que, devant ces nouvelles règles, le milieu communautaire a été appelé à s’investir progressivement dans un exercice d’accompagnement pour qu’elles se dotent de structures collectives de participation, lesquelles ont été élaborées à l’intérieur d’une initiative nommée « Cadre de partenariat pour la mise en place des rencontres régionales de personnes utilisatrices de services de santé mentale ».
Plus spécifiquement, c’est l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGTDD-SMQ), soit un organisme communautaire à vocation provinciale (Québec), qui a dévelop...