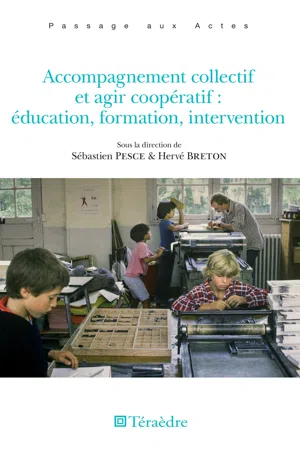
eBook - ePub
Accompagnement collectif et agir coopératif : éducation, formation, intervention
- 244 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Accompagnement collectif et agir coopératif : éducation, formation, intervention
À propos de ce livre
Issu du colloque « Éthique de l'Accompagnement et Agir Coopératif », organisé à l'université de Tours en mai 2016, cet ouvrage propose à un ensemble de praticiens de l'accompagnement collectif, issus de champs professionnels et d'espaces géographiques divers, de mettre en perspective leurs démarches d'accompagnement collectif. Chaque contributeur donne à voir la réalité la plus concrète des dispositifs conçus et mis en oeuvre, avant d'en analyser les sources, les conditions et les effets. Les textes rassemblés dans cet ouvrage permettent ainsi, en partant de la réalité du terrain, d'interroger les conditions pratiques et théoriques d'un « agir coopératif » dans les métiers de la relation à autrui.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Accompagnement collectif et agir coopératif : éducation, formation, intervention par Sébastien Pesce,Hervé Breton en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Education et Education General. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
EducationSujet
Education GeneralPremière partie
Démarches d’accompagnement en formation
Agir collectivement pour mieux accompagner. Présentation d’une démarche de régulation développée en formation de formateurs d’adultes par alternance
Hugues Pentecouteau
Dans un article de synthèse publié dans la revue Savoirs, Maela Paul écrit que l’accompagnement est un « terme irritant » car il apparaît comme étant un « véritable fourre-tout » (Paul, 2009b). Outre la pluralité de définitions dont il est l’objet, le terme « accompagnement » décrit une diversité d’usages (Paul, 2009b et 2016), dont certains peuvent être parfois éloignés d’une visée émancipatrice (Paul, 2016 : 30-31). Lorsque cette visée est maintenue, l’ingénierie de l’accompagnement offre un véritable enjeu formatif permettant d’envisager le développement durable du sujet (Poulin, 2015). Au service de l’apprenant, en développant une acquisition de compétences, générales ou spécifiques à un domaine particulier, cette ingénierie devient un espace de création (Clénet, 2013), pouvant être modulé et adapté afin de correspondre au mieux aux besoins de formation, d’acquisition de compétences nouvelles et de reconnaissance sociale des stagiaires.
Ce texte propose une lecture critique de l’expérimentation d’un accompagnement polymorphe développé dans des formations de formateurs d’adultes, organisées en alternance à l’université Rennes 2. La question de l’ajustement de l’accompagnement collectif des stagiaires par l’ensemble de l’équipe pédagogique se pose de manière plus forte dans ces dispositifs par rapport à des formations sans alternance, car les lieux d’apprentissage étant multiples, il est nécessaire de permettre aux différents acteurs de la formation (tuteurs professionnels, stagiaires, intervenants professionnels et universitaires) de pouvoir travailler en synergie. Ce qui est interrogé ici, c’est la régulation d’une démarche formative collective pour ajuster des formes d’accompagnement en fonction des besoins exprimés par les adultes en formation.
Dans une première partie sont présentés la structure de ces formations ainsi que les principes formatifs et organisationnels partagés par les différents acteurs (une culture commune, une éthique et des valeurs collectives). Dans une seconde partie, ce sont les apports et les limites de cette organisation qui seront questionnés, à partir d’une démarche de recherche-action-formation (Gaulier & Pesce, 2015) qui nous a conduits à créer un outil de régulation. Les données recueillies permettent, à partir des réponses produites par les stagiaires, d’adapter le suivi de la formation en proposant des formes d’accompagnement spécifiques.
Agir collectivement pour mieux accompagner
L’ingénierie de formation qui est développée dans ces formations de formateurs en alternance s’appuie sur quatre principes : une évaluation de formation progressive et continue, une alternance intégrative, une démarche formative collectivement partagée et la mise en place d’un accompagnement adapté aux différentes situations rencontrées.
Une évaluation de formation, progressive et continue
Le sens commun du terme « formation » est polysémique. Quand nous l’employons ici, c’est en considérant qu’il s’agit à la fois d’un processus et d’un dispositif. La formation est un processus car elle se déroule dans une temporalité définie par un projet comprenant lui-même différentes étapes. Elle est également un dispositif car elle dispose d’une capacité d’auto-organisation régulatrice (Albero, 2010), questionnant et arbitrant les évolutions en termes de qualité et d’efficacité (Robitaille, 2007). Souvent utilisé comme synonyme de « formation », le concept de dispositif permet d’insister sur la réalité complexe d’une organisation qui, pour évoluer et s’adapter à une demande de formation en constante évolution, doit chercher à mettre en adéquation « des formes d’intervention prévues par les concepteurs avec les comportements effectifs des publics destinataires » (Albero, 2010 : 48). En pratique, une organisation comme celle-ci se rapproche fortement des ingénieries d’évaluation et d’amélioration progressive proposées en démarche-qualité (Brémaud & Pentecouteau, 2011).
L’organisation complexe de l’auto-organisation régulatrice ne va pas de soi a priori même si les nouvelles démarches d’habilitation universitaire incitent les universités à créer des espaces d’évaluation3, comme les conseils de perfectionnement. La capacité d’auto-organisation régulatrice comporte deux aspects : tout d’abord, il est nécessaire qu’il y ait une volonté de faire évoluer le dispositif et d’y apporter des changements, dans les limites du cadre législatif imposé ; ensuite, l’auto-organisation régulatrice ne peut se mettre en place qu’à la condition où une double compétence, technique et organisationnelle, puisse ajuster cette évolution, au sein de la formation, au travers d’une ingénierie spécifique. Le conseil de perfectionnement est l’un des outils permettant la mise en œuvre de cette ingénierie. Malgré sa pertinence, centrée sur la régulation pédagogique, les expériences que nous avons faites, dans une dynamique pédagogique collaborative, collective (Barbier, 1990 ; Allal & Mottier-Lopez, 2007) et constante, montrent que ce conseil n’est pas toujours suffisant pour suivre la progression des stagiaires, ni pour questionner l’organisation de la formation pendant le temps où ils ne sont pas à l’université.
Travailler en synergie dans le cadre d’une alternance intégrative
L’activité pédagogique étant centrée sur l’individu en formation, l’ingénierie de formation est développée comme une organisation réticulaire à plusieurs entrées. Empruntée à la sociologie de Norbert Elias ([1971] 1981), cette dimension réticulaire décrit une ingénierie qui se compose dans une articulation imbriquée des espaces de formation : « ni l’ensemble de ce réseau ni la forme qu’y prend chacun des différents fils, ne s’expliquent à partir d’un seul de ces fils, ni de tous les différents fils en eux-mêmes ; ils s’expliquent uniquement par leur association, leur relation entre eux » (Elias, [1971] 1981). C’est au travers de cette relation interdépendante (Allal & Mottier-Lopez, 2007) entre acteurs du changement (Boutinet, 2006) que se fonde l’alternance intégrative (Malglaive & Weber, 1983 ; Malglaive, 1990).
Dans cette forme d’alternance, l’université et les lieux de stage sont considérés comme étant liés et complémentaires afin de permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences professionnelles et universitaires qu’ils sont venus chercher en s’inscrivant dans une formation. L’université apparalt clairement comme n’étant pas le seul lieu de la théorie et le terrain de stage (et d’expérimentation) n’est pas non plus réservé à la pratique ou au questionnement professionnel. Les acteurs des différents lieux doivent pouvoir travailler en synergie, ce qui nécessite une animation spécifique ainsi que le développement d’une activité de régulation (Robitaille, 2007). L’alternance des formations analysées ici se fait sur le rythme d’une semaine de séminaire à l’université, de deux semaines de stage et d’une semaine d’autoformation. Chaque mois se déroule selon le même canevas. Du côté universitaire, l’alternance est suivie par des ingénieurs de formation qui sont également en charge du suivi de stage et des relations avec les professionnels qui accueillent les stagiaires. L’alternance est également complétée par une communication structurée et par une formation des tuteurs professionnels, afin de corréler les attentes de l’université, celles de l’organisme professionnel et celles du stagiaire. La mise en œuvre d’ateliers d’analyse de pratiques, qui se déroulent également une fois par mois, permet de faire un bilan des compétences acquises pendant le stage.
Former des acteurs en changement
La formation est un espace-temps qui favorise les apprentissages transformateurs (Barbier, 1990), durant lesquels les stagiaires sont amenés à changer (Yurén, 2015). Ce « voyage à la rencontre de soi » (Eneau, 2017 : 149) conduit à une évolution professionnelle, pouvant également avoir des conséquences sur la vie privée. L’observation des parcours de transformation de soi, liant « transformation de soi et développement de l’autonomie » (Eneau, 2017 : 149), dévoile une grande diversité dans l’accès à la formation ainsi que dans les dispositions de chacun à répondre aux objectifs de formation visés. Chaque forme d’engagement des stagiaires (Kaddouri, 2011) est toujours le produit d’une histoire personnelle en remaillage (Boutinet, 2006). Ce qui rend nécessaire – d’un point de vue pédagogique (mais les conditions ne le permettent pas toujours) – d’envisager l’accompagnement comme pouvant être adapté à chaque individu, en fonction de ce qu’il vit dans et en dehors de la formation, de manière que la formation puisse apparaître comme étant une expérience positive.
L’une des finalités de ces formations de formateurs par alternance est de former des praticiens-chercheurs réflexifs (Schon, 1994) en s’appuyant sur trois principes de formation qui conditionnent la posture interdépendante (Robitaille, 2007) des intervenants et des stagiaires, considérés comme étant acteurs de leur formation. Le premier principe consiste à poser que les stagiaires ont des savoirs repérés et d’autres qui sont encore tacites (Schütz, [1971] 1987). Pour identifier ces savoirs tacites, les stagiaires sont invités à faire part de leur expérience, de manière que puissent être identifiées des compétences déjà acquises ou en cours d’acquisition durant le processus de formation. Le deuxième principe est que la réflexivité est abordée au travers de l’explicitation (Vermersch, 1996), afin de permettre aux stagiaires de prendre conscience de la partie inconsciente de leurs actions. Enfin, le troisième principe considère que les stagiaires sont des acteurs en changement (Barbier, 1990), qui modifient, modèlent et adaptent leur posture et leur identité professionnelle dans ce que Courtois et Pineau (1991) appellent une rupture de convictions.
Pour rendre les stagiaires acteurs de ce dispositif formatif, les apprentissages collectifs et les démarches de travail conjoint, comme les études de cas et les mises en situation, sont privilégiés, en valorisant les approches de remédiation et la construction de savoirs en situation.
Ces formations d’adultes s’appuient sur une pédagogie dialogique (Galvani, 2006) et collaborative (Allal & Mottier-Lopez, 2007) utilisant les principes de la conversation réflexive (Schon, 1994), ce qui nécessite de porter une attention particulière aux relations entre les membres du groupe en formation, d’organiser des temps d’échanges permettant de recueillir les représentations, positives ou négatives, des stagiaires sur le déroulement de la formation et de mettre en évidence des modalités favorisant la régulation. Le résultat attendu est que puissent se développer ce que Leroux et al. (2001, cités par Lerbet-Sereni, 2015) appellent des interactions régulatrices.
Agir collectif versus accompagnement collectif
La démarche réticulaire mise en œuvre dans l’ingénierie de ces formations apparalt au travers des formes d’accompagnement développées auprès du collectif que forment les adultes en formation, les professionnels qui accueillent les stagiaires et les intervenants. Si la démarche attendue vise idéalement à développer de la coopération entre les acteurs de la formation, les conditions partenariales et interprofessionnelles (notamment entre l’université et les lieux de stages) ainsi que les contraintes liées aux statuts des partenaires font que travailler ensemble ne peut se développer que dans le cadre d’un accompagnement régulier et adapté.
Parler d’accompagnement suppose plusieurs dimensions : une dimension relationnelle (attention, respect, écoute, dialogue), une dimension opérationnelle (objectifs mesurables), et une dimension temporelle et situationnelle (Paul, 2009a). Quand l’accompagnement porte sur un collectif et non plus sur un individu, ces dimensions s’inscrivent dans des modalités d’application différentes. Si bien que quand on parle d’« accompagnement collectif », il existe sans doute une ambiguïté sémantique entre « collectivement accompagner un groupe », qui relèverait de l’ingénierie de formation et de l’organisation d’un dispositif, et « accompagner un collectif », qui prendrait plutôt la forme d’une séance de formation (Denoyel, 2015 : 151), en intégrant des valeurs de réciprocité, d’émancipation, de mutualité et d’autonomie (Eneau, 2017 ; Robitaille, 2007), ou bien encore en s’inscrivant dans une perspective de recherche-accompagnement (Monceau & Aparecida Spagnol, 2015 : 140).
Dans le cadre des formations en alternance questionnées ici, c’est à la dimension de l’ingénierie de formation que nous nous intéressons.
Les actions menées, à vocation émancipatrice, vont avoir une incidence sur la manière dont l’ensemble de l’équipe va être accompagnée et amenée à coopérer pour réagir à différentes situations complexes. Pour que cela puisse se faire, il est nécessaire que tous les acteurs de la formation aient conscience de partager les mêmes principes réflexifs et collaboratifs, intégrant cette double idée que l’ensemble des individus qui participent à l’environnement de formation « cheminent ensemble » tout le temps que dure la formation et que tous les stagiaires participant à cette formation, accompagnés par l’équipe pédagogique, atteignent un socle de compétences partagées. Ce qui revient à affirmer que pour collectivement accompagner, une éthique de la formation, fondée sur des valeurs partagées et sur la délibération (Jutras & Labbé, 2014 ; Birmelé, 2015), est indispensable.
Développer, d’un côté, un contexte de formation et des façons de faire (parmi lesquelles on trouve de l’agir coopératif) et afficher un certain nombre de valeurs (que l’on cherche à traduire en actions) revient à affirmer une culture de formation.
Une problématique coopérative
En 1994, Pierre Dominicé publie un texte dans la revue Éducation permanente dont le titre est « L’éthique comme dimension culturelle de la formation ». Si l’éthique apparaît plutôt comme un processus individuel (Lenoir, 1998 ; Jutras & Labbé, 2014), l’adhésion des différents acteurs à une culture de formation permet d’esquisser une éthique collective en tant que valeurs partagées. L’ingénierie que nous avons développée va dans ce sens en mettant l’accent sur trois éléments.
Le premier porte sur la nécessité de permettre aux différents acteurs de la formation de travailler ensemble. Toute pratique de formation doit chercher à associer les interlocuteurs demandeurs dans « un processus de collaboration avec » (Lenoir, 1998), jusqu’à permettre une coopération effective.
Le deuxième élément consiste en la mise en œuvre de la réciprocité dans les relations de l’équipe pédagogique avec les stagiaires. Élé...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Titre
- Copyright
- Sommaire
- Introduction générale
- Première partie : Démarches d’accompagnement en formation
- Deuxième partie : Accompagnement à et par la réflexivité
- Troisième partie : L’accompagnement d’équipes éducatives en contexte d’innovation
- Quatrième partie : Accompagnement et transformations identitaires
- Les auteurs