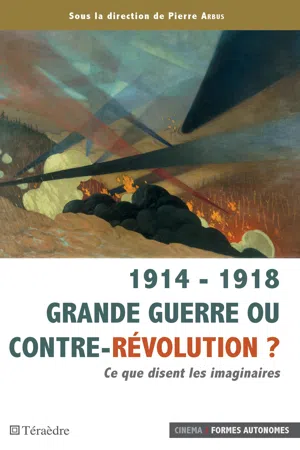
eBook - ePub
1914 - 1918 Grande guerre ou contre-révolution ?
Ce que disent les imaginaires
- 280 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Les célébrations du Centenaire terminées, il est nécessaire d'examiner ce que disent aujourd'hui de la guerre ces propositions. Comme autant de métamorphoses poétiques de la mémoire souvent délaissées au lendemain des grands événements de l'Histoire au profit des archives officielles et de la parole autorisée, cette étude se veut un éclairage des contenus explicites des témoignages individuels.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à 1914 - 1918 Grande guerre ou contre-révolution ? par Pierre Arbus en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Histoire et Film et vidéo. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
HistoireSujet
Film et vidéoANGELUS NOVUS
Le Sceptre et le Sabre. La représentation de la Grande Guerre comme un atelier du droit et de la justice
Les Otages (R. Bernard, 1938)
Les sentiers de la gloire (S. Kubrick, 1957)
Par Sylvain Louet
« La guerre de 1914 a d’abord été pour nous, Français, une guerre défensive. Nous sommes-nous défendus ? Non, nous sommes au même point qu’avant. Elle devait être ensuite la guerre du droit. A-t-elle créé le droit ? Non, nous avons vécu depuis des temps pareillement injustes1 ».
Chacun, en Europe, a été touché par la Grande Guerre qui a ouvert ce que Wolfgang Sofsky a nommé l’« ère de l’épouvante au XXe siècle2 » — celle des sociétés « brutalisées3 », des hommes », « simplifiés4 », de la raison sacrifiée aux rationalisations de la tuerie5. C’est pourquoi cette guerre peut être considérée comme un événement matrice de l’expérience de l’homme européen au XXe siècle.
Ainsi exposé à la guerre, chacun s’est posé la question de savoir comment s’orienter – comment maintenir, dans une telle situation, un horizon de pensé, de projet, de désir – comment maintenir des repères de justice, alors que le glaive (emblème de la violence physique légitime) et la balance (symbole d’équilibre et de mesure) avaient été remplacés par la chair et l’acier6.
Si, comme l’affirme Annette Becker, « [l] a Grande Guerre continue à se montrer, à se représenter, à se dire, à se crier, à se pleurer7 », les historiens, notamment Laurent Véray, posent le plus souvent une question centrale en regard du film étudié : « quel lien y a-t-il entre la reconstruction filmique de cet événement et la mémoire collective ?8 ». En ce sens, notre étude qui porte sur la représentation du droit et de la justice dans deux films se demande quel lien poser entre la reconstruction filmique de la Grande Guerre et la mémoire collective.
On verra d’abord comment, dans Les Otages, un film français de Raymond Bernard, de 1938, qui relève du courant patriotique et commémoratif, le droit et la guerre sont présentés comme des motifs de résilience. On étudiera ensuite comment le film Les sentiers de la gloire (Stanley Kubrick, 1957) donne une vision critique de la guerre elle-même et, surtout, du commandement militaire, en se penchant sur ce que l’on peut appeler le tribunal imaginaire des relations sociales au sein de l’armée, et en mettant de côté le procès mis en scène dans le film.
Le droit et la guerre, motifs de résilience dans Les Otages
Dans ce film dont l’action se déroule entre août et septembre 1914, la Grande Guerre et le motif du droit possèdent une vertu : ils entraînent une forme de résilience, une reconnaissance de l’autre, français, comme son frère égal en droit, qu’il soit noble ou roturier, ou a priori du côté de l’ordre ou du vol. La lutte durant la Grande Guerre apparaît comme le germe de la fraternité et du patriotisme qui permet d’interroger la place du droit dans les relations sociales. Le film exprime ainsi le sentiment d’une double dette, à l’égard du passé (le devoir de mémoire conduit à se tourner vers les combattants de 1870 et vers ceux de la Grande Guerre), et à l’égard du futur (le film transmet un héritage, celui de la fraternité entre les différentes classes sociales de français, censée constituer le ciment national face à l’ennemi, dans un contexte où le Front populaire a gouverné la France de 1936 à 1938).
Le droit de passage, un reflet parodique des revendications territoriales bellicistes
Au début du film, dans un village de la Marne, Rossignol, un noble, convoque un huissier pour établir et constater par écrit qu’il a un droit de passage dans la grange du maire, un roturier, et qu’il ne peut pourtant pas passer. Cette revendication se transforme en petite fête burlesque, alimentée par la curiosité de la population et par la musique de fanfare. La surprise est grande quand on voit le maire se montrer conciliant. Le noble Rossignol, victorieux, s’adresse à la foule : « Depuis trente ans, j’attends cette clé. Depuis trente ans. On s’en souviendra du mois d’août 1914 ! En avant la musique ! » Rossignol, aux vêtements blancs (et donc recherchés), mène la population aux habits sombres vers la grange, comme un général sa troupe.
En vérité, on assiste à la parodie des revendications territoriales bellicistes. L’accomplissement supposé du droit est présenté comme une farce théâtrale. Le village est soudé par cette théâtralité des rapports sociaux, en partie fondée sur le droit instituant la communauté. La revendication du droit de passage — une affaire habituellement présentée comme sérieuse — est mise à distance par le renversement de situation quand Rossignol constate qu’il ne peut passer : deux murs ont été érigés, qui laissent une mince ouverture. Le noble est hors de lui : « Il a osé se dresser contre les lois ! Il n’y a plus de civilisation possible ! Fabien ! Un constat ! » Arrive le maire, goguenard : « Eh bien, Rossignol… Tu l’as ton passage. Tu es content, je l’espère. » Le grotesque se poursuit : « Hors-la-loi ! Il est où mon passage ? […] Pour qui me prends-tu, pour une anguille ? » Le maire joue avec l’énoncé de justice : « Sur l’acte, il y a “droit à un passage”. On n’a jamais dit : “droit à un passage commode”. » Le film explore la tension entre la lettre et l’esprit de la loi, entre la légalité (un récent jugement a rappelé que Rossignol a le droit de passer par la grange) et la légitimité (alors que Rossignol loue les terres dont il est propriétaire et n’a pas besoin de ce passage, ce droit est-il légitime ?). Privés de bon sens, l’application mécanique de la loi comme son refus de l’appliquer ne conduisent qu’à une tension jamais dénouée.
Puis l’ordre de mobilisation générale est affiché. Pierre, le fils de Rossignol, épouse en cachette Annie, la fille du maire. Suite à l’avancée de l’armée ennemie, Pierre, venu voir sa fiancée hors des lignes françaises, tue un officier allemand en voulant se défendre. Le maire cache le corps. Les Allemands, qui occupent désormais le village, réclament des otages, car le jeune meurtrier ne s’est pas dénoncé.
Le droit de passage comme une vanité et une allégorie de la guerre
Les otages attendent leur exécution pendant que les Français bombardent les positions allemandes installées dans le village. Les deux beaux-pères prennent alors du recul par rapport à leurs revendications territoriales : « Avec cette histoire de grange, nous y avons été un peu fort depuis trente ans. » La querelle était devenue un champ d’expérience et un horizon d’attente locaux et coutumiers. Désormais, les deux hommes ouvrent les perspectives, en parlant d’une seule voix, pour commenter la situation internationale : « Le monde entier est aussi bête que nous. Et tout cela pour un droit de passage. Il est beau maintenant mon droit de passage. Ces barreaux aux fenêtres, cette porte verrouillée. C’est à cause de tous les droits de passage qu’a lieu la guerre. » La prise de conscience débouche sur le remords, mais aussi sur une lecture historique du conflit juridique. La figure du droit de passage devient alors une allégorie. La guerre serait due à tous les droits de passage et à une revendication sans borne des parties en présence. Du reste, ces deux pères ne sont pas sans rappeler la France et l’Allemagne, ennemis héréditaires que la Société des Nations avait tenté de rapprocher. En effet, quand, le 2 août 1914, l’Allemagne envahit le Grand-duché de Luxembourg, elle pose un ultimatum à la Belgique : l’Allemagne demande le libre passage de son armée.
Après cette scène, les Allemands battent en retraite. La population conduite par la fille du maire va à la rencontre des otages. L’image de la libération fait le pendant de la clameur publique initialement accusatrice.
De la fin du droit de passage au mariage comme bouclier juridique
Les otages libérés sont portés en triomphe. Les beaux-pères constatent que la grange a été détruite. Le conflit lié au droit de passage n’a plus lieu d’être. Et le film se termine sur l’image des jeunes mariés. Ainsi, dans ce film cénotaphe, dressant un tombeau à la population française réconciliée avec elle-même, l’avenir est finalement mis au premier plan. La fin est tissée d’un paradoxe aux résonances mélodramatiques : alors que la Grande Guerre vient d’éclater, on assiste à l’institution de la paix dans le village qui propose, localement, une alternative aux normes qui ont conduit au conflit européen majeur. L’originalité du film tient au fait que les personnages en conflit ne parviennent pas par eux-mêmes à dépasser des questions de droit délétères. Seule la destruction mortifère et exogène a brisé le jeu avec le droit appréhendé à travers le tamis des haines ancestrales. La guerre a joué le rôle du tiers libérateur.
Le mariage apparaît alors comme la forme résiliente du droit de passage source du conflit ancestral entre les deux familles. Le mariage permet à chacun des enfants de passer dans l’autre famille ennemie. À travers le droit de passage, le droit était d’abord montré comme une arme de guerre et un ferment de conflit perpétuel. Puis, à travers le droit du mariage, le droit apparaît comme une source de réconciliation. Dans cette optique, le droit matrimonial invite à la confiance. Il est promesse de paix dans la communauté. Ce mariage de la fille du maire roturier avec le fils du noble peut se lire comme la création d’un bouclier juridique visant à réconcilier deux familles ennemies que le mariage (un contrat juridique) contribue à rapprocher. Ce film apparaît donc comme un cri d’espoir dans la capacité du droit à faire disparaître les conflits. La thèse de Jean Carbonnier9, soutenue durant la même période historique, avance que, du seul fait du mariage, la loi établit entre les époux une société civile investie de la personnalité morale, la société conjugale, le ménage. Le mariage crée ainsi une société ayant des besoins, des intérêts, des droits distincts de ceux des époux considérés comme des individus. Dans Les Otages, la fille et le fils sont devenus des associés en fait et en droit — de lege ferenda (quant à la loi que l’on doit appliquer). Les enfants, qui pouvaient prendre le risque d’entrer en rupture familiale, choisissent de renforcer leurs liens, par le mariage. Le droit apparaît comme une « forme formante10 » de la personne qui étend son influence bénéfique à toute la communauté.
Grâce à cette jurisfiction (qui peut se définir comme la mise en fiction du droit), on glisse du droit privé (le droit de passage puis le droit matrimonial) au droit international. Pas de synecdoque ici, mais une ouverture, porteuse d’espoir, permise par le jeu de la fiction redéfinie à l’aune de l’imaginaire. Ce cri d’espoir est toutefois désespéré — ou ce cri désespéré est porteur d’espoir — si l’on considère l’état politique et juridique des pays européens, à l’approche de la Seconde Guerre mondiale et au moment de la réalisation du film. En effet, dans l’entre-deux-guerres, l’Allemagne nazie et le Japon (en 1933) puis l’Italie (1937) ont quitté la Société des Nations. Dans la réalité politique internationale, les quelques garanties de paix sont déjà réduites à néant.
Dans le film, l...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Collection « Cinéma / Formes autonomes »
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Citation
- INTRODUCTION
- ANGELUS NOVUS
- DE MAUX EN MOTS
- REQUISITOIRES
- LES ÉCRANS DE LA MEMOIRE
- Table des matières