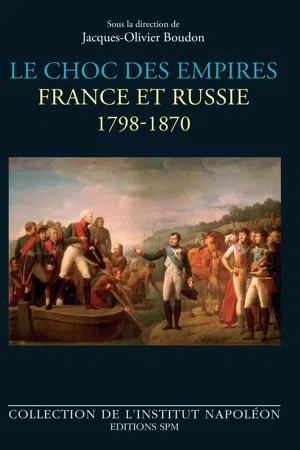
- 192 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Entre l'entrée en guerre de la Russie contre la France révolutionnaire en 1798 et la chute du Second Empire, les relations entre les deux empires ont été faites de conflits et de réconciliations. Austerlitz, Friedland, Campagne de Russie, guerre de Crimée, congrès de Paris de 1856, venue du tsar en France en 1867 en sont autant de témoignages. Mais au-delà des cycles de guerres et de paix, les relations entre les deux empires ont aussi été économiques, scientifiques et culturelles; elles se traduisent par des échanges nombreux que favorisent les voyages entre les deux pays. Cet ouvrage vise ainsi à mieux comprendre la richesse des relations nouées entre la France et la Russie sous les Premier et Second Empires.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Le choc des empires par Jacques-Olivier Boudon en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans History et World History. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
HistorySujet
World HistoryLES PRISONNIERS RUSSES EN FRANCE DE 1799 À 1856
par Jacques-Olivier Boudon
Dans l’histoire des relations entre la France et la Russie au XIXe siècle, on évoque généralement les échanges culturels, voire les visites réciproques qu’ont pu effectuer les ressortissants des deux pays, on pense aussi naturellement aux guerres qui ont scandé la période, mais sans véritablement s’intéresser au sort des combattants capturés à l’issue des batailles. Seuls les soldats de l’armée des vingt nations restés prisonniers en Russie à l’occasion de la campagne de 1812 ont fait l’objet de plusieurs travaux. On s’est en revanche beaucoup moins intéressés à l’arrivée d’officiers et de soldats russes en France1. Pourtant, ils sont plusieurs milliers à avoir franchi la frontière et à être demeurés en France plusieurs mois, voire plusieurs années. On peut distinguer quatre grandes vagues d’arrivée de ces prisonniers russes. Les premiers ont été capturés en 1799 à l’occasion de la campagne de la Seconde Coalition. La seconde vague s’étend de décembre 1805, après la bataille d’Austerlitz, jusqu’à la conclusion de la paix de Tilsit. La troisième commence avec la campagne de Russie et s’achève avec l’abdication de Napoléon en avril 1814. La quatrième vague enfin correspond à la guerre de Crimée. Il sera intéressant de comparer les différentes formes de cette captivité, en analysant tout d’abord l’acheminement des Russes en France, puis les conditions de leur captivité et enfin les modalités de leur libération et de leur retour au pays.
LA CAPTURE
Les premiers prisonniers russes à fouler le sol français appartiennent aux régiments qui ont été envoyés combattre en Suisse et en Hollande à l’occasion de la Seconde Coalition2. En 1800, il y a donc, selon les états, entre 5510 et 6281 prisonniers russes en France. La grande majorité d’entre eux (5502) a été répartie dans des places fortes du nord de la France qui appartiennent à la 1ère division militaire (Bouchain, Cambrai, Avesnes, Le Quesnoy, Nord libre, Landrecies), mais on en trouve également à Châlons-sur-Marne, Metz, Nancy, Toul, Montbéliard et Besançon3.
Au cours de la campagne de 1805, l’armée française a recensé 13 787 prisonniers russes dont 10 719 pris à Austerlitz4, mais seule une partie d’entre eux arrivent en France, soit 4577, d’autres étant conservés en Allemagne. Près de neuf cents meurent au cours du trajet, taux de mortalité très élevé, qui laisse à penser que ces soldats étaient dans un très mauvais état sanitaire au moment de leur capture, état que la captivité n’a évidemment pas amélioré. Ils ne sont plus en effet que 3397 en mars 1806, répartis dans cinq villes. Les officiers, au nombre de 218, sont à Lunéville où l’on compte également 37 soldats, qui sont en fait des domestiques des premiers. Les autres dépôts se situent à Metz (1399), Bourges (1423), Guéret (131) et Vendôme (189)5. En mai, on décide de transférer les prisonniers de Guéret à Vendôme6. En juillet 1806, les prisonniers russes ne sont plus que 2946. Ont en effet été libérés les Russes qui avaient été capturés sur des navires marchands arraisonnés par la marine française7. Puis, avec la reprise de la guerre, leur nombre s’accroît de nouveau. Ils sont 3767 en septembre 1806, répartis entre Lunéville, Thionville, Metz, Bourges, Limoges et Blois8, 3918 en janvier 18079, 4291 en mars 180710.
Les combats qui se poursuivent dans les premiers mois de 1807 provoquent à nouveau la capture de soldats russes, notamment après Eylau. C’est alors qu’est fait prisonnier le général baron de Korff, au combat de Péterswalde le 25 février. Au moment de la paix de Tilsit, il y a donc en France 5738 sous-officiers et soldats russes en France, répartis entre Metz (2947), Thionville (1733), Limoges (938) et Blois (720) et 336 officiers à Lunéville, accompagnés de 70 domestiques, soit un total de 6150 Russes11, incluant aussi cinq officiers supérieurs qui jouissent d’un traitement particulier. Le général baron de Korff vit à Paris, à l’hôtel Duperron, rue Neuve Saint-Eustache, avec un aide de camp. Les généraux-majors Piotr Meller Zakomelsky (1755-1823)12 et Jean Muller, ainsi que le colonel Demetry Ouvarov, aide de camp d’Alexandre, et le lieutenant Falcovsky, sont en résidence surveillée à Reims.
La campagne de 1812 conduit peu de prisonniers russes en France malgré l’annonce de très nombreux prisonniers faits au cours de la campagne. Les premiers Russes placés en détention sont soit des marins soit des Russes qui séjournaient sur le territoire français à l’image d’un certain Elkamouski, fait prisonnier en Suisse alors qu’il appartenait à l’armée de Souvorow et resté en France après 1801 où il s’engage au service de la France. En août 1812, il est enfermé à la maison militaire de Montaigu, mais se dit prêt à servir dans un régiment hollandais13. À la même époque, Alexandre Choul Barrot, né en 1787 à Novgorod, lieutenant au régiment Beloyerski, demande à entrer au service de la France14. D’après un état de novembre 1812, il y aurait à peine 180 Russes en France : trois officiers généraux qui séjournent à Metz, 11 officiers à Soissons et 166 sous-officiers et marins à Romans dans la Drôme15. En revanche plus de 8 000 Russes sont envoyés en France à l’issue de la campagne de Saxe de 1813, si bien qu’ils sont 8627 parmi lesquels 176 officiers, en novembre 1813. Ils se répartissent alors entre quatorze villes différentes. Les officiers sont rassemblés à Soissons, les sous-officiers et soldats sont concentrés dans des villes moyennes, par groupe de 500 à 600, deux villes plus importantes, Nîmes et Rennes, en accueillant 1 000 chacune. La géographie de leur répartition privilégie la vallée du Rhône et la bordure orientale du Massif central d’une part, avec une concentration particulièrement élevée dans le Gard, où quatre villes accueillent des prisonniers russes : Uzès, Pont-Saint Esprit, Alès et Nîmes. Ces quatre villes concentrent 3 000 Russes, soit plus du tiers de l’ensemble des prisonniers russes alors détenus en France. La Bretagne, et plus particulièrement l’Ille-et-Vilaine avec Rennes et Fougères, en reçoit un millier. La plupart des villes concernées avaient déjà accueilli des prisonniers de guerre, mais l’on peut remarquer qu’à l’exception de Soissons, aucune ne se situe dans la partie nord-est du pays, foyer traditionnel d’accueil des prisonniers, comme si les autorités militaires avaient anticipé l’arrivée des armées étrangères16. En fait, c’est à partir du début du mois de novembre que l’on a commencé à évacuer les places de l’Est et à transférer les prisonniers qui se trouvaient dans les départements réunis, mais en décembre 1813, il reste encore par exemple 1 112 Russes à Wesel et 113 à Torgau.
LES CONDITIONS DE VIE DES OFFICIERS
Les prisonniers russes connaissent les mêmes conditions de vie que les autres prisonniers arrivés en France sous l’Empire. Les officiers ont par ailleurs un traitement privilégié par rapport aux soldats. Le témoignage de Moritz von Kotzebue permet de mesurer la manière dont s’organise ce déplacement17. Fils d’un conseiller d’État, âgé de 24 ans, il est capitaine du génie, quand il est fait prisonnier à la bataille de Polotsk le 23 août 181218. Kotzebue fait partie des rares prisonniers russes arrivés en France au début de 1813 au terme d’un périple qu’il a raconté par le menu et qui le fait traverser la Russie puis l’Allemagne, avant d’arriver à Metz. Là il prête serment de ne pas s’évader, reçoit un pécule et une feuille de route qui doit le conduire à Soissons, où il se rend par ses propres moyens. Il se plaint alors amèrement des sommes exigées par les paysans ou autres convoyeurs pour le transporter d’un lieu à l’autre. En route, il décide d’opérer un détour par Paris qu’il visite de long en large, s’attardant notamment au musée Napoléon, mais aussi dans les lieux de distraction du Paris nocturne. Cette dimension touristique du voyage de prisonnier n’est pas à négliger, nombre d’officiers obtenant l’autorisation de visiter la capitale.
Les officiers ont donc d’abord été regroupés à Soissons. Comme l’ensemble des officiers faits prisonniers au cours de la période, ils sont libres de leurs faits et gestes dès lors qu’ils ont donné leur parole d’honneur de ne pas s’évader. Ils peuvent circuler en ville à condition de ne pas s’en éloigner de plus d’une lieue. En fonction des moyens dont ils disposent, ils peuvent vivre chez l’habitant moyennant un loyer pour le gîte et le couvert – c’est l’option que choisit Kotzebue – ou bien vivre au dépôt. Ces officiers ont donc de nombreuses occasions de côtoyer la société locale. Ils sont du reste reçus dans les salons et parfois même à la préfecture. Ils reçoivent une solde de la part des autorités militaires, mais se plaignent généralement de sa modicité. Kotzebue se fait l’interprète de ces plaintes, considérant que seuls les officiers supérieurs peuvent vivre dignement avec ce qui leur est versé, les autres officiers ne pouvant payer à la fois le gîte, le couvert, et en même temps renouveler leur garde-robe ou consacrer un peu d’argent à leurs loisirs. De fait la plainte postérieure de Kotzebue fait écho aux problèmes soulignés par le préfet de l’Aisne qui notait les difficultés financières des officiers russes19.
Ces difficultés sont aussi perceptibles à travers deux pétitions adressées au ministre de la Guerre. La première qui émane des capitaines, lieutenants et sous-lieutenants retenus à Soissons, fait état de la détresse dans laquelle ils se trouvent ; ils considèrent leur solde comme « absolument insuffisante en raison de leur qualité d’officier et de leur éducation ». Ils ne réclament pourtant pas qu’elle soit augmentée. Ils souhaitent simplement pouvoir correspondre avec leurs familles, ce qui n’est plus possible du fait de l’état de guerre, afin de recevoir d’elles des subsides supplémentaires20. Cette pétition émane par conséquent d’officiers appartenant à de riches familles qui ressentent d’autant plus mal de ne pouvoir tenir leur rang. Dans une autre pétition, provenant de l’ensemble des cent officiers alors présents à Soissons, la plainte concerne l’insuffisance des secours reçus au cours du trajet, les officiers signataires réclamant qu’une solde entière leur soit accordée pour le temps compris entre leur ...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- DANS LA MÊME COLLECTION
- Titre
- Copyright
- LISTE DES AUTEURS
- INTRODUCTION
- « JE VOUS INVITE À RÉTABLIR AVEC MOI LA PAIX GÉNÉRALE ! », LE RAPPROCHEMENT FRANCO-RUSSE DE 1799-1801
- L’AMBASSADE DE CAULAINCOURT EN RUSSIE (1807-1811) : L’ALLIANCE DE TILSIT AU DÉFI DES SALONS PÉTERSBOURGEOIS
- LES RUSSES À LA COUR SOUS LES DEUX EMPIRES
- L’ESCADRE RUSSE À LISBONNE EN 1807-1808
- LES PRISONNIERS RUSSES EN FRANCE DE 1799 À 1856
- LE MYTHE DE NAPOLÉON EN RUSSIE DE 1799 À 1870
- LA GUERRE POUR LES LIEUX SAINTS ?
- LA PERCEPTION DE LA RUSSIE ET DES RUSSES EN FRANCE DURANT LA GUERRE DE CRIMÉE
- GEL ET DÉGEL DES RELATIONS FRANCO-RUSSES AUTOUR DE LA GUERRE DE CRIMÉE (1830-1863)
- TABLE DES MATIÈRES