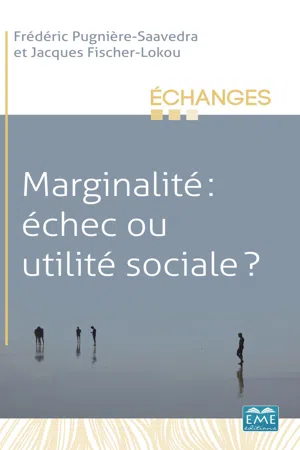
eBook - ePub
Marginalité : échec ou utilité sociale ?
- 322 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Marginalité : échec ou utilité sociale ?
À propos de ce livre
Il est question de «celui qui est marginal» dans cet ouvrage qui regroupe des contributions de chercheurs en sciences humaines et sociales. Le regard porté sur cette notion est volontairement positif car elle reconfigure des pratiques et les normes sociales. Comment la marginalité peut-elle être une force pour notre société? Comment les manifestations d'une forme de marginalité constituent-elles les prémices des mutations sociales?
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Marginalité : échec ou utilité sociale ? par Frédéric Pugnière-Saavedra,Jacques Fischer-Lokou en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences sociales et Sociologie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
Sciences socialesSujet
SociologieLa deuxième section
La deuxième section rassemble des contributions qui abordent celui q ui est en m arge dans ses pratiques langagières. La contribution de E. Guérin interrogera les mécanismes qui alimentent les représentations, en s’intéressant aux phénomènes d’auto- et d’hétéro-désignation des « jeunes de quartier », « jeunes de cité » ou « jeunes de banlieue », comme à la façon dont s’exprime leur identité « non française » dans l’usage qu’ils font de la langue. Celle de F. Pugniere-Saavedra abordera, au travers de récits de vie de victimes de délinquants sexuels réunis en groupes de paroles, la manière dont les participants mettent en mots les enchaînements séquentiels de l’action traumatique et de réactions post traumatiques. Au travers de sa recherche, R. Bretel offre l’occasion de s’interroger sur l’appréhension juridique de la marginalité linguistique et culturelle pour les langues minoritaires. Dans le prolongement de cette contribution, J.-C. Le Ruyet analyse les difficultés de la langue bretonne dont la survie dépend peut-être autant des enjeux de l’unification littéraire interne aux pratiques de la langue que des contraintes politiques et juridiques parfaitement soulevées dans ces deux dernières contributions.
Les « jeunes de quartier » et les « Français »… Une approche socio-linguistique d’un processus complexe de marginalisation
Emmanuelle Guerin,
Maître de conférences HDR en Sciences du Langage
Université d’Orléans
Les « jeunes de quartier » constituent une catégorie sociale, identifiable dans le discours commun. Bien que plus ou moins attestés, un certain nombre de traits caractéristiques leur sont associés : ils seraient jeunes, issus de milieux populaires et multiculturels, résidant dans des cités en périphérie des grandes villes (voir Auzanneau & Juilliard, 2012). Autant d’attributs suffisants pour considérer qu’ils s’organisent en un groupe avec des codes, des pratiques sociales (incluant des pratiques langagières), spécifiques au point qu’ils se distinguent du reste de la communauté française. Pour preuve, on a coutume d’utiliser le mot « langue » (des jeunes, des cités, des quartiers, des banlieues) pour pointer leur façon de parler. S’il s’agit bien d’une langue alors elle est opposable à d’autres, en particulier à la langue française.
Dans cette contribution, je ne remets pas en question la validité de la catégorie puisque manifestement dans les discours les plus ordinaires (des « jeunes » eux-mêmes et des autres) comme dans les discours médiatiques ou politiques, « jeunes de quartier » réfère bien à un groupe d’individus cernable. En revanche, je m’intéresse ici à la façon dont ce groupe se détermine, notamment dans son rapport à la communauté française. Le fait est que parmi les traits caractéristiques précédemment cités, la multiculturalité est particulièrement mise en avant. En ces temps où la question de l’identité française occupe le devant de la scène politico-médiatique (voir Jeannerey, 2017), l’expression de l’appartenance à une culture autre radicalise la marginalisation (souhaitée ou non, cela reste à déterminer) des « jeunes de quartier ». L’hypothèse soutenue ici s’articule autour de l’idée selon laquelle cette expression, aux allures de revendication, n’est que la conséquence d’une incapacité et/ou impossibilité d’accès aux référents sur lesquels se fonde la culture française. Les jeunes recourent alors à d’autres référents culturels, souvent plus fantasmés que réellement fondateurs de la culture d’un autre pays.
Je me propose ainsi d’apporter des éléments de réflexion sur la façon dont les « jeunes de quartier » expriment leur marginalité, en s’excluant de la communauté des Français. L’étude des discours recueillis dans le cadre du projet Multicultural Paris French1 (désormais MPF) permet de mettre en lumière qu’il ne s’agit pas simplement d’une opposition consentie à ce qu’on présente comme l’identité nationale mais que la mise en marge résulte de la combinaison d’injonctions paradoxales.
Nommer les groupes
Les données exploitées ici sont issues du corpus MPF, constitué dans le cadre du projet du même nom. Il s’agit d’enregistrements audio de propos tenus par des « jeunes » d’Île-de-France. La pertinence de ce corpus réside notamment dans le choix de cadres théorique et méthodologique permettant l’obtention de données que l’on ne retrouve pas ailleurs. La question de la catégorisation des informateurs n’est pas réglée d’emblée mais reste ouverte, dans la perspective de l’être au regard des données obtenues (Gadet & Guerin, 2016).
Pour tenir ce principe, la sélection des informateurs s’est faite en partant de l’observation des pratiques langagières et non de données sociodémographiques : les informateurs ont tous en commun d’être locuteurs de la « langue des jeunes ». Si, de fait, la majorité d’entre eux est bien issue de milieux multiculturels et populaires de la banlieue parisienne et a moins de trente ans, ce n’est pas le cas de tous. On compte parmi les informateurs des Parisiens, certains qui n’ont pas d’autre culture que la culture française en héritage (ce qui n’exclut évidemment pas les contacts avec d’autres cultures) et des personnes de plus de trente ans. Pourtant, tous partagent l’usage de formes linguistiques non standard, illustrant ce que tout Français reconnaît désormais comme la « langue des jeunes/des quartiers/des banlieues/… », les locuteurs compris. Les informateurs sont donc sélectionnés, non pas selon le découpage traditionnellement opéré par la sociologie (catégories socio-démographiques), mais parce qu’ils appartiennent à une « communauté de pratiques », notion qui, selon Trimaille & Billiez (2007 : 106), pourrait permettre d’appréhender « les relations réciproques et imbriquées entre individus, réseaux sociaux à base locale et groupes plus abstraits (par exemple en termes de “classe sociale”) ». Pour Eckert (2000 : 222), il ne s’agit pas de « se dispenser des catégories globales mais de les rattacher à l’expérience individuelle et communautaire de façon à ce que la structure de la variation ait un sens en lien avec les pratiques quotidiennes ».
Ainsi, les entretiens2 ne sont pas conditionnés par un présupposé catégoriel mais tendent à conduire les informateurs à se définir. Autrement dit, le protocole d’enquête suggère aux enquêteurs d’adopter une posture « naïve » afin que les informateurs adoptent en retour la posture de l’expliquant. Terrain et théorisation sont sans cesse mis en dialogue (voir le numéro 154 de la revue Langage & Sociétés, 2016). Cela est rendu possible notamment parce que les entretiens sont tous menés par des chercheurs appartenant nécessairement, de près ou de loin, au réseau des informateurs, ce qui instaure d’emblée un contexte limitant les effets du caractère inévitablement extraordinaire de la situation d’interaction. Dans tous les cas, on cherche à mettre l’informateur en confiance en tentant d’assurer une « posture de proximité » (Vulbeau, 2007). Celle-ci est tenable parce que les enquêteurs sont soit un proche de l’informateur, soit un « friend of friend » (Boissevain, 1974), soit familier du quotidien de l’informateur (assistant scolaire dans l’établissement des informateurs, membre d’une association fréquentée par les informateurs).
L’histoire interactionnelle qui caractérise la relation enquêteur/informateur est évidemment prise en compte dans l’analyse des discours : on observe de réelles différences sur la forme et le fond des discours en fonction de l’identité de l’enquêteur, telle qu’appréhendée par l’informateur (voir à ce sujet Gadet & Kaci, 2012).
Cependant, sur le thème de l’appartenance à la communauté nationale, on constate une même tendance : la quasi-totalité des discours ont en commun l’expression d’une identité qui ne se dit pas exclusivement ou pas du tout (dans la majorité des cas) française. Bien que les informateurs soient nés en France, de nationalité française, qu’ils aient fréquenté l’école française, que leurs parents, pour une grande part, soient également nés en France, ils expriment leur appartenance à un groupe qui n’est pas celui des Français.
1) Ali : Même s’ils sont na- ils ils ont la nationalité française ils sont pas ils sont pas des vrais Français hein. (Baligh3, 344.244)3
2) Sonia : Je sais enfin je suis française mais pour moi c’est juste une nationalité mais pour moi je suis algérienne. (Nawal3, 537.744)
3) Mouna : Hum hum moi je me considère pas du tout française. (Nacer2, 3738.87)
4) Sandrine : Non je suis pas hum (.) si vraiment j’avais le choix je choisirais sur ma carte de mon permis et tout je dirais que née aux Antilles je mettrais pas euh française. (Emm4, 3089.88)
Les informateurs se reconnaissent parmi les Rebeus, Renois, Algériens, Tunisiens, Marocains, Sénégalais, Malien, Antillais,… (Conein, 2017). Cette série de noms de groupe peut, à un autre niveau d’analyse, sembler hétérogène puisque ...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Copyright
- Titre
- Remerciements
- Sommaire
- Introduction – Quels outils conceptuels pour approcher la marginalité ?
- La première section
- La deuxième section
- La troisième section
- La dernière section
- Conclusion : et si l’on posait enfin un autre regard sur la marginalité ?
- Parus dans la même collection