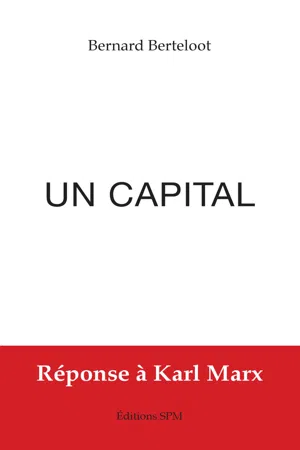
- 170 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Cette histoire des modèles sociaux montre que ce n'est pas en redistribuant les revenus qu'on réduira la fracture sociale mais en redistribuant le capital. Comment? En donnant aux jeunes un capital de départ pour les aider à « s'installer » et démarrer dans la vie. Facile à financer et à mettre en œuvre, cette mesure aurait des effets bénéfiques dans tous les domaines (familles, économie, société..). Ce serait en outre la vraie bonne réponse à l'analyse marxiste du système capitaliste.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Un capital par Bernard Berteloot en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Politics & International Relations et Politics. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
PREMIÈRE PARTIE
Les modèles sociaux
à travers l’Histoire
Plus vous saurez regarder loin dans le passé,
Plus vous verrez loin dans le futur.
Plus vous verrez loin dans le futur.
Winston Churchill
CHAPITRE 1
Le modèle social tribal
Le problème de la répartition des richesses et des ressources ne s’est vraiment posé que lorsque nos ancêtres, qui menaient une vie de nomades ou de semi-nomades vivant de la chasse, de la pêche et de la cueillette, se convertirent à l’agriculture et à la vie sédentaire, il y a dix mille ans. Apparue quelque part au Proche-Orient, cette révolution a été, après la maîtrise du feu et l’apparition du langage, l’une des grandes étapes de l’évolution de l’Humanité.
Dix mille ans c’est beaucoup, mesuré à l’aune des jours et des mois, mais c’est très peu à l’échelle de l’Histoire. Si l’on considère que la durée de vie d’un homme est aujourd’hui de près d’un siècle, dix mille ans ne représentent qu’une centaine de vies humaines mises bout à bout. C’est bien peu également au regard des trois millions d’années qui nous séparent de l’apparition de l’homme sur notre planète. Si on ramène ces trois millions d’années à une année civile, nos ancêtres, apparus sur terre le 1er janvier, se sont convertis à l’agriculture le 29 décembre et nous sommes le 31 !
Bizarrement qualifiée de « néolithique » (terme créé au XIXe siècle pour désigner l’âge de la pierre polie), la révolution qu’a été la conversion des hommes à l’agriculture et à la vie sédentaire a eu des conséquences considérables dans tous les domaines. Sur le plan démographique, c’est le point de départ d’une expansion qui va transformer les hordes primitives en tribus pouvant compter plusieurs centaines de milliers, voire des millions d’individus. Sur le plan culturel, c’est un essor spectaculaire des arts et des techniques. Les hommes vont inventer la céramique, le tissage, la statuaire, la métallurgie de l’or et du cuivre, et révéler dans tous ces domaines d’étonnantes dispositions artistiques. Sur le plan religieux, c’est l’apparition des divinités agricoles : la déesse terre, le dieu soleil, le dieu de la fécondité, ainsi que le culte des ancêtres. Sur le plan de l’habitat, c’est l’apparition d’une multitude de villages, enserrés dans l’espace cultivé, avec leurs maisons à greniers et leur population de paysans. Et sur le plan social, c’est la naissance des premières institutions. La société humaine s’organise.
Et elle s’organise autour de la famille. Le village néolithique, symbole universel de cette humanité nouvelle, est dans l’immense majorité des cas un groupe d’habitats unitaires. Mais la cellule de base qu’est la famille va donner naissance, en se démultipliant, à un véritable tissu social. On distinguera bientôt la famille unitaire formée par le couple et ses enfants, la famille patriarcale, constituée par les descendants d’un aïeul encore vivant, le clan dont les descendants se rattachent à un ancêtre disparu mais dont les exploits restent dans les mémoires et enfin la tribu qui regroupe tous ceux qui se réclament d’un ancêtre encore plus lointain, en général mythique ou légendaire.
La société tribale ignore encore l’État en tant qu’institution mais ce n’est plus une société sans pouvoir. Celui-ci existe et il est exercé par les anciens. C’est l’un des grands changements intervenus au néolithique : on ne supprime plus les « vieux ». Ils sont devenus les maîtres. Dans chaque village, chaque clan, chaque tribu, le conseil des anciens administre la communauté et désigne en son sein un chef dont les pouvoirs sont limités. La tribu néolithique est « républicaine ».
Et elle est désormais régie par des règles strictes. Pour régler la vie sociale et gérer la croissance, on a codifié le mariage, inventé les règles de parenté, qui conditionnent les alliances, les règles de filiation, qui déterminent la transmission des biens patrimoniaux. Enfin, en se fixant au sol, il a fallu établir des règles de propriété et de répartition des richesses (la terre) et des revenus (les récoltes).
En se convertissant à l’agriculture et à la vie sédentaire, en effet, nos ancêtres ont du résoudre trois problèmes qu’ils ignoraient jusqu’alors : le partage du travail, le partage des récoltes et le partage de la terre. Si le partage du travail s’imposait, c’est qu’il fallait désormais défricher, clôturer, protéger les récoltes contre les animaux et les intempéries, arroser, récolter, stocker… autant de tâches fastidieuses et répétitives qui nécessitaient discipline et organisation. Le partage des produits se posait lui aussi en termes entièrement nouveaux. Il ne s’agissait plus seulement de répartir entre les membres du groupe le tableau de chasse ou la cueillette du jour mais une récolte censée assurer leur survie pendant des mois. Fallait-il la partager sur le champ (sic) ou la stocker dans des greniers collectifs et la redistribuer au jour le jour ? La terre enfin, devenue capital productif, prenait une nouvelle dimension. Allait-on maintenir son statut de propriété collective ou la partager entre les individus et les groupes, et selon quels critères ? Pour résoudre ces trois problèmes, deux voies étaient possibles. La première consistait à aller dans le sens du collectivisme, avec la mise en commun du sol et des récoltes, une organisation autoritaire du travail et une répartition égalitaire des ressources. La seconde consistait à partager la terre et à laisser à chaque famille le soin de cultiver son champ et de partager entre ses membres le travail et les récoltes.
Nous savons aujourd’hui que nos ancêtres ne choisirent ni le collectivisme ni le chacun pour soi mais qu’ils trouvèrent un habile compromis entre ces deux extrêmes. Et ce compromis, cette troisième voie, fut identique dans le monde entier. Alors que les hommes vivaient sur des continents séparés, isolés les uns des autres, cette troisième voie consista partout à appliquer au sol un statut différent selon l’usage qui en était fait. C’est ainsi que l’ancien territoire de chasse, avec ses landes, ses forêts, ses marais, ses rivières, continua comme par le passé de relever de la propriété tribale et collective. Sur ces parties communes (que l’on appellera un jour les « communaux »), chacun put continuer à chasser, pêcher, faire paître son troupeau. Aux habitations et aux parcelles attenantes, on appliqua le régime de la propriété personnelle, héréditaire. Enfin, pour les terres cultivées, le principe retenu fut celui de l’allotement périodique. Chaque jeune couple recevait un lot de terre dont il avait l’usufruit sa vie durant et qui en fin de vie revenait à la collectivité. Les ethnologues connaissent bien ce mode d’organisation sociale qu’ils ont baptisé « communauté de village ». Ce modèle social, qu’on appellera ici tribal, était fondé sur trois principes :
– la propriété collective du sol
– la redistribution périodique du capital productif : les terres cultivables.
– à chacun selon son travail et ses capacités.
Cet ingénieux système offrait de nombreux avantages. Il permettait à la collectivité de garder le contrôle de la répartition des terres tout en maintenant une économie décentralisée fondée sur l’exploitation familiale. Sur le plan social, il permettait d’assurer l’autonomie de la famille tout en garantissant l’intégration des jeunes dans la communauté. La communauté de village ne connaissait ni exclus ni laissés pour compte et réussissait à concilier la liberté, l’égalité et la solidarité. Les vertus de ce modèle social expliquent probablement pourquoi il a survécu si longtemps à la disparition du monde néolithique.
L’allotement des terres est présent dans toute l’histoire de la Chine. Tombé en désuétude à l’époque féodale, il fut réhabilité par le confucianisme et adopté par l’Empire. La réforme agraire réalisée par l’empereur Wen ti, en 583 de notre ère, attribua à chaque Chinois un lot de terre héréditaire ainsi qu’un lot précaire dont il avait l’usufruit jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Sous la dynastie suivante, celle des Tang, les lots précaires étaient redistribués tous les cinq ans. Ce n’est qu’au IXe siècle que la propriété privée s’imposa définitivement.
Les institutions des Germains, avant qu’ils n’envahissent l’Empire romain, étaient également communautaires. Germania, le livre que leur a consacré l’historien latin Tacite décrit des villages composés de trois parties : les maisons individuelles et les parcelles attenantes, qui relevaient de la propriété privée (c’est l’allod qui deviendra « alleu » en vieux français), les communaux (mark) qui relevaient de la propriété collective, et les parcelles de terre cultivable qui faisaient l’objet d’un allotement périodique.
Toute l’Amérique du Sud vivait sous le régime de la communauté de village lorsque le continent fut envahi par les Espagnols et les Portugais au XVIe siècle. Chez les Incas, chaque paysan recevait en se mariant l’usufruit d’un lot de terre qui s’accroissait à chaque naissance nouvelle. La communauté de village existe encore aujourd’hui au Pérou, légalisée par la loi agraire de 1969. Elle existait également chez les Aztèques et a survécu au Mexique en dépit des efforts entrepris par les pouvoirs publics pour y mettre un terme. En 1856, une loi tenta d’imposer la propriété privée, mais rien n’y fit. Face à l’attachement des paysans à leurs traditions communautaires, l’« ejido » fut officialisé par la révolution de 1910.
En Russie, ce sont vingt millions de paysans qui, au début du XXe siècle, vivaient encore dans le cadre de la communauté de village russe : le mir. Fondé sur la propriété indivise, le mir était dirigé par un conseil des anciens qui redistribuait les terres tous les cinq ans. Pour permettre à ses membres, et en particulier aux jeunes, de sortir de l’indivision, une loi leur offrit en 1906 la possibilité d’opter pour la dissolution des communautés et l’adoption du régime de la propriété privée mais une minorité seulement vota dans ce sens. Le mir russe ne disparut que lorsque Staline imposa la collectivisation complète de l’agriculture.
On pourrait multiplier les exemples. Sur tous les continents, on constate l’existence, à l’aube des temps modernes, de communautés villageoises fondées sur la propriété indivise du sol et l’allotement des terres, qui ne peuvent être que les vestiges du monde néolithique et des tribus républicaines qui ont vécu sur la planète entre 8 000 et 2 000 ans av. J.-C. Vestiges peut-être de cet « âge d’or », de ce paradis terrestre dont le mythe subsiste encore dans la mémoire collective des peuples. Le caractère universel de la survivance des communautés villageoises s’imposa à la fin du XIXe siècle, grâce à des ouvrages comme Village Communities in the East and West publié par l’Anglais Sumner Maine en 1871, ou encore L’histoire de la Propriété du Français Charles Letourneau en 1885. Ces livres évoquaient l’existence d’une civilisation agraire antérieure au monde féodal et fondée sur un modèle social dont le mécanisme essentiel était l’allotement du capital productif.
Pourquoi ce modèle social est-il resté ignoré des économistes, des historiens, des politiques, alors que l’affrontement entre partisans et adversaires du capitalisme et de la propriété privée était alors à son paroxysme ? Tout simplement parce qu’à la fin du XIXe siècle le débat politique européen était déjà enfermé dans un tête à tête exclusif entre marxistes et libéraux et que ce modèle social dérangeait les uns et les autres. Il dérangeait les libéraux qui n’y virent qu’une menace pour le droit de propriété. Mais il dérangeait surtout les marxistes qui avaient déjà fait le choix du collectivisme. Or la communauté de village montrait qu’il y avait peut-être une autre réponse que l’appropriation collective du capital à la critique marxiste du système capitaliste. Il suffisait en effet de donner aux jeunes non pas une ferme et des terres, mais un capital, pour éradiquer la pauvreté et mettre fin à la lutte des classes. Karl Marx ne changea pas d’avis pour autant. Pressé par les communistes russes de prendre position sur l’attitude à adopter à l’égard du mir, il répondit dans une lettre à Vera Zassoulitch : « La commune russe… peut devenir le point de départ direct du système économique auquel tend la société moderne ». Autrement dit, pour Marx, le mir russe n’était qu’une étape vers le socialisme véritable, le socialisme « scientifique », celui du kolkhoze.
La révélation du caractère universel de l’ancien modèle social de la communauté de village avait une autre conséquence importante : elle jetait le discrédit sur l’idéologie marxiste et le postulat sur lequel elle était fondée depuis le Manifeste du Parti communiste de 1848 : « l’histoire de toute société jusqu’à nos jours, c’est l’histoire de la lutte des classes ». Or, avec la meilleure volonté du monde, il était difficile de déceler dans la communauté de village ne seraient-ce que les prémices d’une quelconque lutte des classes. Comment Marx avait-il pu fonder sa doctrine sur une contre-vérité aussi grossière ? Tout bonnement parce qu’en 1848, les Européens ignoraient encore les grandes lignes de l’évolution.
Parce qu’il dérangeait marxistes et libéraux, le modèle social incarné par la communauté de village et qui a régné sur la planète pendant cinq mille ans a été discrètement enterré. Les rares ouvrages sur le sujet ont disparu des bibliothèques. Les programmes scolaires l’ignorent. Le mot « allotement » lui-même a disparu du vocabulaire et des dictionnaires comme si, en faisant disparaître le mot, on avait voulu faire disparaître la chose. Mieux encore : les historiens ont décidé à la fin du XIXe siècle que ce que nous appelons communément l’Histoire avait commencé avec l’invention de l’écriture, c’est-à-dire avec la naissance des sociétés différenciées ou « sociétés de classes », et donc après la disparition des civilisations agraires du néolithique. Cette décision était abusive et en contradiction flagrante avec la réalité historique. Mais elle présentait l’avantage de reléguer nos ancêtres paysans et leurs institutions dans les ténèbres de la « préhistoire ». Les marxistes pouvaient continuer à enseigner sans états d’âme que « l’histoire de toute société jusqu’à nos jours, c’est l’histoire de la lutte des classes ! » Or, l’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’est évidemment pas l’histoire de la lutte des classes. C’est l’histoire qui a commencé il y a dix mille ans lorsque nos ancêtres se sont convertis à l’agriculture et à la vie sédentaire et ont créé les institutions qui sont toujours les fondements de notre société : la famille et la propriété. Pendant cinq millénaires, ils ont déboisé, défriché, construit des villages dont beaucoup sont encore habités, mis en culture la terre et façonné les paysages qui nous sont familiers, tracé des chemins qu’empruntent la plupart de nos routes. Nous les connaissons mal car leurs connaissances, leur philosophie, leurs poèmes, leurs légendes, se transmettaient par voie orale, mais cela ne doit pas nous faire oublier le rôle qu’ils ont joué dans l’Histoire. Comme l’a écrit Alain Daniélou dans l’introduction de son Histoire de l’Inde, « l’Histoire qui ne tient pas compte de l’héritage des civilisations plus ou moins volontairement oubliées ne sera jamais qu’une fiction faussement scientifique ». Mais si nos ancêtres du néolithique méritent de retenir notre attention, ce n’est pas seulement parce qu’ils ont posé les fondations de notre civilisation. C’est parce qu’ils ont vécu au sein de tribus « républicaines », égalitaires, fondées sur un système de répartition du capital (la terre) et des revenus (les récoltes) qui leur a permis de concilier liberté, égalité et solidarité collective. Cinq mille ans après leur disparition, nous n’avons toujours pas réussi à en faire autant.
CHAPITRE 2
Le modèle social féodal
Pourquoi les tribus du Néolithique, égalitaires et républicaines, se sont-elles transformées, vers 3 000 ou 3 500 av. J.-C. (cinq mille ans après l’apparition de l’agriculture) en royaumes hiérarchisés, autoritaires et inégalitaires ? Tout laisse à penser que la réponse à cette question tient en un mot : la guerre.
La guerre occupait une place restreinte dans la vie des chasseurs collecteurs du paléolithique (période antérieure au néolithique). Peu nombreux, disséminés sur de vastes étendues, absorbés par la recherche de nourriture, ils ignoraient l’esprit de conquête et ne possédaient pas de richesses susceptibles d’intéresser les prédateurs. Certes, nous disent les ethnologues, chaque ethnie était en conflit latent avec ses voisins et lançait des incursions sur leur territoire pour leur voler des femmes ou de la nourriture. Mais il ne s’agissait que de simples razzias qui mobilisaient un petit nombre de combattants et faisaient peu de victimes. Étant donné leur armement rudimentaire, aucun ne disposait des moyens permettant d’exterminer l’autre.
Si la révolution néolithique a créé une situation entièrement nouvelle, c’est d’abord en mettant fin aux conditions d’existence et aux pratiques malthusiennes qui, chez les chasseurs collecteurs, limitaient les naissances. La vie sédentaire permettait désormais aux femmes d’avoir une famille nombreuse. Les paysans avaient par ailleurs besoin de bras pour travailler la terre, et comme l’agriculture permettait de nourrir une population beaucoup plus nombreuse, toutes les conditions étaient réunies pour que la natalité explose, entraînant une forte croissance démographique. Les ethnologues estiment que la population mondiale a décuplé pendant les cinq mille ans du néolithique, passant de cinq à cinquante millions d’habitants, avec les conséquences qu’on imagine : nécessité permanente de défricher de nouvelles terres, de créer de nouveaux villages, de réduire la taille des parcelles, jusqu’au jour où le manque d’espace poussa certaines tribus à s’emparer des terres de leurs voisins. Il ne fallut alors que quelques siècles pour que l’insécurité prenne une place croissante dans la vie des peuples. L’archéologie le confirme : à la fin du néolithique, les villages s’entourent de murs et de fossés alors qu’ils étaient jusque-là dépourvus de systèmes de défense.
Un autre facteur déterminant a été le prog...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Titre
- Copyright
- SOMMAIRE
- INTRODUCTION
- PREMIÈRE PARTIE – Les modèles sociaux à travers l’Histoire
- DEUXIÈME PARTIE – La suite de l’Histoire