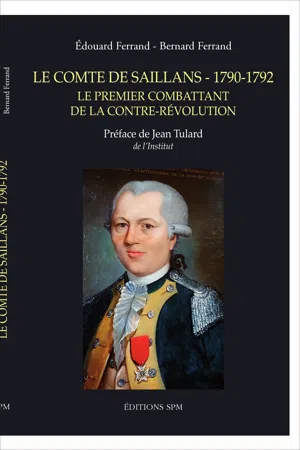
eBook - ePub
Le comte de Saillans - 1790-1792
Le premier combattant de la contre-révolution
- 182 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Le comte de Saillans - 1790-1792
Le premier combattant de la contre-révolution
À propos de ce livre
François-Louis, comte de Saillans (1741-1792) est le chaînon manquant des historiens de la période. Son action aurait pu en effet changer le cours de l'Histoire de France. Son épopée du Midi de la France fut le premier soulèvement contre-révolutionnaire. Elle a joué en contrecoup un rôle décisif dans la mise en accusation de Louis XVI et son exécution. Des documents inédits et de nouveaux éclairages sur le procès de Louis XVI apportent une lecture neuve sur les derniers temps de la Monarchie.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Le comte de Saillans - 1790-1792 par Edouard Ferrand,Bernard Ferrand en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Histoire et Histoire du monde. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
HistoireSujet
Histoire du mondeChapitre 1
Au service du roi
« Servir le roi ! ». On a du mal de nos jours à saisir toute la force de cette expression. Il ne s’agissait évidemment pas d’un service public, comme celui dans lequel on « fait » aujourd’hui carrière. Le service, pour les hommes de l’Ancien Régime, était un honneur allant de soi et l’on se grandissait en l’accomplissant. La personne du roi était l’objet d’une dévotion quasi surnaturelle ; on le disait le « Premier des rois ». Aucun souverain ne pouvait lui être comparé, ni pour l’ancienneté de sa couronne, ni pour l’éclat de son trône, ni pour la justice et la sainteté de son pouvoir. Il était salué comme le père de la patrie et comme le bienfaiteur public. « Tout l’État est en lui » écrivait Bossuet au XVIIe siècle « la volonté du peuple est enfermée dans la sienne ; comme en Dieu est réunie toute perfection et toute vertu, ainsi toute la puissance des particuliers est réunie dans celle du prince ». Les Français nés dans les décennies d’avant la Révolution éprouvaient encore pour le roi un sentiment de dévouement qui revêtait un caractère religieux ; le mot de roi était pour eux revêtu d’une magie, d’une puissance que rien n’avait encore altérée. L’ancien ministre Gabriel Sénac de Meilhan pouvait encore écrire à la veille de la Révolution : « Le peuple dans son extrême enthousiasme adore ses rois ».
« Le roi est mort, vive le roi ! », proclamait-on à la mort du souverain pour exprimer la continuité du pouvoir monarchique. Cette vision mystique de la monarchie française fut particulièrement bien expliquée par l’historien Ernst Kantorowicz, évoquant les « Deux corps du roi », l’un physique, l’autre politique, véritable allégorie du corpus socio-politique du peuple français d’alors. Et plus loin il développe que le pouvoir s’inscrit alors dans une sorte de théologie politique, dans laquelle le roi, au-delà de la personne charnelle, incarne le divin auprès de ses sujets sans toutefois prétendre à une transcendance qui l’autoriserait à outrepasser son simple rôle de représentant de Dieu sur Terre.
Le roi était l’artisan de l’unité nationale. Tous ses sujets savaient que la lignée capétienne, d’âge en âge, avait forgé la France, d’abord en soustrayant la couronne aux aléas de l’élection, puis en s’imposant, sur les ruines de l’anarchie féodale, par son aptitude à établir partout l’ordre et la paix. Chaque souverain disait dans le serment du jour de son sacre, « rendre bonne justice à chacun selon ses droits ». Avec l’âpreté d’un fermier qui arrondit son domaine, les Capétiens avaient constitué autour de leur « pré carré » un royaume équilibré, prospère et où il faisait bon vivre. On connaît le propos du célèbre diplomate Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord : « Ceux qui n’ont pas vécu avant 1789, ne connaissent pas la douceur de vivre ! ».
Le roi était aussi chef de la défense publique, il avait, au cours de la déjà longue histoire de France, combattu Suédois, Anglais, Allemands, Espagnols, Autrichiens, Hollandais avec plus ou moins de chance, mais toujours avec obstination et dans le souci de resserrer l’unité nationale, laquelle depuis Bouvines en 1214 était restée vivace, comme en témoigne Georges Duby dans Le dimanche de Bouvines.
Servir des princes qui devaient toujours faire preuve de bon sens, de probité, de persévérance et d’un grand sens des réalités était pour le premier ordre dans le royaume, la noblesse, vouée aux armes, une chose toute naturelle à laquelle on ne pouvait se soustraire sans y perdre ce qu’un gentilhomme avait de plus précieux : son honneur. Cela ne se discutait même pas, tant la monarchie, depuis tant de siècles où elle se moulait sur les réalités françaises, avait montré qu’elle était conforme à ce qui fut toujours présenté comme l’ordre naturel. Les rois, par lesquels la France se prolongeait par les lois mêmes qui font durer le genre humain, celles de l’hérédité, avaient compris que l’avenir devait se rattacher en toute chose à la tradition et souhaiter inculquer à chaque génération l’exactitude du précepte du catéchisme de toujours : « Tes père et mère honoreras afin de vivre longuement ».
C’est pourquoi, pour la génération de François-Louis de Saillans, la monarchie, ayant su se donner à jamais les moyens de vivre longuement, était assurée de s’éterniser, ou du moins, de vivre tant que durerait la France. Ces premières considérations sont utiles pour bien comprendre le drame personnel et politique que vécut cet homme, quand il vit s’effondrer l’édifice millénaire et quand, pour servir le roi, il lui fallut se mettre selon lui dans l’illégalité.
François-Louis de Saillans naquit le 30 octobre 1741, à Herbigny dans les Ardennes. Il était le fils de Pierre de Saillans, seigneur en partie d’Herbigny, Estrebay, Vigneux et autres lieux, et de son épouse Jeanne-Marguerite de Beuvry, fille de Robert de Beuvry, lieutenant-colonel au régiment de Boulonnois, chevalier de Saint-Louis.
La famille de Saillans tirait son nom du château du même nom situé dans le diocèse de Clermont en Auvergne. Au XIe siècle, plusieurs branches en étaient issues ; celles du Dauphiné, de Provence, du Haut-Vivarais, du Gévaudan1… En 1550, un rameau des Saillans de Provence vint s’établir en Picardie, et la filiation de cette lignée allait être établie par Louis-Pierre d’Hozier, juge d’armes de France, en 17492. De valeureux capitaines de chevaulégers ou lieutenants de cavalerie figurent dans cette généalogie avant que Ferry, arrière-grand-père de François-Louis, servant dans la compagnie d’Augicourt au régiment de la Reine, épousât en 1660 Anne d’Allendhuy, propriétaire de biens à Herbigny, et vînt s’installer dans ce petit village, en tant que seigneur du Hamel et d’Herbigny. Son fils Pierre, grand-père de François-Louis, chevalier, seigneur d’Herbigny, épousa en 1698, sa cousine Magdeleine d’Artaize, qui lui donna cinq enfants.
Pierre, le père de François-Louis, né le 11 novembre 1707, fut de ceux-ci, et son épouse, Jeanne-Marguerite de Beuvry, qu’il avait épousée à Vitry le 12 décembre 1721, lui donna à son tour douze enfants : Madeleine, Françoise-Suzanne, Jean, Marie-Claire, Agnès, Marie-Anne, François-Louis, Louise-Madeleine, Robertine-Marguerite, André-Nicolas, Louis-Joseph et Jean-François.
Cette noble lignée s’honorait en outre d’alliances prestigieuses : les seigneurs de Parthenay, la Maison de Hénin-Liétard, les princes de Chimay, les princes de Beauvau-Craon, les ducs d’Arenberg, les princes de Ligne… Tout promettait à François-Louis un bel avenir et une brillante carrière militaire…
On sait peu de chose sur sa petite enfance et l’on en est réduit à imaginer qu’il devait aimer jouer avec ses nombreux frères et sœurs sur l’éminence que coiffait alors la propriété des Saillans, le château d’Ecordal, au sud du village à proximité de l’église. Là, surplombant ce lieu humide, ne présentant, selon l’abbé Jean Guiraud, curé de Justine et d’Herbigny3 de 1902 à 1912, « qu’un fouillis d’épais herbages » d’où le village tire son nom : lieu herbeux, il pouvait, contemplant les larges fossés qu’alimentait le ruisseau voisin, rêver des combats qui s’étaient déroulés ici, selon Froissart dans ses Chroniques sur la Guerre de Cent ans. Son désir de servir le roi s’éveilla-t-il au cours de ces promenades champêtres ? Sans doute fréquentait-il aussi la petite église de son village, où le clocher-porche était en pans de bois, le reste de la construction étant en pierre et en briques. Une pierre gravée dans le calcaire de la région portait le nom du maçon qui avait travaillé à la restauration de l’édifice en 1637. Occasion pour le jeune François-Louis de constater combien le petit peuple des paysans et artisans était attaché à ses beaux lieux de culte traditionnels, comme cinquante ans plus tard il allait voir les paysans du Vivarais s’insurger au risque de leur vie contre la Révolution athée…
Si l’enfance de François-Louis fut si discrète, cela tient au fait qu’au XVIIIe siècle, où la mortalité infantile était très forte, un nouveau-né sur trois mourait avant d’avoir atteint son premier anniversaire, on ne considérait guère l’enfant en tant que tel, préférant voir en lui l’homme qu’il serait plus tard et qu’il fallait l’aider à se forger. Tout semblait indiquer que le jeune chevalier embrasserait la carrière militaire : il fut à cet effet envoyé à quinze ans à Versailles pour être page de Louis XV.
Protégé de Mesdames de France, filles du roi, il commença le 15 février 1757, à peine à l’âge de seize ans, à servir comme volontaire dans le régiment de Bouillon-Infanterie, corps qui venait d’être créé pour la Guerre de Sept Ans par le duc de Bouillon pour servir la France sur le pied étranger, recrutant dans le duché de Bouillon et dans les Ardennes voisines. Le 1er avril 1759, il fut fait cornette dans le régiment des volontaires de Hainaut, régiment de cavalerie française créé en 17574, avant d’être nommé lieutenant d’infanterie dans le même corps, le 1er janvier 1760. En 1765, il reçut de Mesdames de France une pension pour être aspirant à l’École navale de La Fère en Picardie. M. de Saint Auban, maréchal de camp, chef d’une brigade du corps royal, reçut alors une belle lettre signée du duc de Choiseul-Lorrain, alors ministre-secrétaire d’État aux Affaires étrangères, à la Guerre et à la Marine :
Le roi vient, Monsieur, d’accorder au chevalier de Saillans qui a l’honneur d’être protégé par Mesdames, une place d’aspirant à l’ancienne école du corps royal d’artillerie de La Fère. Vous le recevrez en cette qualité lorsqu’il vous présentera cette lettre. J’ai l’honneur d’être très parfaitement, Monsieur, votre humble et très obéissant serviteur.
C’est dire de quelle estime jouissait le jeune chevalier de Saillans.
Après le décès de son père le 22 février 1767 à Herbigny, il fut nommé sous-aide major d’infanterie le 11 décembre 1768, puis il fut réformé, par ordonnance particulière du roi du 1er mars 1771, pour passer en Corse, récemment devenue française5, mais il continua d’exercer ses fonctions malgré sa réforme. Par lettre du 17 avril de la même année, le roi, en considération de ses éminents services, déclara continuer de lui verser ses appointements. Commis le 13 juillet 1771 capitaine dans le même corps, devenu depuis 1768 Légion de Lorraine, le chevalier de Saillans n’alla jamais en Corse, mais… en Pologne pour rencontrer l’occasion de son premier glorieux fait d’armes !
À l’appel de François-Louis, marquis de Monteynard, secrétaire d’État à la Guerre après la disgrâce de Choiseul, il alla se mettre sous les ordres du baron Antoine-Charles du Houx de Viomesnil, maréchal de camp, et de Claude-Gabriel de Choisy, lieutenant-colonel des volontaires du Hainaut. Il partit donc de Bitche le 25 juillet 1771. Il s’agissait de participer à une discrète intervention en faveur de l’infortunée Pologne agressée par les soldats, de jour en jour plus nombreux, de Catherine II de Russie.
1 D’après Simon Brugal, pseudonyme de Firmin Boissin, auteur des Camps de Jalès, édité dans la Revue de la Révolution entre 1885-1886, par Sauton, Paris.
2 Preuves de noblesse présentées par Marie-Anne de Saillans, sœur de François-Louis, pour être admise dans la Maison royale de Saint-Cyr dans le parc de Versailles.
3 Ces deux paroisses, désormais réunies, forment le village de Justine-Herbigny (département des Ardennes), groupant quelque cent soixante-dix habitants.
4 Devenu en 1768 légion de Lorraine, reformé en 1779 en tant que 9e régiment de Chasseurs à cheval, puis en 1788 en tant que régiment de Chasseurs de Lorraine, puis renommé en 1791 9e régiment de Chasseurs, puis devenu en 1959 le 4e régiment des Chasseurs d’Afrique avant d’être définitivement dissous le 1er octobre 1961.
5 Par le traité de Versailles (15 mai 1768) Gênes mettait la Corse sous la protection de la France, mais Louis XV dut combattre jusqu’en juin 1769, les troupes de Pascal Paoli. Le 15 août suivant, naissait à Ajaccio Napoléon Bonaparte…
Chapitre 2
L’affaire du partage de la Pologne
L’union du royaume de Pologne et du grand-duché de Lituanie en un seul État qui se nommait Rzeczpospolita, avait créé au XVIIe siècle un grand royaume qui couvrait un territoire allant de la mer Baltique à la mer Noire et jusqu’aux portes de Moscou. La capitale était alors Cracovie, sur la Vistule.
La Rzeczpospolita était un système politique inédit où l’aristocratie exerçait une sorte de démocratie parlementaire. Le roi était en effet élu par ses pairs ; c’était le principe de la monarchie élective ou plutôt, de l’anarchie nobiliaire… Cette « république » donnait le droit de vote à la seule noblesse polonaise, laquelle représentait presque 15 % de la population et plus encore autour de Varsovie, devenue capitale en 1596. Les nobles obligèrent alors le roi à céder certaines de ses prérogatives, notamment celles concernant les impôts, l’armée et la justice. Ainsi, le monarque polonais, à l’époque où les monarchies européennes tendaient toujours vers l’absolutisme, était au contraire très affaibli.
Victime d’un long déclin, du fait de son système politique aberrant et des nombreuses invasions, suédoises, turques, prussiennes, russes, la Pologne avait perdu son indépendance et les partages de son territoire la menaçaient.
La diplomatie parallèle dite du Secret du Roi, dirigée à la Cour de Versailles alors par Charles-François, comte de Broglie, s’inquiétait du sort de ce pays ami. Déjà le colonel Charles-François du Perrier du Mouriez, le futur général Dumouriez des armées de la Révolution française, avait été envoyé en mission au cours de l’été 1770. Étienne-François, duc de Choiseul, était encore, sans en posséder le titre, le véritable premier ministre de Louis XV. Or, l’avenir paraissait sombre pour les alliés de la France : la Turquie, encouragée par Choiseul, s’était enlisée dans une guerre contre la Russie ; la Suède était aussi dans une position très fragile ; la Pologne, espèce d’anarchie aristocratique, était une cible pour les appétits territoriaux de ses voisins : l’Autriche, la Prusse et la Russie. Mais Choiseul voulait adopter une attitude prudente sur la question polonaise. Et le voyage de Dumouriez n’avait officiellement d’autre but que d’« avoir une connaissance exacte de ce qu’on pouvait espérer des efforts des Polonais, avant de prendre un parti »1.
Des troupes russes stationnant en Pologne depuis la fin de la guerre de Sept Ans, la tsarine Catherine II avait...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Titre
- Copyright
- Citation
- Dédicace
- PRÉFACE
- INTRODUCTION
- Chapitre 1 – Au service du roi
- Chapitre 2 – L’affaire du partage de la Pologne
- Chapitre 3 – Saillans, une efficacité militaire au service du politique
- Chapitre 4 – Les camps de Jalès, premières oppositions politiques à la Révolution
- Chapitre 5 – L’Ardèche, laboratoire de l’action contre-révolutionnaire
- Chapitre 6 – Saillans, une âme de chef contre-révolutionnaire
- Chapitre 7 – La conspiration Saillans, une tentative de guerre civile nationale
- Chapitre 8 – La riposte révolutionnaire
- Chapitre 9 – La répression d’un véritable projet contre-révolutionnaire
- Chapitre 10 – Un soulèvement contre-révolutionnaire fondé sur un projet politique préalable
- Chapitre 11 – Le rôle fondamental de la conspiration Saillans dans l’acte d’accusation de Louis XVI
- Chapitre 12 – Des émules du comte de Saillans
- Conclusion
- Sources
- Bibliographie
- Table des matières