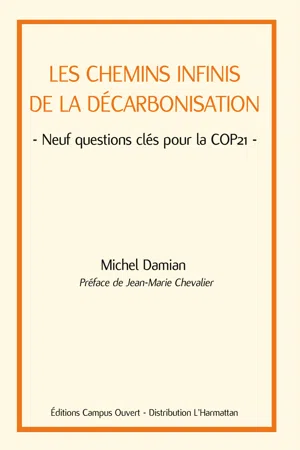
eBook - ePub
Les chemins infinis de la décarbonisation
Neuf questions clés pour la COP21
- 136 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
L'économie néoclassique de l'environnement – signal prix et marché de permis carbone – qui a sous-tendu les négociations climatiques internationales a fait perdre deux décennies à la compréhension de la question climatique. La nouvelle économie de l'effet de serre va devoir trouver les voies concrètes de la décarbonisation. Les tensions et conflits productifs, sociaux et de redistribution ne manqueront pas. L'économie politique des changements climatiques au XXIe siècle sera une longue, longue bataille.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Les chemins infinis de la décarbonisation par Michel Damian en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences biologiques et Écologie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
Sciences biologiquesSujet
Écologie1/ Le protocole de Kyoto
Une histoire américaine
Le protocole de Kyoto était fondamentalement d’inspiration américaine, même si les Etats-Unis s’en sont retirés par la suite : il reprenait les grandes lignes de l’argumentation soumise par le gouvernement américain au début de l’année 1997 (USIA, 1997). Les propositions – marché de permis, mécanisme de développement propre, flexibilité – étaient entièrement dominées par les dogmes de l’économie néoclassique, ceux de la théorie des prix et des incitations de marché.
Pour la conférence de Paris, les Etats-Unis ont été le premier pays à faire connaître, le 12 février 2014, leur proposition : 1) un accord sur des « politiques nationales » en lieu et place d’une grande construction internationale ; 2) des « contributions », non plus des engagements (USA, 2014b). Cette proposition prend ses distances avec le substrat économiciste qui présidait au design de Kyoto. Elle se place sur un terrain plus politique qui privilégie l’acceptabilité nationale, interne, de l’accord international.
La position américaine n’est pas une surprise, elle était connue et pouvait être anticipée. Leur négociateur, Todd Stern, l’avait énoncée à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2013 : pour Paris, des plans nationaux de réduction des émissions sont la seule alternative crédible au protocole, qui a échoué et dont le cadrage international et contraignant n’est plus acceptable.
Il faut entendre la ligne de force qu’ont tracée les positions américaines successivement pour Kyoto puis Paris. Depuis un quart de siècle, les Etats-Unis ont été (Berthaud, Cavard, Criqui, 2004), et demeurent, la clé du régime climatique. Les évolutions de forme et de substance de la coopération climatique internationale sont tout sauf contingentes. Elles portent la marque de la préférence des Etats-Unis. C’est ce qu’ils feront à Paris avec, cette fois, l’assentiment et certainement le soutien de la Chine, du moins pour les grands axes de la négociation.
Entre la préparation et la signature de Kyoto en décembre 1997, l’Europe a progressivement endossé puis soutenu les positions des négociateurs américains en faveur d’un marché de permis carbone. Après le retrait des Etats-Unis du protocole en 2001, l’Europe a cru, un temps, pouvoir reprendre le leadership en ce qui concerne la justification et la mise en œuvre de ce marché (Système Communautaire d’Echange de Quotas d’Emission, SCEQE ; en anglais European ‘Union Emissions Trading System, EU ETS). Aujourd’hui, elle est à la peine, loin de pouvoir insuffler ses ambitions anciennes et bien incapable de faire prévaloir ses propres préférences de règles.
1992 : l’abandon du projet d’écotaxe européenne
L’Europe a longtemps été opposée au marché de permis, préférant un système de taxation. En octobre 1991, la Commission européenne avait proposé d’introduire, dès 1993, une taxe sur l’énergie pour lutter contre l’effet de serre. L’annonce initiale comprenait une redevance de 6 % sur les produits pétroliers et de 58 % sur le charbon, dont la combustion affecte davantage l’environnement. Mais une telle taxation aurait par trop favorisé l’énergie nucléaire. Après discussions et négociations, le projet est devenu celui d’une redevance à la fois carbone et énergie : une taxe pour 50 % sur le contenu carbone de la production énergétique et pour 50 % sur les prix de l’énergie. Il s’agissait du premier projet robuste d’écotaxe européenne, susceptible de favoriser une croissance plus soutenable (Godard, 1992). La proposition fut immédiatement reçue comme « une agression » par les producteurs de pétrole (Maurus, 1991), avec également un tir de barrage des industriels européens (Ripa di Meana, 1992 ; Letourneur, 1992). En France, les industries grosses consommatrices d’énergie (matériaux et biens intermédiaires) estimaient en effet que leur compétitivité serait gravement affectée par une taxe exclusivement européenne (Giraud, Nadaï, 1994).
A la fin du printemps 1992, le projet européen de taxe était retiré. En plus des producteurs de pétrole et des industriels, les Américains et leur président, Georges Bush, étaient farouchement contre. C’était pour eux un casus belü. De surcroît, la politique fiscale étant du ressort strict de chaque Etat de l’Union, la mise en œuvre d’une telle taxe aurait exigée un vote unanime, impossible à obtenir, de tous les Etats européens. En conséquence, Carlo Ripa di Meana, le Commissaire européen à l’Environnement, refusa – on l’a oublié – de se rendre à la conférence de Rio de Janeiro en juin : a une parade où s’êtalerontla vanitêet l’hypocrisie » (Ripa di Meana, 1992).
Des économistes américains ont contribué à la démolition du projet européen. L’histoire est finement décortiquée par Olivier Godard. En février 1992, Alan Manne (Université de Stanford) et Richard Richels (Electric Power Research Institute, EPRI), deux économistes reconnus pour leurs travaux sur l’énergie et le changement climatique, publient un document de travail qui expose que le coût de la taxation proposée aurait été deux fois plus élevé relativement au PIB pour les Américains que pour les Européens. Inacceptable. Un an plus tard, en janvier 1993, ils publient le même document sous forme d’article dans la revue ‘Energy Toücy. Mais, après le processus de relecture par des pairs avant publication, ils sont amenés à modifier – à renverser complètement – certaines de leurs hypothèses ainsi que la conclusion politique de leur étude. Cette fois, les Etats-Unis apparaissent comme les gagnants relatifs de l’introduction d’une taxe sur le CO2. Pour l’Europe, l’ordre de grandeur du coût est multiplié par quatre. La conclusion d’Olivier Godard est ravageuse : « De la maniéré d’interpréter les taxes sur l’énergie dépend le tableau des gagnants et des perdants… » (Godard, 2010a, p. 97).
Marché de permis :
l’Union Européenne dans la trappe
de l’argumentaire américain
A Kyoto, l’Europe s’est une seconde fois inclinée devant les choix prônés par les Etats-Unis, même si l’on peut aussi parler de « compromis » entre les positions défendues des deux côtés de l’Atlantique (Hourcade, 2001 ; Aykut, 2014). Antérieurement au lancement des négociations pour le protocole, les divergences entre Européens et Américains étaient profondes. Pour Eugene Skolnikoff, qui a mené à cette époque une série d’entretiens des deux côtés de l’Atlantique, les Européens savaient parfaitement que les Etats-Unis étaient opposés à s’engager dans des objectifs de réduction des émissions conséquents ; ils ont tenté de tirer de la situation des bénéfices politiques en proposant des cibles (des quotas) de réduction élevées, que les négociateurs américains ne pouvaient accepter (Skolnikoff, 1997).
Le recours aux permis négociables a progressivement été soutenu par l’ensemble des forces politiques, économiques, mais aussi environnementales au sein de l’UE. Le réseau des organisations non-gouvernementales pour le climat (Climate Action Network, CAN) a endossé l’engagement européen avec le double espoir – complètement évanoui depuis – que les marchés de permis deviendraient le mécanisme clé de contrôle des quotas, et que des objectifs ambitieux de limitation des émissions pourraient être imposés aux industriels (Convery, 2009, pp. 402-403). Loren Cass (2005) a raison d’écrire que l’Union Européenne est tombée dans la « trappe » de l’argumentaire américain. Le regard de Stavros Afionis sur ce marché est plus perfide, l’Europe aurait pu s’en passer : « Avec ironie, écrit-il, on peut soutenir que l’UE […] aurait été capable, selon toute probabilité, de respecter ses engagements dans le cadre du protocole de Kyotoy compris si elle n’avait pas mis en œuvre un système depermis d’émissions négociables. » (Afionis, 2011, p. 349).
Kyoto, l’impasse
Il y avait initialement six gaz à effet de serre d’origine anthropique comptabilisés dans le protocole de Kyoto : le CO2 (dioxyde de carbone), le CH4 (méthane), le N2O (protoxyde d’azote), les HFC (hydrofluorocarbures, couverts par le Protocole de Montréal), le PFC (hydrocarbures perfluorés), et le SFô (hexafluorure de soufre). Un septième, le NF3, (trifluorure d’azote, utilisé dans l’industrie électronique et dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, avec un pouvoir réchauffant 17 000 fois plus élevé que celui du CO2) a été rajouté en 2011. Le gaz carbonique d’origine humaine, CO2, est responsable pour plus de 55 % de l’effet de serre additionnel (il provient pour l’essentiel de la combustion des énergies fossiles, en particulier lors de la production d’électricité à partir du thermique charbon), le méthane pour au moins 15 %, les halocarbures, dont les HFC, pour 10 %, le protoxyde d’azote pour environ 5 %, et l’ozone troposphérique (qui ne figure pas dans la liste Kyoto) pour 10 %.
Le niveau de concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère se calcule en partie par million en volume (ppm ou ppmv), soit en nombre de molécules de CO2 par million de molécules d’air sec. Les premières mesures, effectuées en 1958, montraient que la concentration était de 315 ppm, déjà en forte augmentation par rapport aux teneurs estimées à 278 ppm avant la révolution industrielle. En 2015, la concentration atmosphérique est de 400 ppm pour le CO2 et tournerait autour de 80 ppm pour les autres gaz à effet de serre (concentration mesurée en CO2- équivalent). Selon les climatologues, une stabilisation des émissions autour de 445-490 ppm en 2050 entraînerait une élévation des températures comprise entre 2°C et 2,4°C par rapport à l’époque préindustrielle. On serait donc déjà au-dessus de 450 ppm, c’est-à-dire au-dessus de la borne à ne pas dépasser si l’on veut maintenir le réchauffement en dessous de 2°C (objectif sur lequel nous reviendrons). Bert Bolin, célèbre météorologiste suédois et premier président du GIEC (Groupe d’experts intergouvememental sur l’évolution du climat, en anglais Intergovemmental Panel on CUmate Change, IPCC), estimait, en janvier 1998, au lendemain de la signature du protocole, qu’avec les engagements des pays la concentration totale de l’atmosphère en CO2 serait d’environ 382 ppm en 2010. Sans actions de limitations elle serait de 1 à 1,5 ppm plus élevée. Donc une concentration de 382 ppm en 2010 avec Kyoto et de 383 ou 383,5 sans Kyoto (Bolin, 1998, p. 331). Une mesure à peu près insignifiante. Kyoto n’a en effet jamais été envisagé autrement que comme une toute première et modeste étape pour la maîtrise du réchauffement : il faut d’autres efforts internationaux, très rapidement, bien avant 2010, insistait alors Bolin.
Nous indiquions en introduction que le système Kyoto était aujourd’hui dans une « impasse », obsolète. Il faut être plus précis. Signé fin 1997 et entré en vigueur en 2005, le protocole avait pour objectif, après le retrait des Etats-Unis, de réduire les émissions de gaz à effet de serre des 37 pays engagés de 5 %, puis de 4 % pour 36 pays suite à la sortie du Canada, sur la période 2008-2012, première période d’engagement, par rapport à l’année de base 1990. Les objectifs ont été largement dépassés : -24 % (Morel, Shishlov, 2014). Mais il faut entrer dans les détails, car certains déterminants ne doivent rien à la politique climatique, en particulier hors de l’Union Européenne, avec une chute de grande ampleur des émissions dans les pays de l’ancien bloc soviétique de 1990 à 1997, après une allocation particulièrement généreuses de quotas à émettre. Le plus étonnant est qu’il est impossible d’avoir une idée un peu précise de l’impact du protocole de Kyoto au sein même de la seule Europe. Voici la synthèse que dresse Benoit Leguet, directeur de la recherche à la CDC climat, la filiale de la Caisse des dépôts dédiée à l’économie des marchés carbone : « On sait seulement que dans UOnion Européenne 50 % de cette réduction est due au développement des énergies renouvelables et au système ETS d’échange de quotas de CO2, 40 % à la crise économique, etenviron 10 % aux modifications du mix énergétique. » (Senet, 2014).
Mais il y a plus dommageable pour le système Kyoto lui-même. Tous les chiffres relatifs à la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre sont mesurés officiellement au niveau de la production. Or, il y a ce que l’on appelle les « fuites de carbone » {carbon leakagé), représentées par les émissions contenues dans les biens importés. Le fait pour un pays d’avoir ratifié Kyoto, donc d’être engagé à réduire ses émissions, a-t-il eu un effet sur le volume de carbone importé ? Rachel Aichele et Gabriel Felbmayr (2010, pp. 27-28) ont montré qu’en 2005 les pays signataires de Kyoto ont importé environ 40 % du CO2 qu’ils ont consommé en provenance de pays non signataires ; avec une tendance à l’augmentation des émissions importées qui semble s’être renforcée depuis la signature du Protocole : celles-ci ont augmenté d’environ 50 % sur la période 1995-2005. Ils montrent surtout que les importations de carbone d’un pays signataire de Kyoto en provenance de pays exportateurs hors Kyoto sont en gros supérieures de 10 % à celles d’un pays non signataire du protocole et donc sans engagement. Il faut être prudent dans l’interprétation de ce chiffre et des causes d’une importation de carbone des pays Kyoto supérieure à celle des pays hors Kyoto. Mais le résultat est bien là : les pays signataires du protocole importaient un peu plus de carbone que les autres. Comme le dit Joan Martinez-Ailier, les économies en apparence plus « propres » fonctionnent sur la base de l’importation de produits « sales ». Puisqu’il n’y a pas d’accord international obligeant tous les pays à réduire leurs émissions, ces résultats suggèrent, écrivent Aichele et Felbermayr, que la meilleure politique climatique pour l’analyse économique néoclassique (optimum de premier rang), à savoir un système international de marché de permis carbone, est inapplicable.
Du côté des géographes, les mots de Martine Tabeaud et Hervé Brédif étaient cinglants au lendemain de l’échec, en 2009, de la conférence de Copenhague à élargir Kyoto : « un certain nombre de pays et d’opérateurs ont voulu croire en la possibilité d’un accord contraignant à visée mondiale […] le rêve d’une solution globale et définitive. Rêve entretenu plus ou moins consciemment par un ensemble d’acteurs qui tirent prestige, pouvoir et profit de privilégier un tel mode d’action. […]
Ouvrons les yeux. Reconnaissons que d’autres approches, plus respectueuses de la complexité et de la diversité du monde sont souhaitables et assurément possibles. […] Æder le corps social à se saisir d’un problème nouveau, organiser sa prise en charge dans un souci de cohérence plus large, faciliter les synergies positives entre initiatives de nature, de portée et d’échelle distinctes : ici comme ailleurs, l’avenir du politique dépendra moins de sa détermination à faire accepter des solutions toutes faites que de sa capacité à favoriser une gestion en patrimoine commun de réalités complexes. » (Tabeaud, Brédif, 2010). Il est désolant que tant d’investissement politique et diplomatique, d’expertise et de recherche, aient conduit à d’aussi piètres résultats, avec un mécanisme Kyoto qui sera passablement en retrait à la conférence de Paris. On sait déjà que les Etats-Unis ni ne contribueront à la survie du protocole ni ne participeront à un hypothétique marché international du carbone avant longtemps ; ils l’ont confirmé officiellement le 31 mars 2015, lors de la remise de leur contribution au titre du futur accord de Paris auprès du secrétariat de la Convention-cadre : a Pour le moment, les Etats-Unis n’entendent pas utiliser les mécanismes du marché international pour mettre en œuvre leurs objectifs à l’horizon 2025. » (USA, 2015).
Au plus haut niveau des think tanks européens, et des hommes qui comptent, la prise de conscience se fait jour, même si c’est en termes mesurés, de la nécessité de sortir d’un cadre, si ce n’est d’une trappe, qui n’a pas produit les effets jadis escomptés. Dans un récent rapport de Notre Europe/Institut Jacques Delors, avec une préface de ce dernier, les auteurs dressent trois constats : 1) a avec moins de 5 % des émissions mondiales [de gaz à effet de serre] en 2030, il pourrait être difficile pour l’UE de continuer à jouer un rôle de premier plan » en matière de politique climatique, 2) Seule « une infime partie » de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe semble pouvoir être imputée au marché des permis carbone (d’autres facteurs, dont le ralentissement économique, ont joué un rôle beaucoup plus essentiel), 3) L’Union Européenne doit aller « au-delà de la révision » de son marché de permis et « envisager l’adoption d’un système de taxation du carbone », (Andoura, Vinois, 2015, pp. 134, 74, 141-142). L’heureux temps, où Christian de Perthuis, alors membre du centre de recherche sur l’économie de l’environnement de la Caisse des Dépôts, pouvait écrire, à la naissance du marché européen de permis, « ce nouvel être a un bel avenir devant lui » (De Perthuis, 2006), s’en est enfui. Une attitude réflexive des économistes qui ont chanté PEU ETS serait la bienvenue. Comment, faudrait-il aussi s’interroger, Roger Guesnerie, qui a dirigé en France le premier rapport sur l’économie de l’effet de serre publié en 2003 par le Conseil d’analyse économique (Guesnerie, 2003b), a-t-il pu écrire – mais c’était il y a longtemps – que la suspicion à l’encontre du marché de permis « repose sur une réticenceprofonde vis-à-vis des solutions marchandes » (Guesnerie, 2003a, p.59) ?
Pourquoi la préférence des Etats-Unis allait-elle, durant la décennie 1990, vers un système international de marchés de permis carbone, et pourquoi ont-ils argumenté avec force pour cela dès 1996, puis jusqu’aux ultimes négociations pour la signature du protocole de Kyoto le 11 décembre 1997 ? La réponse peut être énoncée de manière triviale : « c’est moins cher ». Dans les termes de l’économie standard de l’environnement, un marché de permis est plus cost-efficient que n’importe quel autre outil de régulation des externalités négatives, c’est-à-dire doublement plus efficace : 1) pour atteindre l’objectif de dépollution retenu et, 2) en minimisant le coût total de la réduction des émissions. Un retour dans le temps permettra de mieux comprendre la préférence américaine.
Aux origines de la préférence américaine
pour un marché international des permis carbone
Le clivage initial, lors des premières discussions en 1988-1989, opposait les approches « par le haut » – un accord international s’imposant à tous – versus « par le bas » – des politiques nationales au gré des contraintes, ambitions et moyens de chacun –, soutenues respectivement par l’Union Européenne et les Etats-Unis. Les deux premières réunions ont été tenues à Toronto, en 1988, et à Noordwijk, aux Pays-Bas, en novembre 1989. C’est lors de ces deux conférences qu’ont été proposés pour la première fois – par les Européens – des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Copyright
- Titre
- Citation
- Préface par Jean-Marie Chevalier
- Introduction - « Un accord historique sur le climat »
- 1/ Le protocole de Kyoto Une histoire américaine
- 2/ L’accord de Paris. Un G2 climatique Etats-Unis/Chine
- 3/ Le retour aux politiques nationales
- 4/ Financer les politiques climatiques au Sud
- 5/ Contenir le réchauffement en dessous de 2°C
- 6/ Maintenir du carbone en terre ?
- 7/ Réactiver le projet Yasuni-ITT
- 8/ Une nouvelle économie politique des changements climatiques
- 9/ La page à écrire Climat, environnement et développement
- Conclusion. Les chemins infinis de la décarbonisation
- Références bibliographiques
- Table des matières
- Dans la même collection (distribuée par L’Harmattan)