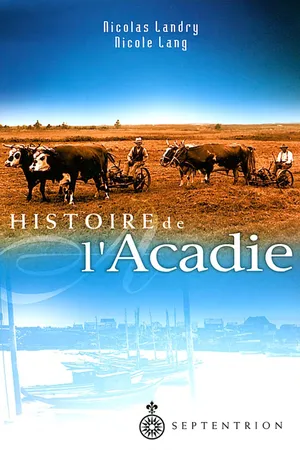![]()
CHAPITRE II
L’Acadie anglaise
1713-1763
Les problèmes de transition
La succession d’Espagne relance la guerre en Europe au début du XVIIIe siècle puisque le continent ne veut pas voir l’influence française s’étendre sur la monarchie espagnole. Il faut dire que, depuis 1679, Louis XIV tente de faire de la France la première nation d’Europe et poursuit ainsi une dangereuse politique d’annexion. Une coalition se forme en 1701 incluant l’Angleterre et les Provinces unies. En 1713, après plusieurs années de guerre, la défaite de la France épuisée de Louis XIV est confirmée par le traité d’Utrecht qui met fin à la guerre de la Succession d’Espagne. En Amérique, la baie d’Hudson, Terre-Neuve et l’Acadie sont cédées à la Grande-Bretagne alors que la France conserve l’île Royale, qui remplace Plaisance à titre de colonie de pêche et de commerce dans le golfe du Saint-Laurent. En France, les stratèges sont conscients de ce que signifie la perte de l’Acadie, ce territoire aux grandes vertus stratégiques. Ils s’entendent sur la planification à privilégier pour le développement de l’île Royale, c’est-à-dire peupler ce territoire qui reste français et l’équiper d’une infrastructure militaire pour protéger la Nouvelle-France.
Pour leur part, les Anglais doivent gouverner et administrer une colonie peuplée d’habitants d’origine française et de religion catholique. N’empêche que le traité d’Utrecht autorise les Acadiens et les Acadiennes à quitter le territoire occupé dans un délai d’un an « avec tous leurs effets mobiliers qu’ils pourront transporter où il leur plaira ». Une lettre de la reine Anne d’Angleterre au général Francis Nicholson adoucit les termes du traité qui, dorénavant, n’impose pas de limite de temps pour le départ et permet à ceux qui veulent devenir ses sujets de « retenir et posséder » leurs terres.
Au début, la France exerce de grandes pressions envers les Acadiens et les Acadiennes pour provoquer leur départ et orienter leur déplacement vers l’île Royale. Plusieurs s’y rendent en éclaireurs mais en reviennent déçus. Dans une lettre datée du 23 septembre 1713, le curé des Mines, le père Félix Pain, fait allusion aux « [...] terres brutes et nouvelles dont il faut arracher le bois qui est debout, sans avance ni secours ». Le sol rocailleux de l’île et ses brouillards fréquents n’impressionnent pas les hommes des marais. Les missionnaires sont toutefois prêts à coopérer avec les autorités françaises pour encourager la population acadienne à émigrer mais ils veulent plus que des promesses. La France doit leur fournir les ressources nécessaires, c’est-à-dire des vaisseaux et des fonds. Toutefois, contrairement à ce qu’elle offre aux habitants-pêcheurs de Plaisance, les Acadiens n’ont droit qu’à peu de compensation et peu de moyens pour faciliter les déplacements.
Malgré un contexte pas très attrayant, quelques Acadiens et Acadiennes amorcent un premier mouvement d’émigration. Certains posent des gestes positifs indiquant leur volonté de partir dont, entre autres, en construisant des barques ou en n’ensemençant pas leur terre au printemps de 1715, ne voulant pas prendre de retard. Mais ces Acadiens et Acadiennes exigent que la lettre de la reine Anne soit respectée, car ils ne veulent pas partir sans leurs biens, et veulent que la France leur fournisse les vivres nécessaires. Puisque les deux puissances ne répondent pas favorablement à leurs demandes, la plupart décident enfin de rester, espérant, comme ce fut le cas à plusieurs reprises dans le passé, que la France reprenne le contrôle du territoire.
Dès 1720, il est évident que la politique française visant à attirer la population acadienne vers l’île Royale est vouée à l’échec. Seulement 67 familles sur 500 environ émigrent dans cette colonie française entre 1713 et 1734. De même, peu d’Acadiens et d’Acadiennes se déplacent vers l’île Saint-Jean où la France encourage l’établissement d’une colonie agricole afin d’approvisionner l’île Royale. Les Acadiens et les Acadiennes hésitent à se rendre dans cette colonie qui a peu de prairies naturelles et qui est souvent victime de fléaux qui détruisent les récoltes. Ces facteurs ne sont pas de nature à les encourager à s’y installer et le recensement de l’île Saint-Jean de 1735 confirme que, cette année-là, seulement 162 des 432 colons — 35,5 % — sont d’origine acadienne.
Par contre, les autorités françaises comprennent vite qu’il vaut peut-être mieux que les Acadiens et les Acadiennes demeurent en Nouvelle-Écosse. S’ils quittent, ils ouvrent la porte à la colonisation anglaise, nuisant ainsi aux plans de reconquête du territoire. Du côté anglais, on remet aussi en question le projet de les laisser partir en imposant plusieurs obstacles tels retarder la décision jusqu’à échéance du délai officiel ou encore nuire à la construction des barques ainsi qu’à la vente des biens. Les Anglais agissent ainsi pour plusieurs raisons, sachant très bien que les Acadiens et les Acadiennes peuvent emmener avec eux le réseau des relations et du commerce indigène et aider l’île Royale à devenir une colonie très puissante. Bref, la Nouvelle-Écosse devient privée d’une population utile puisque la garnison ne peut pas subsister sans eux. On n’a pas encore de colons anglais pour occuper les terres et les cultiver. Jusqu’à la fin des années 1740, ce rapport de dépendance à l’égard des conquis oblige les Anglais à se montrer conciliants dans l’exercice de leur pouvoir.
Le politique
Les structures politiques
L’administration anglaise dispose de peu de moyens pour resserrer son contrôle sur la majorité acadienne puisque la métropole anglaise est alors en période de restrictions financières et n’accorde aucun crédit pour la colonisation de l’Acadie, devenue Nouvelle-Écosse. La garnison est restreinte et les fortifications sont à peine reconstruites. Les gouverneurs nommés au cours des années suivantes ne viennent que rarement dans la colonie et préfèrent déléguer leurs pouvoirs à des lieutenants-gouverneurs. Les militaires Vetch et Nicholson sont remplacés, en 1717, par le colonel Richard Philipps qui gouverne jusqu’à ce qu’il soit remplacé par Edward Cornwallis en mai 1749.
Le choix d’un nouveau gouverneur pour succéder à Vetch fait partie du projet du gouvernement britannique de régler le désordre dans lequel se trouvent les affaires de la Nouvelle-Écosse. Depuis la prise de Port-Royal en 1710 et la ratification du traité d’Utrecht en 1713, les Anglais n’exercent sur la Nouvelle-Écosse qu’un contrôle irrégulier et inefficace. Il faut maintenant un officier supérieur à Annapolis Royal pour que celui-ci gouverne la colonie, obtienne de la population acadienne un serment de fidélité et maintienne son autorité. Ces objectifs ne sont cependant pas atteints puisque, de 1719 — année de l’annonce officielle de sa nomination — à 1749, Philipps passe à peine cinq ans en Nouvelle-Écosse, soit de 1720 à 1723 et de 1729 à 1731. Les Acadiens doivent donc négocier avec ses principaux subordonnés : le capitaine John Doucett (1717-1726), le major Lawrence Armstrong (1725-1739) et le major Paul Mascarène (1740-1749).
Deux types de gouvernements se succèdent en Acadie anglaise. De 1713 à 1720, un gouvernement de type militaire, ne comprenant aucun civil, règne sur la colonie. Les décisions sont prises par un conseil composé de militaires et les cas de justice sont soumis à un tribunal militaire. En 1720, on instaure une structure civile calquée, en grande partie, sur le modèle des autres colonies anglaises. Un gouverneur, qui a les pleins pouvoirs civils et militaires, est assisté d’un lieutenant-gouverneur et d’un conseil de 12 membres. Une General Court est constituée et s’occupe, tous les trois mois, des affaires de justice. Bien qu’il ne peut être question d’une Chambre d’assemblée, puisque la population est majoritairement française, une sorte de représentation acadienne est cependant organisée, pour permettre aux Anglais de faire connaître les politiques adoptées. Chaque district acadien est représenté par un député — d’abord nommé puis élu chaque année. En 1748, par exemple, il y a 24 députés acadiens issus des quatre régions : Annapolis, Cobequid, les Mines et Beaubassin. Ceux-ci doivent voir au maintien de l’ordre, à l’entretien des routes, des ponts et des digues. De façon générale, cet appareil sert d’intermédiaire entre la population acadienne et le gouvernement anglais. Les députés informent leur population des mesures et des lois anglaises et font valoir leur position au gouvernement et aux Lords du commerce. Ces représentants acadiens sont choisis, la plupart du temps, parmi ceux qui jouissent d’une certaine influence dans leur milieu et sont convoqués périodiquement par les autorités anglaises pour toutes sortes de questions. Ce sont eux qui, à plusieurs reprises, refusent au nom de la population de prêter un serment d’allégeance inconditionnel à la Couronne britannique.
Le serment de fidélité
Dans leur correspondance officielle, les autorités anglaises font souvent allusion à l’esprit d’indépendance et à l’indiscipline du peuple acadien. En 1720, par exemple, le major Mascarène, parlant des habitants des Mines, affirme : « All the orders sent to them if not suiting to their humors, are scoffed and laughed at, and they put themselves upon the footing of obeying no Governement. »
Cela devient évident dans le débat entourant le serment d’allégeance à la Couronne britannique. La principale préoccupation de l’administration anglaise de l’époque est de faire des Acadiens de fidèles sujets britanniques en leur faisant prêter un serment d’allégeance. À cause des problèmes politiques et religieux que connut l’Angleterre, les souverains, à différentes époques de leur règne, surtout à leur accession au trône, exigent ce serment par lequel la population jure fidélité au monarque. Cette pratique est aussi courante dans d’autres pays européens où, avec le temps, le serment d’allégeance et le droit de propriété deviennent étroitement liés. Ainsi, seulement les fidèles sujets peuvent acquérir et exploiter une terre en Angleterre et les Britanniques veulent donc étendre cette pratique à la Nouvelle-Écosse.
Le commandant Vetch, de 1710 à 1713, tente de faire prêter le serment d’allégeance à la Couronne britannique. Les Acadiens refusent, préférant y inclure des réserves dont le respect de la religion et la neutralité dans tout conflit impliquant les Français et les Amérindiens. Cette attitude est perçue, par les autorités anglaises, comme étant incompatible avec les lois et les traditions britanniques. Pour eux, il est impensable qu’un sujet britannique refuse de prendre les armes pour soutenir les intérêts de l’empire et prétende se prévaloir en même temps de tous les droits et privilèges qui s’attachent au concept de loyauté. Tel est le dilemme que les administrateurs anglais ne peuvent pas résoudre pacifiquement, comme le confirment les échecs du lieutenant-gouverneur Armstrong et du gouverneur Philipps.
Armstrong réunit des Acadiens d’Annapolis au fort le 25 septembre 1726 pour leur présenter un serment de fidélité où on leur demande d’être des sujets sincères de l’Angleterre, de jurer « obéissance et soumission » et d’affirmer que « nul espoir d’obtenir l’absolution de la part du clergé » ne puisse leur faire renier leur serment. Les Acadiens demandent à être exemptés de tout service militaire et, après discussion, Armstrong accepte d’inscrire l’exemption en marge du document, espérant ainsi surmonter petit à petit la répulsion des Acadiens.
Il fait une nouvelle tentative pour imposer un serment sans conditions en septembre 1727. Cette fois les Acadiens d’Annapolis Royal y mettent plusieurs conditions, y compris l’exemption du service armé et la permission d’avoir plus de prêtres. Armstrong et le Conseil manifestent leur mécontentement en arrêtant quatre délégués acadiens, dont trois font un bref séjour en prison. Les chances d’Armstrong d’imposer un serment sans conditions sont anéanties en 1728 lorsqu’il traite brutalement le père René-Charles de Breslay. Armstrong croit que ce prêtre se mêle des questions civiles et, dans sa colère, ordonne le pillage de sa maison, l’obligeant à se réfugier dans la forêt. Cette façon d’agir offusque la population locale.
Philipps croit être parvenu à faire prêter le serment inconditi...