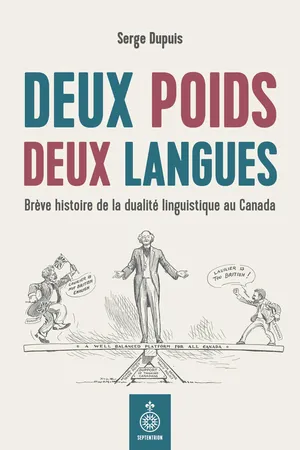![]()
LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES ET LES DÉBUTS DU BILINGUISME INSTITUTIONNEL (1969-1982)
L’adoption de la Loi sur les langues officielles
Étant donné qu’une part de l’élan de reconnaissance de la dualité nationale s’est dissipé, l’État fédéral priorise le plus large dénominateur commun restant. Si l’unilinguisme français, la territorialisation des « foyers en situation minoritaire », la dualité nationale et l’ingérence dans les compétences provinciales suscitent la controverse, le gouvernement choisit de s’en tenir à la question linguistique et aux droits individuels. Selon cette perspective, la pacification du différend anglais-français ne passe pas par une réforme du fédéralisme, mais par des lois et des règlements. La Loi sur les langues officielles, une promesse électorale du printemps 1968 qui a fourni au gouvernement libéral sa majorité, est déposée à la chambre des communes au printemps 1969.
Lors des débats sur le projet de loi sur les langues officielles, l’opposition exprime des craintes : le député progressiste-conservateur Jack McIntosh de Swift Current (Saskatchewan) estime que le bilinguisme officiel pourrait fracturer « the dream of one nation, with one citizenship and one nationality » et porter préjudice aux fonctionnaires et à d’autres travailleurs, dont les chauffeurs et les portiers, servant les institutions fédérales ; le créditiste René Matte est d’avis que le bilinguisme ne changera pas le fait que l’anglais dominera toujours au Canada. Or, les partis d’opposition craignent de s’aliéner le vote francophone en votant contre, puis les créditistes et progressistes-conservateurs francophones espèrent qu’il y aura d’autres mesures pour mieux soutenir la dualité nationale. Seuls 16 députés progressistes-conservateurs, dont 15 des Prairies, votent contre le projet de loi.
Adoptée le 7 juillet 1969, puis entrée en vigueur deux mois plus tard, la Loi sur les langues officielles comprend 39 articles, dont les suivants :
Article 2 : L’anglais et le français sont les langues officielles du Canada pour tout ce qui relève du Parlement et du gouvernement du Canada ; elles ont un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. […]
Article 13 (1) : Un district bilingue créé en vertu de la présente loi est une subdivision administrative délimitée par référence aux limites de l’une, de plusieurs ou de l’ensemble des subdivisions administratives suivantes : un district de recensement créé en conformité de la Loi sur la statistique, un district municipal ou scolaire, une circonscription ou région électorale fédérale ou provinciale.
(2) Une subdivision visée au paragraphe (1) peut constituer un district bilingue ou être incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d’un district bilingue, si
a) les deux langues officielles sont les langues maternelles parlées par des résidents de la subdivision ; et si
b) au moins dix pour cent de l’ensemble des résidents de la subdivision parlent une langue maternelle qui est la langue officielle de la minorité linguistique dans la subdivision.
(3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le nombre des personnes appartenant à la minorité linguistique, dans une subdivision visée au paragraphe (1), est inférieur au pourcentage requis en vertu du paragraphe (2), la subdivision peut constituer un district bilingue si, avant le 7 septembre 1969, les services des ministères, départements et organismes du gouvernement du Canada étaient couramment mis à la disposition des résidents de la subdivision dans les deux langues officielles.
(4) Aucune modification des limites d’un district bilingue créé en vertu de la présente loi ne sera faite à moins que ce district, en cas de réalisation de la modification proposée, ne continue à satisfaire aux exigences du présent article relatives à la constitution de districts bilingues en vertu de la présente loi.
(5) Aucune proclamation créant un district bilingue ou modifiant ses limites ne sera émise en vertu de la présente loi avant que le gouverneur en conseil n’ait reçu du Conseil consultatif des districts bilingues, nommé comme l’indique l’article 14, un rapport énonçant ses constatations et conclusions, et notamment, le cas échéant, les recommandations y afférentes, ni pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt d’un exemplaire du rapport devant le Parlement en conformité de l’article 17.
(6) Une proclamation créant un district bilingue ou modifiant ses limites prendra effet, pour ce district, dans les douze mois de l’émission de la proclamation, à la date fixée dans cette dernière. […]
Article 19 (1) : Est institué un poste de commissaire des langues officielles pour le Canada, dont le titulaire est ci-après appelé Commissaire.
(2) Le Commissaire est nommé par commission sous le grand sceau, après approbation de la nomination par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(3) Sous toutes réserves prévues par le présent article, le Commissaire est nommé pour un mandat de sept ans, pendant lequel il reste en fonction tant qu’il en est digne ; il peut, à tout moment, faire l’objet d’une révocation par le gouverneur en conseil, sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(4) Le mandat du Commissaire est renouvelable pour des périodes d’au plus sept ans chacune.
(5) Le mandat du Commissaire expire lorsque son titulaire atteint l’âge de soixante-cinq ans, mais le Commissaire demeure en fonction jusqu’à la nomination de son successeur, nonobstant l’expiration de son mandat. […]
Les autres articles décrivent les variations temporaires pouvant être apportées au bilinguisme institutionnel fédéral (articles 3 à 7), les devoirs des ministères et autres instances gouvernementales en matière de langues officielles (articles 9 à 11), les modalités de mise en place de districts bilingues fédéraux (articles 12 à 18), les rôles, pouvoirs et contraintes du commissaire aux langues officielles (articles 19 à 35), la définition de quelques notions, dont la « langue maternelle » et l’« institution du parlement » (articles 35 à 38), et l’adoption progressive de la loi en fonction des modalités de nomination et d’avancement du personnel dans la fonction publique fédérale (article 39).
Selon un sondage du Canadian Institute of Public Opinion, la moitié des répondants de langue anglaise s’opposent à la loi. Certains opposants participent à la formation de la Single Canada League ; d’autres envoient des lettres à leur journal local et au premier ministre. Dans leur esprit, la loi est une énième transgression de la tradition britannique, une atteinte à l’unité fédérale, une dépense inutile ou une forme de discrimination à l’avancement socioprofessionnel des anglophones. En contrepartie, d’autres journaux et intellectuels du Canada anglophone se montrent plus ...