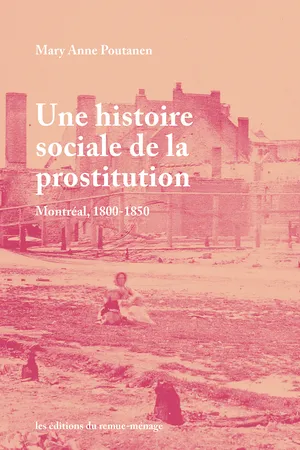![]()
DEUXIÈME PARTIE
ENTRE LOI ET COUTUME:
LA RÉGULATION
DE LA PROSTITUTION
![]()
Chapitre 4
Faire appel à la justice
Plaignants, accusés, lois
sur la prostitution et procédures judiciaires
Introduction
Par une froide journée d’hiver, début janvier 1840, John King et sa femme Mary Blay se rendirent au Bureau de la paix, situé dans le palais de justice, pour porter plainte devant le magistrat de police Pierre-Édouard Leclère au sujet des femmes et des hommes qui se rassemblaient à la maison de prostitution de leur voisine Fanny O’Brian, rue Saint-Ignace. À leur avis, cette bande de dévergondés se rassemblait «pour le contentement de leur appétit charnel», ce qui troublait la paix publique presque toutes les nuits. Afin d’engager des poursuites contre quelqu’un qui tenait une maison de débauche, il fallait que deux personnes ou plus en informent par écrit un juge de paix. Lorsque le greffier de la paix inscrivit le récit des événements présenté par King et Blay, il rédigea un document juridique – en l’occurrence une déposition – en y intégrant des éléments de leur description du problème ainsi que certains des termes qu’ils avaient réellement employés. Dans le cas d’une maison de désordre, il incombait au juge de paix d’évaluer la plainte et de déterminer s’il fallait lancer un mandat d’arrestation pour amener les accusés devant lui afin qu’ils répondent à l’accusation. Au cours de la descente qui suivit la dénonciation de King et Blay, la police arrêta cinq femmes: Fanny O’Brian (épouse de John Haines), ses filles Euphrosine et Emelia Haines, Jane Bells (épouse de Peter Montgomery) et Elizabeth Montgomery (veuve de Strong Bains). La plainte de King et Blay entraîna une série d’interactions juridiques entre différentes parties: magistrats, greffiers, connétables et membres du personnel carcéral, tous acteurs du système de justice criminelle, les plaignants King et Blay et, enfin, les défenderesses: O’Brian et ses deux filles, ainsi que Bells et Montgomery. Il en découla aussi une série de documents juridiques qui décrivaient ces différentes interactions.
La poursuite en justice de John King et Mary Blay contre le bordel d’O’Brian permet de penser que la population possédait une certaine connaissance du système de justice criminelle, de ses buts et de ses pratiques, et qu’elle consentait à s’engager dans un processus pouvant ultimement entraîner certaines dépenses. Des historiens britanniques ont remarqué cette familiarité des citadins avec le système judiciaire. Au sujet des Londoniens du XVIIIe siècle, Jennine Hurl-Eamon affirme: «il aurait été difficile de se déplacer dans les rues de Londres sans recevoir un genre d’éducation informelle sur les rouages du système de justice criminelle». Le savoir populaire au sujet du système judiciaire et son utilisation par les gens du peuple mettent en évidence ce que Shannon McSheffrey a montré concernant l’Angleterre de la fin du Moyen Âge: la loi était alors un instrument que les classes populaires utilisaient à leurs propres fins. Pareillement, Peter King, dans son étude sur le vol simple en Angleterre, entre 1740 et 1820, démontre que les plaignants exerçaient de larges pouvoirs discrétionnaires dans leurs poursuites en justice contre des malfaiteurs. Pour Andrew T. Harris, historien de la police, l’exercice de ces pouvoirs discrétionnaires par les classes populaires en dit long sur leur évaluation fluctuante de ce qui constituait un comportement criminel. King et Blay avaient probablement examiné plusieurs objectifs et plusieurs issues possibles à leur démarche avant de se présenter au Bureau de la paix pour déposer leur plainte devant Pierre-Édouard Leclère. En intentant cette poursuite privée – qui entraîna la descente de police –, King et Blay faisaient savoir à O’Brian, à ses filles et à ses autres complices que les voisins désapprouvaient les activités qui se tenaient dans leur maison. King et Blay auraient pu s’adresser à la police, voire au grand jury, pour dénoncer leurs voisines, mais ils ont plutôt choisi de porter plainte eux-mêmes. E.P. Thompson voit dans ces actions l’indication d’une économie morale dans laquelle le droit légitime des classes populaires à défendre les habitudes traditionnelles d’une collectivité se fondait sur un consensus au sujet des normes et des responsabilités sociales, ainsi que des obligations économiques de ses divers membres.
Le magistrat aurait pu décider que leur grief n’avait aucun fondement et le rejeter catégoriquement. Il ne l’a pas fait. King et Blay auraient pu interrompre le processus judiciaire à tout moment, pendant que leur plainte cheminait lentement dans le système: il leur aurait suffi de ne pas se présenter en cour pour témoigner. Au contraire, ils ont poursuivi l’affaire jusqu’à ce que le jury rende un verdict. La plupart des plaignants n’étaient pas prêts à s’engager dans le système judiciaire aussi loin que King et Blay l’ont fait. En général, les frais avant procès reliés au dépôt d’une plainte étaient appréciables sans être exorbitants. En outre, comme l’explique Donald Fyson au sujet des cas impliquant des maisons de désordre dans la ville de Québec, à compter de 1830, la cour absorbait de plus en plus ces frais. À Montréal, King et Blay ont peut-être – ou pas – payé les frais préliminaires de 12 shillings et 6 pence, ce qui représentait une semaine de salaire pour un ouvrier non spécialisé, comme l’a calculé Fyson. Pour l’accusation, nos plaignants ont peut-être – ou pas – dû verser une somme additionnelle de 1 £, 2 shillings et 6 pence, plus 2 £ pour autres frais. Les plaignants qui décidaient de renoncer à la procédure pouvaient recourir à de nombreux moyens légaux et illégaux, le plus courant étant de ne pas comparaître en cour, ce que faisaient bon nombre d’entre eux.
Pour ce qui est de la prostitution de rue, les habitants de Montréal pouvaient porter plainte devant un juge de paix. Le plus souvent, c’est un agent de la paix qui déposait la plainte: il appréhendait la prostituée de rue, la conduisait au poste de police, à la maison du guet ou à la prison et faisait ensuite sa déposition sous serment devant un magistrat. Habituellement, l’arrestation était à la fois immédiate et publique. Pour reprendre la description que donne Donald Fyson des arrestations ordinaires, la prostituée de rue subissait l’acte public, peut-être humiliant pour certaines, d’être conduite à travers la ville par un connétable, «en général un homme d’expérience et donc bien connu de la population». Lorsque le connétable Richard Hart croisa par hasard Marie Trémoulie, prostituée de rue qui par son comportement troublait la paix et la tranquillité des personnes fréquentant le marché Neuf, il l’arrêta. Hart escorta Trémoulie jusqu’au Bureau de police et s’adressa à un greffier pour faire rédiger la déposition requise, avant que la femme soit amenée devant le juge de paix. Dans ce document, Hart décrivit Trémoulie comme «une débauchée désœuvrée, en tant que telle une prostituée publique dépourvue de tout moyen de subsistance». Celles qui ne pouvaient pas marcher jusqu’au poste de police y étaient conduites par d’autres moyens, comme lorsque le policier John Prénouveau arrêta Angélique Bourdeau près de l’ancienne place du Marché. Estimant qu’elle était trop ivre pour l’accompagner à pied, il fit le nécessaire pour la faire transporter en charrette jusqu’à la maison de correction.
Les ambiguïtés que contenaient les lois sur la prostitution, leur application et les pratiques habituelles concernant la poursuite des personnes qui vendaient des services sexuels constituent le sujet du présent chapitre. L’examen des interactions entre la loi et les coutumes ou les pratiques locales, et la façon dont les citadins pouvaient avoir maille à partir avec la justice criminelle ordinaire nous permettent de comprendre les effets des lois et des coutumes sur la vie quotidienne des citoyens. Cette perspective expose aussi les méthodes judiciaires qui criminalisaient les femmes à Montréal au début du XIXe siècle. Les lois reliées à la prostitution avaient plusieurs significations pour les hommes et les femmes de classes sociales différentes, elles servaient des fins différentes – et parfois concurrentes – de celles que les législateurs avaient eues à l’esprit. Les Montréalais qui avaient recours au système de justice criminelle pour dénoncer des tenancières et tenanciers de bordel et des prostituées de rue le faisaient pour de multiples raisons; l’écho de leurs voix résonne encore dans les documents judiciaires résultant de leurs démarches. Il est incontestable que le système de justice criminelle était patriarcal. Il pouvait néanmoins, par moments, faire preuve de souplesse. Lorsque l’économie morale était attaquée et qu’elle minait la capacité de la collectivité à surveiller et à discipliner ses membres réfractaires, l’administration publique locale – incarnée par les agents de la paix – assumait un rôle plus important dans la régulation des maisons de désordre et des femmes déréglées. Au cours de la période étudiée, les connétables – ou policiers – et les hommes du guet qui agissaient à titre de plaignants dans la majorité des affaires impliquant des femmes déréglées ont déposé de plus en plus de plaintes impliquant des maisons de désordre.
Le présent chapitre débute par une analyse des lois s’appliquant à la prostitution, de leur évolution durant la période et de l’impact qu’elles ont eu sur les travailleuses du sexe. J’explore ensuite les caractéristiques démographiques des plaignantes et plaignants, j’expose de façon précise le processus par lequel on portait plainte, ainsi que les responsabilités des plaignantes et plaignants lorsqu’ils décidaient de poursuivre à titre privé des femmes déréglées et des tenancières ou tenanciers de maisons de désordre. Le présent chapitre se penche aussi sur les diverses façons dont les citadins utilisaient ces lois qui encadraient le dépôt et le traitement des plaintes pour favoriser leurs intérêts immédiats. Enfin, la quête de justice des personnes plaignantes entraînait différentes conséquences pour les défendeurs et défenderesses dans les causes où les magistrats décidaient que les plaintes étaient fondées. Dans la dernière section du chapitre, est explorée une de ces conséquences – la détention provisoire.
Les lois sur la prostitution
Au Bas-Canada, comme ailleurs, la prostitution était considérée comme une infraction principalement lorsque des prostituées en maison ou des prostituées de rue importunaient des piétons, des voisins ou d’autres personnes, ou qu’elles troublaient la paix du roi. L’historien britannique Tony Henderson a avancé qu’à Londres, au XVIIIe siècle et au début du XIXe, les juges de paix espéraient contenir le vice en considérant la prostitution comme une violation de la paix publique: «leurs attributions se fondaient surtout sur l’idée selon laquelle plusieurs infractions sexuelles, dont la prostitution et ses activités connexes, étaient des atteintes à l’ordre public qu’il était de leur devoir de prévenir». À Montréal, pour juger les femmes vendant des services sexuels, les juges de paix et les magistrats s’appuyaient sur des ouvrages importés d’Angleterre et en particulier sur les Commentaries on the Laws of England de sir William Blackstone, et sur l’ouvrage de Richard Burn, The Justice of the Peace and Parish Officer, dont les nombreuses éditions étaient abondamment consultées; ces livres établissaient des lignes directrices pour le travail des hommes de loi dans l’enceinte des tribunaux. En 1789, à Québec, le greffier de la paix et protonotaire Joseph-François Perrault a traduit en français des parties du livre de Burn.
Le droit criminel britannique avait été introduit au Québec en 1763, à la suite de la conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne, et adapté à la situation coloniale, comme nous le rappelle l’historien du droit Jim Phillips: «le rôle joué par le droit et les institutions juridiques en différents temps et lieux était fondamentalement déterminé par les conditions matérielles, sociales et intellectuelles locales». Par conséquent, le droit reflétait la façon dont une collectivité, quoique du point de vue de son élite masculine, considérait certains problèmes particuliers ainsi que les recours envisageables pour les résoudre. Dans le cas des règlements ayant trait à la prostitution de rue, les juges de paix de Montréal avaient la responsabilité de les rédiger, mais aussi de les réviser afin de les adapter à l’évolution de la situation locale. Au début du XIXe siècle, par exemple, les notables de Montréal ont réclamé de meilleures méthodes pour maintenir l’ordre dans la société, ce qui a entraîné l’ajustement minutieux des règlements de police s’appliquant au vagabondage, en vertu desquels les prostituées de rue étaient arrêtées. La définition juridique du vagabondage engloba graduellement un nombre croissant de comportements et fut même élargie dans l’ordonnance de 1838, ce qui donna aux connétables, policiers et hommes du guet de la ville une vaste marge de manœuvre dans leur application des articles de loi portant sur le vagabondage.
Les historiens québécois considèrent habituellement les rébellions de 1837 et 1838 comme un point tournant dans la législation comme dans le maintien de l’ordre. Lorsque la crise politique associée à l’insurrection armée a donné lieu à la suspension du gouvernement démocratique et à son remplacement par un Conseil spécial composé de membres de l’élite du Bas-Canada loyaux envers la Grande-Bretagne et nommés par le gouverneur en personne, ce conseil mit en œuvre des changements, dont ceux concernant la prostitution, qui avaient été discutés et débattus bien avant 1837. Au cours de son bref mandat, le Conseil spécial réorganisa le service de police de Montréal et reformula plusieurs lois, dont certaines touchaient directement la prostitution de rue. L’ordonnance portant sur les individus que l’on pouvait considérer comme vagabonds eut de nettes répercussions sur l’application même de la loi, mais ses résultats furent éphémères. En raison de contraintes budgétaires et du nombre restreint d’agents de police disponibles pour réguler l’espace public, le nombre d’arrestations commença à fléchir vers 1841. Il serait cependant trompeur de soutenir que les décisions du Conseil spécial eurent peu de conséquences: ce conseil a exercé, comme l’a affirmé Brian Young, un rôle crucial dans le remodelage de l’État et des structures institutionnelles, mettant au goût du jour les vieilles idéologies et relations héritées de l’ère préindustrielle.
Les maisons de désordre
Dans le cadre du système britannique de la common law adopté au Bas-Canada, tenir une maison de débauche ou une maison de désordre était considéré comme un délit passible de poursuites s’il causait une nuisance publique – «une atteinte au public, soit en faisant une chose qui tend à indisposer tous les sujets du roi, soit en négligeant de faire une chose que requiert le bien commun» ou qui «mettrait en péril la paix publique en rassemblant des personnes dissolues et débauchées, aussi en ce qui a trait à son apparente tendance à corrompre les manières des deux sexes». Le fait de troubler la paix publique ne suffisait pas en soi à faire inculper quelqu’un: il fallait que le trouble cause une nuisance aux sujets de Sa Majesté. Une lecture attentive de la déposition de John King et Mary Blay révèle la manière dont le greffier a utilisé des éléments particuliers de la loi pour accuser Fanny O’Brian et ses pensionnaires de tenir une maison de débauche. On y dit qu’elles ont troublé la paix publique et que des «personnes malfamées des deux sexes» s’assemblaient et se rencontraient dans la maison de prostitution d’O’Brian, où ces gens contentaient «leur appétit charnel». Le bordel représentait donc et sans équivoque une nuisance publique. L’obscénité à la vue de tous était également punissable par voie de mise en accusation en vertu de la common law, ce qui donnait lieu à une amende ou à un emprisonnement, ainsi qu’à toute autre peine jugée opportune par la cour. Selon Richard Burn, un engagement sous caution à bien se conduire pouvait être exigé pour des infractions qui ne troublaient pas directement la paix, mais qui pouvaient être qualifiées d’inconduites, ce qui pouvait s’appliquer aux personnes fréquentant ou tenant des maisons de débauche, «les souteneurs publics, les putains publiques», les noctambules, et les personnes qui étaient désœuvrées, mais qui affichaient une certaine aisance ou étaient bien vêtues. Un engagement à bien se conduire, assorti d’une caution, pouvait aussi être exigé d’un homme qui fréquentait assidûment les maisons de prostitution occupées par des femmes de mauvaise vie ou qui hébergeait de telles femmes chez lui. Cependant, pour accuser quelqu’un de fréquenter une maison de débauche, il fallait démontrer qu’il était conscient du caractère de la maison et qu’au-delà du simple soupçon l’établissement était bel et bien reconnu comme un bordel. Il fallait donc une preuve suffisante que la maison constituait bien un lieu de désordre et une nuisance depuis assez longtemps. On ne pouvait pas accuser une femme d’être une «débauchée», puisque la «simple sollicitation de chasteté» (demander à quelqu’un de forniquer ou de commettre l’adultère) n’était pas plus un acte criminel qu’un acte illégal. Les maisons de débauche étaient considérées comme des nuisances parce qu’elles favorisaient le désœuvrement et réunissaient des personnes indisciplinées. Comme le désœuvrement était vu comme un délit contre l’économie publique, toutes les personnes désœuvrées et déréglées ou vagabondes pouvaient être emprisonnées dans une maison de correction pour une période pouvant aller jusqu’à un mois.
Le fait que Fanny O’Brian était mariée à John Haines et qu’elle était vraisemblablement une feme coverte ne changeait rien à la manière dont le juge de paix et la cour la traitaient. En principe, les femmes mariées, en tant que femes covertes, étaient censées être subordonnées à leur mari, le mariage les ayant rendues invisibles aux yeux de la loi; en pratique, la cour tenait les deux époux également responsables de leurs activités criminelles – une pratique qui se fit de plus en plus courante avec le temps. L’étude de G.S. Rowe sur les femes covertes en Pennsylvanie révèle que dans les poursuites criminelles impliquant des couples mariés, les deux époux étaient traités de la même manière. Rowe attribue ce manque de compassion à l’égard des femmes mariées au fait qu’elles étaient jugées en fonction du paradigme de l’économie domestique: une femme était considérée comme intimement associée à son mari dans l’établissement et le maintien de l’économie familiale et, pour la même raison, tous deux étaient considérés comme liés l’un à l’autre dans l’accomplissement d’un crime. Au Québec, dans les causes portant sur la tenue d’une maison de désordre, la contribution de la femme au fonctionnement de la maisonnée et sa responsabilité à cet égard étaient vues comme cruciales: «une épouse peut être accusée au même titre que son mari et condamnée au pilori avec lui pour la tenue d’une maison de désordre; car il s’agit d’un crime à l’égard du gouvernement de la maison dont la femme détient une part principale et, de plus, il s’agit d’un crime habituellement considéré comme le fruit des intrigues de son sexe». Dans certaines circonstances, cependant, la situation de feme coverte jouait en faveur de la femme. En février 1841, la tenancière de bordel Marie Solomon, qui annonçait son établissement de la rue De La Gauchetière en tant que maison de pension, utilisa stratégiquement sa situation de feme coverte pour rejeter l’accusation du grand connétable Benjamin Delisle selon laquelle elle vendait de l’alcool sans permis. Solomon, qui en 1808 avait épousé le tonnelier George Glass, de Québec, en la cathédrale Christ Church de Montréal, se désignait comme la «veuve» Glass, jusqu’à ce que son avocat invoque pour sa défense qu’elle ne pouvait être accusée de vendre de l’alcool sans permis, «étant femme couverte». La cause fut rejetée après que les témoins Charles Laberge et Louis Malo se dirent convaincus que George Glass «était vivant et qu’ils n’avaient jamais entendu dire qu’il était mort». Le hasard voulut que la «veuve» Marie Solomon meure en 1842 et que le «défunt» George Glass lui survive 23 ans.
Dans son ordonnance de 1838, le Conseil spécial avait peu à dire au sujet des maisons mal famées. En vertu des nouvelles lois, cependant, la police pouvait arrêter avec mandat toute personne jugée débauchée, désœuvrée et déréglée, y compris celles qui se cachaient dans les bordels, les tavernes et les pensions. Ces personnes devaient être amenées devant un juge de paix pour répondre à l’accusation et fournir une «explication satisfaisante de leurs faits et gestes», sous peine d’être incarcérées en prison ou en maison de correction pour une période allant jusqu’à deux mois.
Les femmes déréglées
Les nouvelles ordonnances du Conseil spécial ont été les premières à faire explicitement référence aux prostituées publiques. Avant 1838, les lois sur la prostitution invoquées pour arrêter les prostituées de rue n’employaient pas le terme «prostitution» pour décrire le délit. Les vagabonds et vagabondes, suivant la loi anglaise formulée par sir William Blackstone, étaient définis comme «veillant la nuit et dormant le jour, et fréquentant leurs tavernes et cabarets habituels et les chemins environnants; et personne ne sait d’où ils viennent ni où ils vont». On divisait ces gens en trois catégories: fainéants et débauchés, gueux et vagabonds, et voyous incorrigibles. Si tous troublaient l’ordre public, chaque catégorie recevait des peines particulières: les fainéants et les débauchés devaient être enfermés dans une maison de correction pendant un mois, les gueux et les vagabonds étaient passibles du fouet et de l’emprisonnement pour une période de six mois, et les voyous incorrigibles étaient passibles du fouet et de l’emprisonnement pour une période de deux ans. Le désœuvrement et la débauche ou le vagabondage sans moyen visible de subsistance constituaient des mot...