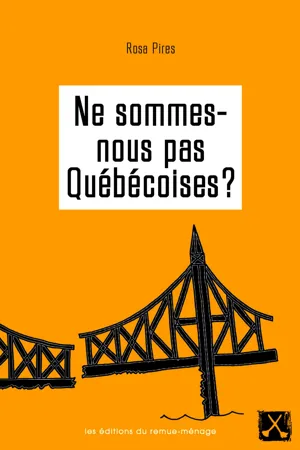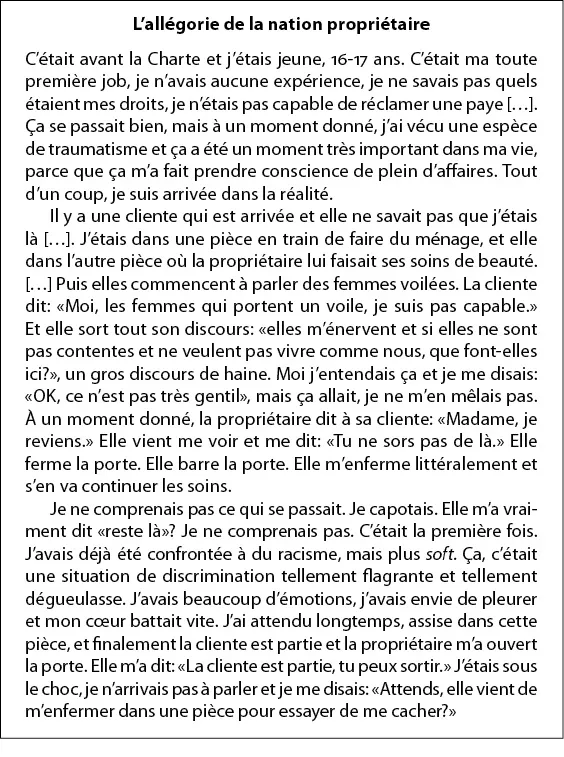![]()
CHAPITRE TROIS
Comment la majorité
opère une citoyenneté
racialisée
De nombreux rapports sociaux sont mis en œuvre par des catégories telles que femmes racisées, femmes des communautés ethnoculturelles, féministes et deuxième génération. Je m’attarderai ici à la construction d’une citoyenneté racialisée au sein des rapports sociaux de sexe et de race dans la société québécoise. Parce que les processus d’exclusion réitérés au quotidien affectent l’adhésion à une collectivité, il me semble impératif de mettre au jour les rapports de race/d’ethnie qui nourrissent les iniquités, sans quoi toute réflexion sur la cohésion sociale ou la solidarité serait vaine. Comme le dit si sagement Léa: «Le Québec n’est pas une société plus raciste que les autres, elle l’est tout simplement autant que n’importe quelle autre société, dont le Canada, qui lui-même est capable de racisme. Et de cela, il faut pouvoir parler.»
On a vu au cours des dernières années plusieurs tentatives afin de lancer un débat public sur la question; ainsi, en mai 2016, trois organismes, soit Québec inclusif, Amal-Québec et Montréal-Nord Républik, joignent leurs voix pour demander au gouvernement du Québec une commission sur le racisme systémique. À l’été 2018, on a également assisté à plusieurs débats autour de la représentation des personnes racisées dans la culture et les médias québécois, notamment à l’occasion de la création des pièces SLAV et Kanata, de Robert Lepage, ou encore des controverses autour du blackface.
Qu’ont à dire des féministes appartenant à une deuxième génération d’immigrantes au sujet des modes de production d’une citoyenneté racialisée? Sentent-elles que c’est la dimension raciale et ethnique qui les définit d’abord et avant tout? Croient-elles qu’il est légitime que des rapports de pouvoir maintiennent à la marge les minorités du Québec, alors que les Québécoises et Québécois dénoncent depuis la Révolution tranquille leur propre minorisation au sein du Canada?
Des féministes qui dérangent
Lorsqu’on leur demande quels groupes sont considérés comme représentant des «problèmes» au Québec présentement, les dix femmes interrogées nomment les Juifs hassidiques, les personnes noires, les Autochtones et les communautés musulmanes: «Présentement les personnes noires et la communauté musulmane sont vraiment les deux cibles, sans oublier les personnes autochtones», dit Nadja. Et Leïla fournit cette explication: «On trouve que leurs valeurs sont des valeurs irréconciliables avec celles de la majorité.» Puis, elle décrit longuement les stéréotypes sur les femmes noires et les femmes arabes véhiculés dans la société québécoise: «Ce sont des femmes qu’on ne dit pas belles et dont les caractéristiques se dessinent du côté du grotesque.» Angélique lui fait écho lorsqu’elle relate la difficulté à trouver un conjoint en tant que femme noire: les critères esthétiques et moraux ainsi que les normes sociales institués en fonction des femmes blanches pèsent autant sur Angélique que sur Leïla. Elles reçoivent cependant peu d’écoute lorsqu’elles tentent d’en parler avec des féministes de la majorité: «Elles ramènent ça sur le plan personnel […] et ne feront pas l’exercice de se mettre dans mes souliers.» Cette incompréhension est ressentie d’autant plus fortement lorsqu’elles vivent en région, comme ce fut le cas d’Angélique pendant plusieurs années. Dans un soupir à fendre le cœur, celle-ci s’exclame:
Ma peur c’est d’éclater en sanglots et de dire: mon Dieu, je me sens seule! Je suis quelqu’un de sensible, de profond et de bien. Je suis une chic fille, mais ce n’est pas facile comme femme noire. […] Mais pourquoi dois-je me sentir comme ça, alors qu’ici c’est ma nation?
Ces prises de conscience rappellent les propos cités par des femmes noires américaines dans le livre du Combahee River Collective. Mais ce sont justement leurs expériences douloureuses et leurs désillusions qui propulsent mes interlocutrices en quête d’un savoir féministe libérateur:
Avant je n’étais pas capable de mettre des mots… Le féminisme et l’intersectionnalité, qui pour moi demeurent encore un océan Pacifique à découvrir, ont mis des mots sur des sentiments que je n’étais pas capable d’admettre. C’est une libération qui fait mal, mais c’est une libération (Angélique).
Emblématique de l’oppression subie par les femmes musulmanes, surtout celles qui portent le voile, l’expérience sordide qu’a vécue l’une de mes interlocutrices portant le voile peut se lire comme une allégorie de l’objectification de la croyante musulmane par la nation propriétaire (voir l’encadré suivant). Alors qu’elle travaillait dans un salon d’esthétique, la propriétaire l’a enfermée dans une pièce pour éviter de déplaire à une cliente hostile aux femmes voilées.
Peu importe si la propriétaire enfreint toutes les règles de dignité humaine et du droit du travail, la femme qui porte le hijab doit demeurer cachée. La visibilité religieuse doit demeurer dans la sphère privée, car cela dérange la clientèle. Le droit au travail et la dignité humaine sont réservés à ceux et celles qui acceptent de cacher leur différence dans la sphère privée, et ce, dans une nation qui en principe est aussi la leur.
Dans ce salon, on a signifié à mon interlocutrice qu’elle devait se cacher pour ne pas susciter de critiques; pourtant, dans les divers débats où les femmes voilées s’engagent sur la place publique, les médias aspirent à ce qu’elles fassent la démonstration de leur émancipation «en tant que femmes voilées». D’autres fois, notamment dans des discussions sur la laïcité durant ses cours à l’université, on a fait comme si elle n’était pas là:
Dans les cours de féminisme, la question du voile revient tout le temps, c’est inévitable. Je trouvais ça particulier que les gens aient des discussions animées dans une classe à ce sujet – pas qu’ils devraient se censurer parce que je suis là, mais c’est comme si je n’étais pas là! […] Mettons qu’il y a une personne handicapée assise dans la classe et on dit: «Mais là, tu sais, les handicapés prennent trop de place!» C’est un peu bizarre, ce manque de délicatesse.
Toutefois, quand les médias font entendre la parole des femmes qui portent le voile, leurs opposantes leur dénient à leur tour toute autonomie en les accusant d’agir au nom d’un patriarcat islamique: «Les femmes arabes sont perçues comme étant responsables de leur propre misère, car “elles veulent vivre dans leur patriarcat”. Alors, qu’elles se démerdent!», dit Leïla – le terme «patriarcat» laissant supposer que les femmes musulmanes reçoivent passivement les diktats de l’oppression exercée sur elles. Ainsi, peu importe le choix que fait une femme voilée, celui de se taire ou de parler, on le lui reprochera.
Au sein du mouvement féministe, la parole engagée des musulmanes paraît subir le même sort que celle des Afro-Américaines. Ce n’est que tout récemment que le féminisme québécois a été interpellé à ce sujet: représente-t-il un sujet blanc qui exclut du Nous femmes les expériences et les préoccupations des femmes racisées? Les propos d’Angélique, de Tania, de Léa, de Nancy et de Nadja tendent à le confirmer: le sujet du féminisme québécois, dans le discours public et selon leurs expériences au sein des mouvements sociaux, est effectivement «blanc».
Tout au long des entretiens, j’ai constaté que la plupart de mes interlocutrices abordaient peu les oppressions ancrées dans les rapports sociaux de sexe, se concentrant davantage sur les oppressions reliées à l’ethnicité ou à la race. Pour Leïla, le choix est clair, comme en écho aux militantes afro-féministes affirmant que «les contraintes quotidiennes ne leur permettent pas de prendre le risque de lutter contre les deux à la fois [sexisme et racisme]»:
Ce n’est même pas que je ne veux pas lutter contre le sexisme, c’est que je ne peux pas. Par défaut, en tant que femme arabe et musulmane, je dois me concentrer sur d’autres questions, car de toute façon je suis renvoyée à cette case-là. Alors même si je voulais m’inscrire dans l’universel et lutter avec elles [les femmes de la majorité] sur les questions d’avortement, les questions de prostitution et les questions d’équité salariale […], je suis sûre que je serais bienvenue, mais ce qui me semble urgent aujourd’hui, ce sont les questions de discrimination, de racisme et d’islamophobie. Je ne suis plus capable de penser à l’intérieur de ce prisme-là [l’universel blanc]. Même si ce sont des questions importantes, ce n’est pas mon urgence personnelle.
Comme l’a souligné la sociologue Leïla Benhadjoudja, d’une part, les féministes musulmanes/islamiques sont sans cesse confrontées à l’idée que les croyances religieuses sont antinomiques avec la lutte contre le patriarcat et, d’autre part, elles sont toujours représentées en «victimes d’un islam misogyne». La notion de féminisme musulman apparaît à certaines féministes de la majorité comme une ruse permettant aux intégrismes religieux de porter atteinte à des valeurs considérées québécoises telles que l’égalité entre les sexes. L’existence même du féminisme musulman se voit quotidiennement remise en question, et le féminisme de ces femmes se trouve toujours en butte au soupçon.
Le corps des femmes musulmanes serait insoluble dans la nation:
Les gens ne vont pas dire «je veux apprendre l’arabe», mais ils aiment apprendre l’espagnol ou le portugais. Ça chantonne, c’est beau. Les femmes arabes et les femmes noires, on trouve qu’elles parlent fort ou qu’elles ne sentent pas bon. Les gens se moquent de leur accent. Ce sont de gros stéréotypes que je raconte là, mais c’est ce que j’entends, en toute transparence (Leïla).
La nation dispose du droit d’apprécier ou non une catégorie de citoyennes et de leur attribuer autant des défauts irrémédiables que des qualités innées particulières. Comme le révèle ce commentaire que reçoit souvent Nancy: «Nous, on aime ça l’immigration chinoise. Les Asiatiques travaillent fort quand ils arrivent au Québec. Les immigrants comme ça, on en prendrait beaucoup.» Si aujourd’hui l’immigration chinoise bénéficie de certains préjugés favorables, Nancy rappelle qu’au Canada, cela n’a pas toujours été le cas: l’immigration chinoise a en effet connu les pires discriminations, de la loi qui l’excluait en imposant une taxe d’entrée jusqu’aux travaux harassants sur les rails du Canadien Pacifique. Il en est de même pour les communautés juives et italiennes, qui à tour de rôle ont été perçues comme des communautés à problèmes. Nadja observe que les communautés juives et italiennes bénéficient maintenant de l’étiquette de «bons immigrants», «sans doute parce qu’elles sont ici depuis longtemps», dit-elle.
Mais qui sont les bons immigrants, les bonnes immigrantes? Rarissimes sont les personnes dans l’espace public québécois qui citent les Portugais.es comme ayant été un problème. L’immigration portugaise a en effet fourni une main-d’œuvre docile, dressée par le régime fasciste de Salazar, et a su se rendre transparente. Elle a pourtant défilé annuellement, avec ses chars allégoriques religieux, ses Vierge Marie et ses trompettes, rue Rachel à Montréal sans que personne ne crie au scandale. Tous les députés, libéraux et péquistes, sont venus flirter avec la communauté açorienne en faisant leur apparition au défilé du Saint-Esprit, entourés de jeunes filles vêtues pour l’occasion de blanc immaculé et de dentelle.
Mes interlocutrices repèrent facilement les hiérarchies créées dans la société québécoise, même si celle-ci constitue la catégorie «immigrantes» comme étant homogène: il y a tout de même des «bonnes» et des «mauvaises immigrantes», des catégories plus assimilables que d’autres à la nation.
Les Portugaises sont dans le paysage montréalais depuis si longtemps qu’on en a oublié leur présence. «Italiens, Portugais, Grecs, c’est toute la même affaire», «toute du bon monde»: j’ai souvent entendu ça. Je l’ai moi-même répété comme un perroquet. J’offrais volontiers quelques exemples des similarités entre ces cultures, situant les Portugais sur la Méditerranée, comme voisins de l’Espagne. Si vous avez vu le film Mystic Pizza, avec Julia Roberts, vous n’avez sans doute pas remarqué qu’elle interprète une Luso-Américaine de la deuxième génération issue d’une famille nombreuse açorienne. Dans cette pizzeria, la mamma aurait fourni la recette secrète de la pâte à pizza. En fait, les immigrantes portugaises ont plutôt mis sur pied des boulangeries et les immigrants portugais, des rôtisseries. Partout en Amérique du Nord, le tracé de l’immigration portugaise passe ...