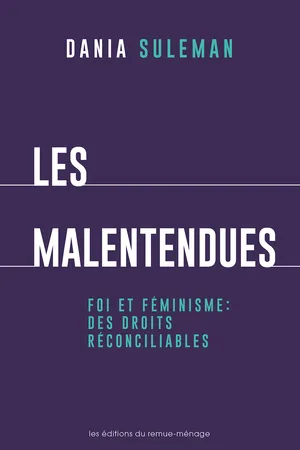![]()
Réconcilier «l’irréconciliable»
Les jugements que j’ai présentés montrent que les femmes formulent des requêtes différentes, qu’elles ne luttent pas pour une émancipation identique, mais bien pour leur liberté individuelle. Pour une liberté qui soit à l’image de leurs valeurs, de leurs croyances, de leur propre conception de l’égalité entre les hommes et les femmes. Elles revendiquent l’égalité, mais aussi le droit de parler pour elles-mêmes. Elles ne prétendent pas que leur point de vue rejoint celui de toutes les femmes. Pour certaines, il s’agit de revendiquer le droit au divorce religieux, pour d’autres, de témoigner à visage couvert. Ces femmes ont en commun de parler au «je», de parler de leur récit, de faits uniques à leur parcours. À ce sujet, les écrits de Chandra Talpade Mohanty, autrice de Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity, m’interpellent dans la mesure où ils parlent des luttes pour l’égalité des sexes à travers la pluralité des réalités.
Discuter des «femmes» au lieu des «Femmes» permet de saisir cette multiplicité. Le groupe «femmes» reconnaît la pluralité des réalités de la vie de celles qui subissent les effets différenciés du patriarcat, alors que le groupe «Femmes» suppose un vécu homogène. La désignation «femmes» ne prétend pas à une lutte féministe commune, universelle et singulière. Elle reconnaît l’ancrage culturel, social, politique, économique, religieux et historique des récits.
Cette perspective, portée par le féminisme postcolonial, permet de se défaire d’un féminisme blanc universaliste, d’un féminisme qui a tendance à trancher de manière catégorique et néfaste pour l’émancipation des femmes religieuses. Le féminisme postcolonial vise au contraire à permettre aux femmes de se réapproprier les termes de leurs propres luttes contre le patriarcat. Il cherche à redonner la parole aux femmes qui ont été aliénées par les discours féministes majoritaires, à exposer et à donner une tribune, un espace de narration, aux femmes qui ont jusqu’ici été des objets d’études. En cela, le féminisme postcolonial reconnaît le caractère multiple, complexe et parfois contradictoire des récits des femmes et celui de leurs luttes pour l’émancipation.
Ce cadre permet de légitimer et rendre visible le discours des femmes religieuses et pratiquantes qui revendiquent leur droit à la liberté de religion, simultanément avec leur droit à l’égalité. Pour cela, il faut apprendre à rendre justice aux différents regards, vécus et positionnements des femmes. Les reconnaître comme des voix légitimes qui tiennent à changer, à réformer et à critiquer les espaces qui leur sont attribués au sein de la religion. Reconnaître leur récit, leur capacité de choisir, leur agentivité, notamment derrière le port du voile ou tout autre symbole religieux.
Pour Michèle Vatz Laaroussi, docteure en psychologie interculturelle et professeure titulaire à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke, il existe chez les femmes occidentales une croyance implicite selon laquelle les femmes racialisées, migrantes, ont les mêmes besoins d’émancipation que les leurs.
Les femmes occidentales des sociétés dites démocratiques et évoluées auraient, par leurs luttes et au travers du mouvement féministe, atteint une indépendance et une émancipation non encore acquises par les femmes d’autres contextes socio-politiques. […] De ce fait, la tendance serait d’amener les femmes d’autres cultures à suivre les mêmes voies que les femmes des pays riches occidentaux pour acquérir leur émancipation.
Pour la journaliste Francine Pelletier, il s’agit de l’opposition féministes c. féministes. Les premières revendiquent un blueprint émancipateur pour toutes femmes, alors que les secondes demandent à personnaliser leur lutte contre le patriarcat. Pour la juriste Pascale Fournier, le féminisme colonialiste des premières se traduit par une structure de gouvernance qui réunit des féministes blanches, des néoconservateurs et des laïcistes cherchant à s’opposer au «barbarisme» des secondes. C’est un féminisme universel qui juge les expériences des femmes en fonction des valeurs et des objectifs qui lui sont propres. Pour Lyne Deschâtelets, cette opposition, en plus d’essentialiser les «opprimées» en fonction de leur sexe, fait abstraction de toute autre forme de discrimination fondée sur la race, l’appartenance sociale, religieuse, notamment.
On doute généralement de l’apport réel des femmes, et des féministes non blanches, au sein des religions. On suppose que leur action a peu d’incidence sur les institutions et les structures religieuses patriarcales. Or, cette lecture réductrice de l’implication des femmes au sein de la religion est une lecture patriarcale et paternaliste. La théologienne féministe juive Judith Plaskow souligne que le soupçon de nombreux intellectuels dans notre société laïque selon lequel quiconque s’intéresse à la religion est réactionnaire a servi à marginaliser et à délégitimer le travail des féministes au sein des religions. La confiance accordée aux féministes qui travaillent des espaces, des écrits, des institutions, des traditions historiquement patriarcales, autres que religieuses, ne s’étend pas aux femmes religieuses. C’est précisément notre rapport à l’agentivité de la femme qu’il est important de déconstruire. Dans cet esprit, je propose trois avenues de réconciliation, tirées de l’expérience portée par les femmes religieuses et pratiquantes.
Des récits d’empowerment
L’affaire R. v. N.S., dont il a été question au chapitre précédent, illustre bien l’importance que cet enjeu peut revêtir pour une femme religieuse. En effet, cette affaire illustre moins un conflit entre la liberté de religion et le droit à un procès équitable que le droit d’une femme à témoigner d’un traumatisme dans des conditions qui facilitent sa prise de parole et qui renforcent sa confiance. Étant donné les difficultés qu’implique la dénonciation d’une agression sexuelle, une femme devrait avoir accès à un espace alternatif, dans lequel dénoncer et témoigner contre son agresseur sans être contrainte par l’ensemble des règles propres au processus judiciaire normatif, et ce, qu’elle soit religieuse ou non.
La religion peut manifestement constituer une composante positive dans la vie d’une femme, notamment en facilitant l’expression de ses droits civiques. Elle peut être synonyme de bien-être, de confiance et d’autonomie individuelle. Selon une étude menée par Saba Rasheed Ali et collaboratrices à propos des femmes chrétiennes et musulmanes, omettre de considérer les aspects positifs que la religion peut avoir dans la vie des femmes revient à nier leur empowerment, leur pouvoir intérieur, leur conscience critique, leur confiance.
Plusieurs victimes d’actes sexuels ne sentent pas que le système de justice pénal leur offre l’espace dont elles ont besoin pour dénoncer. Pour N.S., le niqab lui permettait de dénoncer la violence qu’elle avait vécue – une des pires formes de violence commises envers les femmes. N.S. a mentionné à la Cour suprême que le fait de porter son niqab lui permettait en effet de trouver la confiance nécessaire pour témoigner et rendait plus confortable sa présence à la Cour. Sans lui, l’idée de dénoncer ses agresseurs était trop «vulnérabilisante». Si la Cour suprême avait vu les choses ainsi, cela aurait peut-être mené à un résultat différent quant au jugement de la majorité. À la place, N.S. a décidé d’abandonner sa poursuite, et ses agresseurs sont restés à l’abri de toute poursuite judiciaire au criminel.
Le Ontario Women’s Justice Network a émis ...