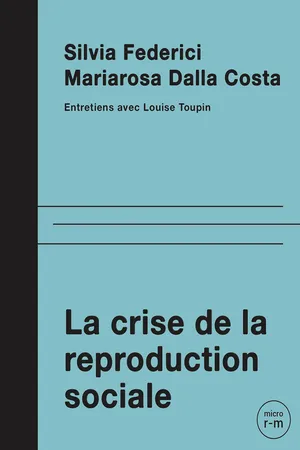
eBook - ePub
La crise de la reproduction sociale
Entretiens avec Louise Toupin
- 92 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
La crise de la reproduction sociale
Entretiens avec Louise Toupin
À propos de ce livre
Nées en Italie dans les années 1940, Silvia Federici et Mariarosa Dalla Costa sont des militantes pionnières et des intellectuelles féministes de premier plan. Dans ces entretiens avec Louise Toupin, elles reviennent sur le mouvement qu'elles ont cofondé en 1972, le Collectif féministe international, qui fut à l'origine d'une revendication radicale et controversée au sein du féminisme, celle de la rémunération du travail domestique. À partir de ce riche terreau, elles racontent comment s'est développée leur pensée au fil du temps, et formulent une critique intersectionnelle du capitalisme néolibéral, depuis la notion de crise de la reproduction sociale.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à La crise de la reproduction sociale par Mariarosa Dalla Costa,Silvia Federici,Louise Toupin en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences sociales et Féminisme et théorie féministe. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Mariarosa
Dalla Costa1
Mariarosa Dalla Costa est née à Treviso en Italie en 1943. Elle a étudié à l’Université de Padoue, est devenue docteure en droit en 1967, et professeure à l’Istituto di Scienze Politiche e Sociali. Elle est l’auteure du document fondateur de la perspective du salaire au travail ménager «Les femmes et la subversion sociale», publié en 1972 avec un texte de Selma James, «La place des femmes», sous le titre Le pouvoir des femmes et la subversion sociale. Le livre a été traduit depuis en plusieurs langues.
Louise Toupin — Potere femminile a eu, dans le monde féministe occidental, un impact international dès sa publication en 1972 en italien, puis en anglais, et sa traduction consécutive en plusieurs langues, forçant, dans les années qui ont suivi, les féministes de toutes tendances à se situer par rapport à l’analyse qui y était soutenue. Avant de plonger dans le contenu même du livre, on pourrait d’abord préciser le contexte de sa production en Italie, et la «mouvance» idéologique et politique dans laquelle il a mûri. En un mot, il serait intéressant de s’attarder sur la conjoncture intellectuelle et politique au sein de laquelle ce livre-manifeste fut écrit.
Je voudrais d’abord savoir quelle a pu être l’influence du courant opéraïste italien, appelé aussi «courant de l’autonomie», dans votre pensée. Ensuite, quelle a été l’influence d’essais féministes italiens ou étrangers sur le travail ménager qui avaient commencé à paraître en 1969-1970. Commençons par le courant de l’«autonomie», ou opéraïste, courant intellectuel et politique de la gauche extraparlementaire italienne.
Il me semble important de traiter d’abord de la place de ce courant dans votre œuvre, car je crois qu’on ne peut comprendre toute l’originalité des découvertes théoriques qui y sont contenues qu’à la lumière des nouveautés qui ont d’abord été initiées par ce courant et qui vous ont permis de pousser plus loin l’analyse et, finalement, de situer la place des femmes dans la société capitaliste. Je pense à des thèmes importants de ce courant, comme par exemple le refus du travail, la place accordée à la subjectivité ouvrière et à la capacité de subversion du sujet, à sa capacité révolutionnaire.
Certains auteurs, comme Yann Moulier, traducteur de Mario Tronti, qui a introduit le courant opéraïste italien en France, vous classent, à titre d’auteure de Le pouvoir des femmes et la subversion sociale, comme faisant partie de «ceux qui ont contribué de façon significative» au courant opéraïste italien. Un autre, Harry Cleaver, a parlé de Selma James et de vous-même comme étant des théoriciennes féministes du «marxisme autonomiste2». Que dites-vous de cette appréciation, et comment l’interprétez-vous? Et êtes-vous d’accord pour dire que Le pouvoir des femmes et la subversion sociale a mûri dans ce terreau intellectuel?
Mariarosa Dalla Costa — Ma formation politique débute avec l’opéraïsme. Je ne dirais pas avec l’«autonomie», qui est une définition qui a été formulée des années plus tard quand j’étais déjà active à l’intérieur du mouvement féministe, dans le mouvement pour le salaire au travail ménager. Ce mouvement représentera, dès son début, et pendant toute sa vie, une réalité complètement indépendante de ces réseaux masculins, incluant ceux dits de l’«autonomie». Mais je peux comprendre que notre discours soit désigné aujourd’hui, comme le fait Harry Cleaver, et plus tard Nick Witheford, comme étant un «marxisme autonomiste». En effet, en partant d’une matrice marxiste, on avait choisi le point de vue de l’autonomie du mouvement de classe, d’une classe comme nous l’avions redéfinie, et qui incluait le travail de production et de reproduction de la force de travail par les femmes.
Les origines du discours de l’autonomie de classe se trouvent cependant dans l’œuvre de C.L.R. James et de Raya Dunayewskaya, de même que dans le groupe autour de la revue Socialisme ou barbarie en France, et dont les représentants majeurs étaient Cornelius Castoriadis et Claude Lefort3.
En fait, on reconnaît dans notre travail, le mien et celui de mes copines des groupes du salaire au travail ménager, l’importance d’avoir découvert l’autre pôle de l’accumulation capitaliste, l’autre voie par laquelle elle passe, c’est-à-dire la production et la reproduction de la force de travail. En d’autres termes, d’avoir découvert la maison à côté de l’usine. On a découvert que la classe était formée non seulement des salarié·e·s, mais en même temps des non-salarié·e·s.
Tenir compte de cela, aujourd’hui, est fondamental pour comprendre le «commandement capitaliste4» qui, du monde de la production, se déploie dans des formes toujours plus «étranglantes» et létales sur le monde de la reproduction, pour comprendre en fait le rapport entre économie formelle et informelle, pour comprendre le rapport entre économie monétaire et non monétaire, pour comprendre le rapport premier monde/tiers-monde (pour m’exprimer par une synthèse conventionnelle), pour comprendre les luttes qui, issues du monde de la reproduction globale, tendent à briser ce commandement, pour affirmer d’autres critères dans le rapport avec la production, avec la nature et avec la vie.
Donc, pour répondre à ta question: oui, Le pouvoir des femmes et la subversion sociale a mûri dans ce «terreau» intellectuel opéraïste. Mais je me souviens qu’il y avait une certaine résistance, plutôt dure, du côté des intellectuels opéraïstes, à accepter d’élargir le concept de classe ouvrière pour y inclure, comme nous le soutenions au début des années 1970, les ménagères. Les théoriciens de l’opéraïsme insistaient pour dire que ce que nous appelions production, c’est-à-dire production et reproduction de la force de travail, appartenait plutôt à la sphère de la circulation, telle que décrite par Marx dans Le capital. Quand, plus tard, ils ont parlé d’«ouvrier social», ils faisaient plutôt allusion à différentes figures de travailleurs dans le contexte de la décentralisation productive. Ils avaient reconnu dans la nouvelle composition politique de classe au début des années 1970, les luttes des étudiants et leur revendication d’un présalaire, la lutte des techniciens, etc. Mais il y avait, de la part de ces hommes intellectuels de la gauche extraparlementaire, une grande sous-évaluation de ce qu’était le travail ménager. Je pense que leur idée à ce sujet consistait à dire que le problème des femmes serait résolu avec davantage de crèches et une meilleure organisation de ces dernières. Ils croyaient plus aux solutions en termes de services. Ils ont toujours sous-estimé l’ampleur réelle du travail de reproduction et l’impact du manque d’argent pour les femmes qui étaient assignées à ce travail.
Et je crois aussi que la plupart des théoriciens de cette mouvance, après avoir lu Le pouvoir des femmes, et après en être arrivés à se faire une vague idée de la question, n’ont jamais lu les autres documents que nous avons produits depuis, dans les groupes du salaire au travail ménager. Et je pense que, même aujourd’hui, ils en ignorent toujours l’existence. Avec pour conséquence qu’ils continuent à ignorer à peu près tout de cette question du travail de reproduction et tout le débat politique à son propos avancé par les féministes.
Cependant, ces dernières années, alors que nous en sommes à une nouvelle étape dans notre analyse, plusieurs de nos plus récents travaux, de même que la partie la plus importante de nos travaux d’alors, sont maintenant traduits en anglais, en espagnol et en japonais, et le seront sous peu dans d’autres langues. Cela nous permet de continuer à contribuer, de meilleure manière, espérons-nous, à un débat politique international qui doit faire face à des questions toujours plus urgentes et dramatiques.
Parlons maintenant des lectures féministes proprement dites qui ont alimenté Le pouvoir des femmes et la subversion sociale. Par exemple, quels essais marquants du féminisme occidental sur le travail ménager avaient commencé à circuler en Italie au tournant de la décennie 1970 et en aviez-vous pris connaissance au moment d’écrire Le pouvoir des femmes? Je pense ici entre autres à celui de Margaret Benston en 1969, The Political Economy of Women’s Liberation; celui de Christine Dupont (Delphy) la même année, L’ennemi principal; ou encore, toujours en 1970, ceux de Betsy Warrior et de Pat Mainardi, respectivement Housework: Slavery or Labour of Love et The Politics of Housework. Bref, quelles œuvres féministes vous avaient le plus marquée à cette époque?
Je ne connaissais aucune des œuvres féministes étrangères que tu mentionnes. Il y avait des travaux italiens sur la «condition de la femme» en général et sur l’avortement. Je pense que le temps était mûr, en Italie et à l’étranger, pour l’explosion de cette question, et surtout parce que nous nous trouvions à une période de grande rébellion sociale et de luttes de toutes sortes. À cette époque, j’étais complètement absorbée par la militance politique et concentrée sur des analyses italiennes liées à mon travail politique. Mon discours féministe a été le fruit de l’explosion de la contradiction que je vivais alors dans mon activité politique.
Cette activité commençait à quatre heures le matin, je devais me lever pour aller distribuer des tracts devant des grandes usines, et ça continuait ainsi le soir, les samedis, les dimanches. Si on ne se réfère pas à ce type de vie, il est difficile de comprendre pourquoi je n’avais pas lu, à cette époque, tel et tel livre sur la question des femmes qui commençaient à être publiés. Aussi, j’étais italienne. Je ne connaissais pas, sinon de manière très vague, l’anglais, que j’ai par la suite appris tout au cours de ma militance féministe en allant entre autres en Amérique. Je connaissais le français, mais je n’avais pas de rapports particulièrement significatifs ou très fréquents avec la France.
Avez-vous d’abord été marxiste, puis féministe, ou bien avez-vous été féministe d’abord et marxiste ensuite? Dans le fond, je voudrais savoir si c’est le marxisme qui a fait de vous une féministe, ou si c’est votre expérience de vie qui a fait de vous d’abord une féministe, qui a ensuite découvert le marxisme.
Fondamentalement, j’avais été poussée à l’activité militante et à la découverte de l’«usine» par un idéal de justice. Je voulais comprendre d’où provenait le mal du monde, l’origine du mécanisme, en un sens l’omphalos5, du système des rapports sociaux. Et c’est ainsi que je rencontrai le marxisme dans sa version opéraïste. Ce marxisme fut en soi une grande découverte qui me donna, et qui continue à me donner, des instruments essentiels de compréhension du monde.
La militance politique fut l’autre grande expérience de ma vie, parce qu’elle donne à la pensée les coordonnées de l’action. Mais, dans cette militance, j’expérimentais, comme beaucoup d’autres femmes des groupes de la gauche extraparlementaire du tournant des années 1970, la contradiction de ne pas sentir représentée, comprise, ma condition de femme, ni par cette action militante, ni par cette pensée marxiste. Or, c’est cela que je cherchais.
Ma rencontre avec Selma James fut fondamentale à cet égard. Mais nos chemins se séparèrent bientôt pour toujours en raison d’une conception différente de l’action politique. Pour répondre à ta question: oui je fus d’abord marxiste, et ensuite féministe; je dois aussi ajouter que ma recherche d’un parcours différent de celui auquel la société du temps s’attendait d’une jeune femme était évidemment commencée longtemps auparavant.
Le pouvoir des femmes et la subversion sociale rassemble trois textes, le vôtre: «Les femmes et la subversion sociale», écrit au début de 1971, un autre de Selma James, écrit en 1953, et un texte sur «La mate...
Table des matières
- Mariarosa Dalla Costa
- Silvia Federici