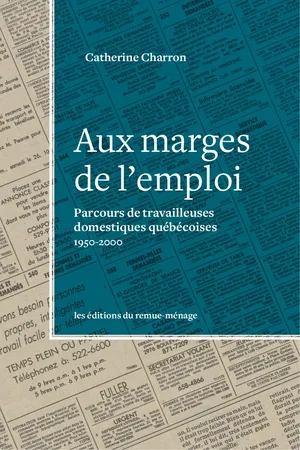Chapitre 1
Raconter le travail domestique
La méthode de l’enquête orale s’est imposée dès le début du processus de recherche, d’abord en raison de l’absence ou de la rareté des sources existantes pour rendre compte de l’expérience historique des travailleuses domestiques. Il fallait donc puiser dans les récits des informations que la recherche n’avait pas encore documentées : les différentes formes de travail domestique rémunéré, leur inscription dans les trajectoires professionnelles des femmes, les liens entre le secteur domestique et d’autres univers de travail sont quelques pistes encore largement inexplorées en histoire et également en sociologie. Néanmoins, au-delà de la justification par la négative (absence d’alternative), le potentiel heuristique de cette approche s’est rapidement révélé. L’importance de l’apport des récits de travail domestique, dans toutes leurs dimensions, est devenue une évidence à mesure que se précisait le projet.
Les fondements historiques de la pratique de l’histoire orale sont ancrés dans une approche holistique et « réaliste »1 du récit. La conception du témoin comme sujet unifié de sa propre vie a cependant été sérieusement ébranlée par les critiques post-structuralistes. Joan W. Scott nous rappelle de ne pas tomber dans le piège de faire de l’expérience une « évidence »2, ou de prendre cette expérience comme fondement d’une identité fixe et ahistorique :
Ce ne sont pas les individus qui sont exposés à l’expérience, ce sont les sujets qui se constituent à travers elle. Dans cette définition, l’expérience devient non pas ce sur quoi s’appuie notre explication, non pas la preuve incontestable (car observée ou ressentie) qui ancre ce que nous savons ; elle devient plutôt ce que nous cherchons à comprendre, ce sur quoi du savoir sera produit3.
Quel peut être l’apport du récit de vie dans la quête du savoir historique, à partir du moment où l’on considère que l’expérience n’est plus synonyme d’une connaissance vécue du passé ? La mise en mots comme telle devient « le site de l’Histoire en action4 », ou, dans la perspective de Farge, une trace de l’histoire, qui porte en elle les significations du langage et de l’expérience incorporée5. La parole témoigne d’un passé vécu, réel et concret, mais dont la mémoire est déposée sous forme de sédiments chez la personne qui raconte sa vie. Un événement n’est jamais vécu qu’une seule fois, il est revécu à chaque moment de l’existence : l’expérience d’un instant devient avec le temps une multitude d’expériences dont chaque récit fait une synthèse unique. Considérant le langage comme un intermédiaire dynamique, il importe cependant de ne pas écorcher le récit pour en faire un artefact désincarné. Dans l’analyse, la tension entre le travail de composition et de décomposition6 des récits demeure constante.
Les réflexions exposées dans ce premier chapitre accompagnent l’ensemble de la démonstration proposée dans cet ouvrage. Ce chapitre est divisé en deux parties. Dans un premier temps, il s’agira de décrire en détail le processus d’enquête : critères et stratégies de recrutement, déroulement des entretiens, profil des participantes et éléments de représentativité du corpus. Dans un deuxième temps, quelques avenues réflexives seront explorées quant à la nature des récits de vie comme sources en histoire, à l’importance et à la difficulté de prendre en compte les dimensions relationnelle et intersubjective de l’enquête ainsi qu’aux défis interprétatifs spécifiques auxquels cette recherche a donné lieu.
L’enquête
Le recrutement des participantes
Les critères de recrutement ont été établis au départ en fonction des paramètres de l’enquête, dont l’objectif était de documenter les trajectoires professionnelles dans le secteur domestique à Québec et le rapport au travail des femmes au cours de la période charnière qu’ont été les dernières décennies du XXe siècle. Le premier critère exclusif de recrutement — outre le sexe des participantes7 — a donc été l’âge, afin de recueillir des récits qui s’étendaient sur au moins trois décennies. Les trente femmes recrutées sont donc toutes nées avant 1960.
Le second critère exclusif était celui d’avoir exercé une forme de travail domestique rémunéré à Québec. La description des types d’expériences de travail domestique rémunéré a été présentée de façon très large dans les appels à participation pour cette enquête. L’objectif était de ne pas restreindre l’éventail des possibles dans cet univers de travail vaste et encore peu familier. Ce choix de ratisser large, quitte à resserrer les critères par la suite, s’est révélé une bonne décision. L’idée de départ était de documenter les expériences de travail domestique de type ménager et non de soins. Malgré l’enchevêtrement des différentes tâches associées au travail domestique, le choix a été fait de se concentrer sur des pratiques souvent négligées dans l’historiographie, soit l’entretien ménager hors contexte de dépendance. Dès les premières entrevues, cependant, l’impossibilité d’opérer une telle distinction — du moins à l’étape de la collecte et de la description des trajectoires — entre des expériences inextricablement liées est apparue clairement. Il a donc été nécessaire de modifier cet a priori — qui par précaution n’avait pas été imposé dans l’appel à participation — tout en gardant à l’esprit qu’il faudrait réfléchir à cet amalgame à l’étape de l’interprétation.
Dans un premier temps, des annonces ont été placées dans différents lieux : feuillets paroissiaux, babillards dans des lieux publics (centres communautaires et de loisirs, églises, commerces, organismes et associations telles que cercles de fermières, clubs FADOQ [anciennement Fédération de l’Âge d’or du Québec]), groupes de femmes, organismes d’aide à l’emploi). De plus, des contacts ont été établis avec quelques entreprises d’économie sociale en aide domestique (EESAD) de la région de Québec ; les responsables de deux EESAD ont accepté de faire circuler l’appel de participation parmi leurs employées. D’autres démarches n’ont donné aucun résultat : des lettres et des courriels ont été envoyés aux responsables de nombreuses entreprises privées de services domestiques, des annonces ont été placées dans des résidences privées pour personnes âgées autonomes offrant des services d’aide domestique, et la responsable d’une agence de placement d’aides familiales a accepté de faire connaître le projet de recherche. Également, des courriels non personnalisés ont été envoyés à des femmes proposant des services domestiques sur Internet, les invitant à participer à l’enquête.
La première phase de recrutement a attiré presque exclusivement des femmes âgées de moins de 70 ans. À cette étape, il a été envisagé de centrer la recherche et l’analyse sur la seule génération de femmes nées entre 1940 et 1960, quitte à faire des microcomparaisons entre différentes cohortes. Après quelques entrevues avec des femmes plus âgées, dont les trajectoires présentaient des spécificités potentiellement typiques, le choix de rejoindre davantage de femmes âgées pour intégrer une dimension comparative a cependant été fait. La deuxième phase de recrutement s’est donc déroulée dans d’autres lieux, essentiellement dans les centres de jour de la ville de Québec (établissements du réseau public de la santé destinés à une clientèle âgée), par l’intermédiaire des professionnelles responsables. Les femmes recrutées dans les centres de jour étaient âgées de plus de 70 ans. Les deux participantes les plus âgées de l’échantillon (nées en 1914 et en 1917) ont été recrutées par le biais de contacts personnels.
Trois entrevues réalisées ont dû être rejetées, parce qu’elles ne répondaient pas à un critère de base, soit celui d’avoir travaillé à Québec, un constat qui s’est avéré dans les trois cas au cours de l’entrevue. Dans deux de ces cas, les femmes interviewées étaient issues de l’immigration (pays d’Europe centrale et de l’Est). Le rejet de ces entrevues a réduit à néant la diversité du corpus — à 100 % québécois francophone — en ce qui concerne l’origine ethnoculturelle et le statut d’immigration. La dimension raciale du rapport de pouvoir au cœur du service domestique, la place des emplois domestiques dans les parcours d’immigration et le rapport des femmes racisées ou immigrantes au marché du travail de Québec sont des questions importantes qui n’ont par conséquent pas été abordées dans le cadre de cette enquête. En cours de recrutement, il aurait été possible, bien sûr, de cibler directement certains lieux afin de constituer au sein du corpus un échantillon de femmes racisées. Cette approche aurait nécessité l’élaboration d’un cadre d’analyse pouvant rendre justice aux parcours migratoires et/ou aux vécus d’oppression spécifiques de ces femmes. Ce choix n’a pas été fait, afin de concentrer l’analyse sur un ensemble relativement homogène de trajectoires (celles de femmes d’origine franco-québécoise) et d’éviter le piège de la « femme racisée alibi ». Même si l’intersection des rapports sociaux de sexe et de race constitue un angle d’analyse fondamental pour comprendre l’évolution du service domestique au Québec, cette absence n’invalide pas la démonstration proposée dans cette recherche, qui porte donc exclusivement sur les trajectoires et marchés du travail domestique propres à la communauté ethnolinguistique et culturelle canadienne-française. En outre, la ville de Québec comme lieu d’investigation permet ce choix méthodologique. Il aurait évidemment été plus difficile de justifier une telle option pour une ville comme Montréal, où l’ampleur du mouvement de diversification ethnoculturelle au cours de la dernière moitié du XXe siècle et son impact sur la configuration des marchés de l’emploi est sans commune mesure ailleurs au Québec. Tous ces aspects seront abordés dans le prochain chapitre.
Forces et limites de l’échantillon
La variété des modes de recrutement constitue une force du corpus. Cependant, elle est aussi révélatrice de la difficulté d’attirer des participantes, et ce, en grande partie en raison de la nature du travail domestique rémunéré : cette activité non professionnalisée, informelle, nichée dans les interstices du parcours professionnel des femmes de milieu populaire, et nébuleuse fortement liée aux formes non rémunérées de travail familial, ne constitue par un « monde social » au sens que lui donne Bertaux8. En conséquence, il n’y a ni communauté qui se forme autour de ces activités, ni réseau de type professionnel. Chaque emploi s’inscrit dans une relation personnalisée et duelle, donc non collectivisée. C’est particulièrement vrai pour les arrangements de gré à gré, qui constituent la majorité des cas documentés dans cette recherche, mais cette personnalisation caractérise à différents degrés l’ensemble des formes d’emplois plus ou moins institutionnalisées dans le secteur domestique. Ces questions seront abordées plus longuement dans les chapitres qui suivent ; pour l’instant, ce constat permet d’expliquer en partie les difficultés de recrutement rencontrées.
Il n’y a donc pas eu d’effet « boule de neige »9, d’une part, parce que l’univers des boulots domestiques est un espace éclaté (multilocal) et non réseauté. D’autre part, le peu de valeur sociale accordée au travail domestique, et la difficulté à voir l’intérêt scientifique d’un tel objet ont certainement eu un effet important sur les réticences que de nombreuses femmes ont pu avoir face à cette recherche. Non seulement « faire des ménages » n’est en rien glorieux dans notre société, il s’agit souvent pour ces femmes d’épisodes associés à des difficultés économiques dont le souvenir peut être pénible. Surtout, ce sont des activités « dont on n’a rien à dire ». Cette hypothèse s’est trouvée renforcée au cours de l’enquête, comme nous le verrons plus loin. Bien que presque toutes les personnes rencontrées connaissaient d’autres femmes (parentes ou autres) dont le profil correspondait aux critères de recherche, seulement trois d’entre elles ont recommandé d’autres participantes, et la chaîne s’est arrêtée là.
Les critères de variété, de différentialité et de variation10 ont été pris en compte dans la constitution de l’échantillon. Premièrement, grâce à l’appel de participation qui définissait de façon très large l’objet d’étude, il a été possible de récolter des témoignages sur un grand nombre de situations d’emplois différentes, tant sur le plan des « métiers » (entretien ménager, garde d’enfants, soins aux personnes âgées), que des statuts d’emploi (de gré à gré, via différents types d’intermédiaires employeurs, ponctuels et réguliers, formels et informels, de jour ou résident). Cet impressionnant éventail de formes d’emploi répertoriées est dû aux parcours des femmes rencontrées, qui ont pour la plupart cumulé plusieurs expériences différentes de travail domestique rémunéré au cours de leur vie. Quant au critère de variation, qui repose sur les profils biographiques des participantes, il a aussi fait l’objet d’une attention particulière. Le fait d’avoir puisé à plusieurs sources a favorisé cette diversité, surtout remarquable parmi les femmes les plus jeunes de l’échantillon, qui sont mariées, divorcées, célibataires, d’origine urbaine ou rurale11, avec ou sans enfants, diplômées et non diplômées.
Cependant, malgré la variété des modes de recrutement, certaines spécificités de l’échantillon peuvent être identifiées. Ainsi, les femmes plus âgées de l’échantillon ont presque toutes été recrutées par l’entremise des centres de jour de la ville de Québec. Ce mode plus concentré de recrutement ne semble pas avoir induit un biais significatif dans l’échantillon ; il est peu probable que les personnes qui fréquentent les centres de jour, outre leur localisation dans des quartiers populaires (Saint-Roch et Limoilou)12, épousent un profil spécifique en regard du parcours professionnel. De même, le fait que huit des neuf femmes nées avant 1940 soient veuves n’est pas en soi une distorsion de la réalité démographique, puisque celles-ci appartiennent à la génération de femmes dont le taux de nuptialité a été le plus important dans l’histoire ...