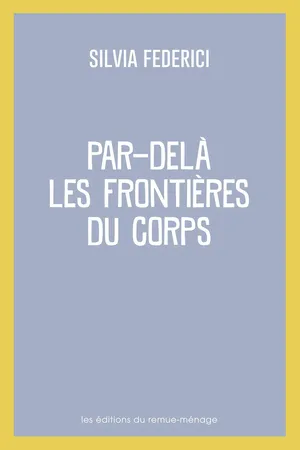![]()
PREMIÈRE PARTIE
![]()
I.
LE CORPS, LE CAPITALISME
ET LA REPRODUCTION
DE LA FORCE DE TRAVAIL
Il ne fait aucun doute que le corps est aujourd’hui au cœur de discours scientifiques, politiques et disciplinaires qui ont entrepris, dans leur domaine respectif, de redéfinir ses principales qualités et capacités. Le corps se trouve sur notre route, dès qu’il est question de changement social ou individuel. C’est un sphinx à interroger, un objet à modifier. Cependant, il est presque impossible d’avoir du corps une conception cohérente en se basant sur les théories les plus en vue dans l’arène intellectuelle et politique. D’un côté, les formes les plus extrêmes de déterminisme biologique affirment que l’ADN est le deus absconditus (le dieu caché) qui détermine soi-disant, dans notre dos, notre vie physiologique et psychologique. De l’autre, les théories (féministes, trans) nous incitent à disqualifier tous les facteurs «biologiques» en faveur d’une représentation performative ou textuelle du corps, valorisant ainsi notre assimilation grandissante au monde des machines, désormais constitutives de notre être.
On peut identifier, cependant, une tendance commune: l’absence de point de vue cohérent qui permette de désigner les forces sociales affectant nos corps. Avec une obsession quasi religieuse, les biologistes restreignent l’activité signifiante au monde moléculaire microscopique, dont la constitution est aussi mystérieuse que le péché originel. Pour les biologistes, nous venons au monde soit déjà souillé·es, prédestiné·es à la maladie, soit voué·es à lui échapper, car tout est dans l’ADN, cadeau déposé par un dieu inconnu . Quant aux théories discursives / performatives, elles sont muettes sur ce qui fonde socialement les idées et les pratiques du corps. Elles craignent peut-être de tout réduire à une cause unique et de méconnaître la multiplicité des manières dont nos corps portent nos identités et se rapportent au pouvoir. Elles ont aussi cette tendance, qui vient de Foucault, à identifier les «effets» du pouvoir sur les corps plutôt que leur source. Cependant, sans une reconstitution du champ de forces où se meuvent nos corps, ceux-ci sont condamnés à rester inintelligibles, impuissants à déjouer les conceptions mystificatrices qui sous-tendent ces opérations de pouvoir. Comment, par exemple, songer à «dépasser la binarité» sans comprendre sa nécessité économique, politique et sociale dans des systèmes d’exploitation particuliers, sans comprendre les luttes qui contribuent à transformer incessamment les identités de genre? Comment parler de «performance» du genre, de la race et de l’âge sans reconnaître la contrainte qu’exercent certaines formes spécifiques d’exploitation et de punition?
Il nous faut identifier les politiques adverses, les relations de pouvoir qui configurent nos corps et repenser les luttes qui se sont opposées à la «norme» si nous voulons élaborer des stratégies transformatrices.
C’est le travail que j’ai entrepris dans Caliban et la sorcière: j’analyse comment la transition au capitalisme a changé le concept de «corps», son traitement , et affirme que l’un des principaux projets du capitalisme a été la transformation de nos corps en machine de travail. En conséquence, la nécessité de maximiser l’exploitation du travail vivant, qui passait aussi par la création de formes de travail et de répression différenciées, a été le facteur qui a, plus qu’aucun autre, dessiné les contours du corps dans la société capitaliste. Cette approche se distingue à dessein de celle de Foucault , qui ancre les régimes disciplinaires auxquels a été soumis le corps au début de l’ère moderne dans les opérations d’un «Pouvoir» métaphysique, peu défini quant à ses buts et ses motivations .
À rebours de Foucault, j’affirme aussi qu’il n’existe pas une histoire du corps, mais une pluralité d’histoires, qui renvoient à des modalités spécifiques de mécanisation du corps, car les hiérarchies raciales, sexuelles et générationnelles construites par le capitalisme dès sa naissance invalident tout point de vue universel. Ainsi, l’histoire du «corps» est un entrelacs de récits – histoire de celles et ceux qu’on a réduit·es en esclavage, colonisé·es, transformé·es en travailleur·euses salarié·es ou en femmes au foyer non payées, histoire des enfants – qui garde à l’esprit que ces classifications sont mutuellement exclusives et que «l’imbrication des systèmes de domination» auxquels nous sommes soumis·es produit toujours une réalité nouvelle . J’ajouterais que nous avons besoin d’une histoire du capitalisme écrite du point de vue du monde animal, et, bien sûr, de la terre, des mers, des forêts.
Examiner «le corps» à partir de tous ces points de vue permet de saisir l’ampleur de la guerre que le capitalisme a menée contre les êtres humains et la «nature» et ouvre à l’élaboration de stratégies capables de mettre fin à une telle destruction. Parler de guerre ne signifie pas partir d’une totalité originaire ou affirmer une vision idéalisée de la «nature». C’est plutôt souligner l’état d’urgence où nous vivons actuellement et questionner, à une époque qui nous vend l’idée que refaire nos corps est une voie vers plus de puissance et d’autodétermination, les bénéfices que nous sommes censé·es tirer de ces politiques et technologies qui ne sont jamais contrôlées à la base. En réalité, avant de célébrer notre transformation en cyborgs, encore faudrait-il réfléchir aux conséquences sociales de ce processus de mécanisation déjà à l’œuvre . Il est bien naïf d’imaginer que notre symbiose avec les machines nous donne plus de puissance, d’ignorer les contraintes que les technologies font peser sur nos vies, leur usage croissant comme moyen de contrôle social et le coût écologique de leur production .
Le capitalisme a traité nos corps comme des machines de travail parce qu’il est le système social qui a systématiquement fait du travail humain l’essence de l’accumulation de la richesse, le système qui a le plus besoin de maximiser son exploitation. Il a œuvré dans plusieurs directions: en créant des formes de travail plus intenses et plus monotones, en mettant en place des régimes disciplinaires et des institutions multiples, en s’imposant par la terreur et par des rituels dégradants. Prenons l’exemple parlant de ce qui a été imposé au XVIIe siècle aux détenus des asiles hollandais: ils étaient forcés de fendre du bois de la manière la plus rétrograde et éreintante qui soit, dans le seul but de leur inculquer l’obéissance aux ordres et de faire éprouver à chaque atome de leur corps l’impuissance et la soumission .
Citons un autre exemple de rituel dégradant employé pour briser la résistance populaire: les rituels imposés au début du XXe siècle par des médecins en Afrique du Sud sur des Africains destinés à travailler dans des mines d’or . Lors de «tests de résistance à la chaleur», de «procédures de sélection», on ordonnait aux travailleurs africains de se déshabiller, de se mettre en rang, de déplacer des cailloux à la pelle avant de les soumettre à des examens radio, de les mesurer, les peser, sous le regard du personnel médical souvent invisible pour leurs cobayes . L’exercice était censé démontrer aux Africains le caractère souverain de l’industrie minière et initier les futurs travailleurs à une vie où ils seraient «privés de toute dignité humaine ».
À la même époque, en Europe et aux États-Unis, les études tayloristes sur le temps et le mouvement – plus tard utilisées pour organiser les chaînes de montage – ont fait de la mécanisation du corps des travailleur·euses un projet scientifique, à travers la fragmentation et l’autonomisation des tâches, l’élimination de toute décision du procès de travail et, surtout, l’évacuation de tout facteur cognitif ou émotionnel . L’automatisme, c’est aussi des vies de travail, de répétition infinie, vies «sans issue », de 9 h à 17 h à l’usine ou au bureau, des vies où même la pause des vacances devient mécanique et routinière, car elle est obligatoire et prévisible.
Foucault avait raison, cependant, l’«hypothèse répressive» ne suffit pas à expliquer toute l’histoire du corps sous le capitalisme . Le développement de capacités nouvelles est aussi important que la répression. Dans ses Principles of Economics (Principes d’économie politique) en 1890, l’économiste britannique Alfred Marshall célébrait les facultés que la discipline capitaliste avait développées chez la main-d’œuvre industrielle, affirmant que peu de populations dans le monde étaient aussi compétentes que les ouvriers européens de l’époque. Il encensait l’«habileté générale» des ouvriers de l’industrie: ils étaient capables de travailler sans discontinuer, pendant des heures, à la même tâche, de se souvenir de tout, d’avoir en tête la tâche exécutée par l’ouvrier suivant, de travailler avec des outils sans les casser, sans perdre de temps, de manier des machines coûteuses avec précaution, de tenir la cadence dans l’accomplissement des travaux les plus monotones. Marshall affirmait que ceci témoignait de facultés uniques, ce qui démontrait, selon lui, que même le travail qui paraissait non qualifié était en réalité hautement qualifié .
Marshall ne nous dit rien sur la manière dont ont été créés des ouvriers si merveilleux, dignes de machines. Il ne nous dit rien de la séparation des paysans de leurs terres, de la terreur, des tortures pour l’exemple, des exécutions. Les vagabonds se faisaient couper les oreilles. Les prostituées subissaient des «simulacres de noyade», le même type de torture que la CIA et les forces spéciales états-uniennes ont utilisé sur ceux qu’on accuse de «terrorisme». Attachées à une chaise, les femmes suspectes de comportement déplacé étaient plongées dans des bassins et des rivières jusqu’à la suffocation. Les esclaves étaient fouetté·es au point que leur chair se décollait de leurs os, ils étaient brûlé·es, mutilé·es, laissé·es sous un soleil écrasant où leurs corps se putréfiaient.
Comme je l’ai montré dans Caliban et la sorcière, avec le développement du capitalisme, il n’y a pas seulement eu enclosure des communaux, mais aussi du corps. Néanmoins, ce processus s’est appliqué différemment aux hommes et aux femmes, à ceux et celles qu’on destinait à l’esclavage et à ceux et celles qui devaient être soumis·es à d’autres formes de travail contraint, travail salarié inclus.
Les femmes, au cours du développement capitaliste, ont subi un double processus de mécanisation. Soumises à la discipline du travail, payé et non payé, dans les plantations, les usines et au foyer, elles ont également été expropriées de leur corps, transformées en objet sexuel et en machine reproductrice.
L’accumulation capitaliste (comme le dit Marx) est accumulation d’ouvriers . Ceci est le moteur expliquant la traite négrière, le développement du système de plantation et – comme je l’ai montré – la chasse aux sorcières qui a eu lieu en Europe et dans le «Nouveau Monde ». Au cours de cette persécution des «sorcières», les femmes qui entendaient contrôler leur capacité de reproduction ont été dénoncées comme ennemies des enfants et ont subi une diabolisation qui dure jusqu’à nos jours. Au XIXe siècle, par exemple, la presse états-unienne parlait des sataniques avocates de l’«amour libre», comme Victoria Woodhull, et les représentait avec des cornes de diable . Aujourd’hui encore, dans plusieurs États, les femmes qui vont avorter en clinique doivent traverser une foule compacte de «pro-vie» qui les traite de «tueuses d’enfants», les poursuit, grâce à un arrêté de la Cour suprême , jusqu’à la porte des cliniques.
La tentative de réduire le corps des femmes à des machines n’a été nulle part aussi systématique, brutale et normalisée que pendant l’esclavage. Les femmes esclaves, exposées à des agressions sexuelles constantes, à la souffrance terrible de voir leurs enfants vendus, après que l’Angleterre a interdit le commerce d’esclaves en 1807, ont été forcées de procréer pour alimenter l’industrie esclavagiste, dont le centre était la Virginie . «Tandis que les métiers à tisser du Lancashire aspiraient tout le coton que le Sud pouvait produire», écrivent Ned et Constance Sublette, «le ventre des femmes n’était pas seulement une source de richesse pour le Sud, mais aussi le fournisseur d’un système global incluant l’apport de l’agriculture, l’industrie esclavagiste et l’expansion financière ». Thomas Jefferson donna, après bien des atermoiements, son accord au Congrès à la limitation de l’importation d’esclaves d’Afrique afin de protéger le prix des esclaves auxquel·les donneraient naissance les femmes des plantations de Virginie. «Je considère, écrivait-il, qu’une femme qui enfante tous les deux ans est plus profitable que n’importe quel homme à la ferme. Ce qu’elle produit s’ajoute au capital, tandis que le travail masculin disparaît dans la consommation .»
Bien que dans l’histoire américaine, les esclaves aient été le seul groupe de femmes directement forcé d’avoir des enfants, la criminalisation de l’avortement, la procréation non désirée, et le contrôle étatique du corps des femmes ont été institutionnalisés. L’arrivée de la pilule contraceptive n’a pas changé radicalement la situat...