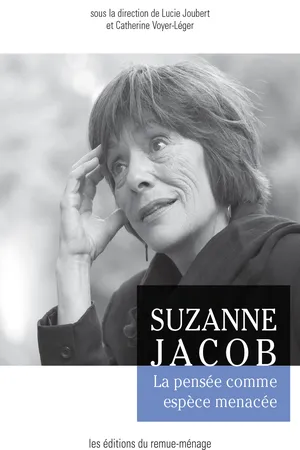![]()
Lever les voiles: parcours au féminin
et mise au jour des pouvoirs patriarcaux
et coloniaux dans Rouge, mère et fils
CHARLOTTE COMTOIS
Normalement, ça ne rate pas, on trouve toujours
un viol ou un abus sous tous les supposés «titres».
Suzanne Jacob, Rouge, mère et fils
En 2001, Suzanne Jacob fait paraître Rouge, mère et fils, œuvre chorale où s’enchevêtrent les histoires de Delphine, de son fils Luc, de ses amants présents et passés, Simon, Lenny, Lorne et Félix de même que celles du Trickster, de Catherine, de Rose et d’Armelle. Chaque personnage y fait montre d’une grande mobilité géographique. Luc et Rose traversent Montréal et les Laurentides, le Trickster entreprend depuis Montréal un périple vers la côte ouest du Canada et Félix, Armelle et Delphine se rendent aux États-Unis. Cette dernière voyage aussi loin qu’en Afrique. Puisque les personnages féminins se meuvent sur d’aussi longues distances que les personnages masculins, on pourrait conclure à leur autonomie de mouvement ou supposer que cet univers romanesque est dépourvu d’entraves patriarcales: ces personnages ne semblent pas restreints par le découpage genré du territoire en contexte patriarcal, associant la sphère privée au féminin et la sphère publique au masculin, limitant la mobilité géographique des femmes (Massey 1994).
Sous la multiplicité des trajectoires sourdent toutefois deux histoires principales; elles structurent le roman, lui servent d’amorce et se résolvent à son terme. La première tourne autour d’un viol que subit Delphine à l’occasion d’un voyage en Abitibi, puis du meurtre qu’elle commet par la suite. La seconde s’attache à la quête identitaire de Luc et de Delphine, qui tentent de recouvrer l’héritage autochtone dont ils ont été spoliés. L’agression sexuelle dont cette dernière fait l’objet et les carences identitaires qu’elle partage avec son fils font poindre l’existence de dominations masculines et blanches dans le récit. Afin de déterminer si celles-ci régissent bien l’univers représenté et en quoi elles influencent les rapports d’appropriation spatiale des personnages féminins et des personnages autochtones, j’analyserai d’abord les représentations des pouvoirs masculins, puis celles relevant des pouvoirs coloniaux. Auparavant, je présenterai les repères théoriques qui guideront mon analyse des relations entre les personnages et l’espace qu’ils habitent.
Espaces et relations de pouvoir
Les géographes contemporains pensent généralement l’espace comme résultant de réseaux de relations de pouvoir en constante négociation (Massey 1994). Selon eux, les rapports de domination s’inscrivent dans l’espace et le façonnent de sorte que les modalités d’accès à ce dernier diffèrent grandement selon les privilèges que détiennent ses occupantes et occupants (Ganser 2009). En régime patriarcal, parcourir la ville revient pour les femmes à «assumer les risques potentiels» (Condon, Lieber et Maillochon 2005) liés à leur mobilité, notamment ceux d’être harcelées et agressées physiquement ou sexuellement. Alexandra Ganser soutient que «les femmes, plutôt que les hommes, se font demander d’éviter les espaces potentiellement dangereux de manière à prévenir les viols; ainsi, la relation des femmes à l’espace même devient négative tandis que “les espaces sont ressentis comme appartenant au pouvoir patriarcal”» (Gillian Rose, dans Ganser 2009: 71-72).
L’espace ne procède pas seulement des relations de pouvoir qu’y entretiennent ses habitants, il fait également office «d’instrument à la pensée comme à l’action» (Lefebvre 2000: 35), d’un moyen de production, de contrôle et de pouvoir. Il est agent producteur du social tout autant que produit par ce dernier, le premier n’allant pas sans le second, ne précédant ni ne prévalant sur le second (Massey 1994). Il convient donc d’étudier les relations entre les espaces et les individus, attendu que ces derniers détiennent aussi un pouvoir, celui d’agir à l’extérieur des cadres sociaux normatifs, de reconfigurer les lieux à leur profit. Car s’il n’est jamais définitif, mais bien toujours en voie d’être constitué, l’espace peut être altéré par qui le parcourt et l’habite. En investissant la sphère publique, les femmes contreviennent par ailleurs à la répartition territoriale restreignant leurs déplacements de même que leurs potentialités identitaires; elles aménagent ce faisant un cadre spatial plus inclusif (Ganser 2009).
De manière analogue au pouvoir patriarcal, qui influence la manière qu’ont les femmes de parcourir et d’habiter les lieux, «la façon dont le colonisateur planifie les routes, organise les villages ou construit les maisons modifie à terme la manière dont les colonisés pensent et agissent [...]» (Blais 2009: 148). L’espace devient de fait étranger aux populations autochtones, les lieux se voyant progressivement déchargés de leur culture. Pour subvertir l’ordre spatial colonial, les peuples colonisés doivent en négocier l’aménagement, et ce, en dépit de l’autorité dominante (Blais 2009).
C’est d’ailleurs lorsque les individus agissent dans une volonté de «résister au pouvoir» (Dussault Frenette 2015: 12) qu’ils font montre d’agentivité. Celle-ci se donne comme la capacité d’agir – la puissance d’agir – de manière à remodeler les systèmes de pouvoir depuis l’intérieur de ces systèmes (Butler 1993; Druxes 1996). Or s’il faut comprendre la mobilité des femmes comme une négociation des dangers, et partant, des pouvoirs les confinant à la sphère privée, quitter la demeure devient signe d’agentivité. Il serait en revanche erroné de concevoir la mobilité géographique au féminin comme étant systématiquement liée à une prise de pouvoir, puisque les trajectoires peuvent également se déployer dans les limites des rôles de genre traditionnels (Côté 2013; Domosh et Saeger 2001). Afin de statuer sur leur signification, il importe ainsi d’étudier les motivations qui les sous-tendent.
Manifestations de la domination masculine
Pour Delphine, le récit ne constitue qu’un long voyage: elle part du Manoir Montmorency pour se rendre à Québec, puis poursuit sa route vers Montréal, qu’elle quitte aussitôt en coup de vent; de là, elle se rend en Afrique, qu’elle délaisse pour Miami. Elle se dirige plus tard vers Ottawa et les Laurentides. Loin d’être confiné à la sphère intime, ce personnage circule avec aisance et traverse l’océan sans problème: «Lorne venait de lui confier la mission d’aller en Afrique chercher un moribond, Lenny, pour le ramener mourir chez ses parents en Floride [...]. Bien. C’était facile et elle était déjà dans un avion au-dessus de l’Atlantique» (Rouge, mère et fils: 25; c’est moi qui souligne).
La grande mobilité de Delphine se répercute dans la description que certains personnages font de son appartement: il est qualifié de «wagon» (RMF: 38) par Rose, et Luc souligne que sa mère s’y installe «en transit» (RMF: 38). Aussi, bien qu’elle y réside depuis cinq ans, cette sédentarité s’avère illusoire:
J’y suis, j’y reste, s’obstine Delle chaque année lorsqu’il est question de suivre le raz de marée des déménagements, je ne quitterai pas les féviers d’Amérique de la rue Adam, ni les tilleuls du terre-plein, ni le pavillon de fanfare du parc Morgan, ni les étourneaux sansonnets, ni l’épicerie Bécotte, ni le Marché des Valeurs... (RMF: 38)
Ici, nulle attention n’est accordée à l’intérieur du logis: le personnage ne semble l’habiter que pour mieux en sortir. Par ailleurs, la seule scène où Delphine est représentée à l’intérieur de son appartement la montre en train d’afficher dans le couloir une carte hydrographique du Québec, une représentation de la cordillère des Andes, une image du ciel atlantique, puis une autre de l’océan Indien. Ces affiches tiennent lieu de «fausses fenêtres» (RMF: 39); elles ouvrent l’espace clos sur le dehors et le monde.
Ces images illustrent plus qu’une ouverture vers l’extérieur. Lorsque son ami Lorne revient d’une expédition au Groenland, Delphine appose la photo du ciel atlantique sur le mur du couloir. Par la suite, son conjoint, Simon, en recouvre un pan: «C’est Simon, jaloux, qui a punaisé l’océan Indien juste à côté de l’Atlantique» (RMF: 42), lequel rend compte de son passage dans la marine française. Le «wagon» fait dès lors l’objet d’une rivalité masculine, Simon exigeant de surcroît de Delphine qu’elle se départe des photos des hommes de son entourage.
À l’occasion d’un trajet en voiture, adoptant la perspective de Simon, Delphine se plaît à imaginer le raisonnement de ce dernier au moment où elle a cédé à sa requête:
Delphine a commencé par accorder toute sa place à ma jalousie, jusqu’à consentir à déchirer la dernière photo de Lorne, et une autre de Lenny, qui lui était plus chère encore. [...] Je ressens un plaisir incompréhensible à la regarder déchirer cette photo de Lenny, un plaisir presque sadique parce que je sens Delphine désespérée de se séparer de cette image (RMF: 14).
Lorsqu’elle détruit les photos, Delphine se défait symboliquement des souvenirs dont ils ont la garde, efface de son logement la présence de ceux qu’ils représentent. La jalousie de Simon prend désormais leur place, et la mémoire de ce dernier, matérialisée par l’image de l’océan Indien, s’installe dans l’appartement. Que Delphine concède «toute la place» à la jalousie de Simon met au jour l’emprise que ce dernier exerce sur les lieux intimes, qu’il aménage selon son désir et contre celui de sa partenaire, «désespérée» à l’idée de déchiqueter les photographies.
L’ingérence de Simon se voit toutefois limitée par Delphine: celle-ci préserve une image de Lenny sur sa table de chevet. Un lieu, le plus intime de la maison, demeure donc intouché. Mais si la chambre devient le siège d’une résistance à l’égard des revendications de Simon, Delphine ne l’affronte jamais vraiment. Elle transgresse ses règles en cachette et laisse parfois les désirs de son conjoint primer sur les siens. Son logement ne paraît pas importer beaucoup à Delphine; il s’apparente davantage à un lieu d’escale qu’à un lieu d’habitation. Aussi semble-t-elle plus attachée à sa liberté hors les murs qu’à l’intérieur. Et si son conjoint s’approprie parfois les lieux, il n’a aucune prise sur ses déplacements.
Transits ingouvernables
Aux prises avec une angoisse terrible, Delphine écourte un séjour chez Simon. Malgré les pressions de son hôte, qui aurait souhaité qu’elle reste– «“Tu avais promis de passer tout le week-end, qu’on irait voir les oies”, avait plaidé Simon» (RMF: 11) –, Delphine ne change pas ses plans. Plusieurs années auparavant, Félix avait aussi tenté de la retenir à ses côtés: «Chasse et pêche! dit Félix [à son fils Luc], je vais te le dire pourquoi je t’ai gardé avec moi. En fait, je t’ai gardé en otage. J’aurais mis ma main au feu que Delphine ne pourrait jamais se passer de toi [...]» (RMF: 131). Mais contrairement aux attentes de son mari, cette dernière quitte le foyer et Félix se voit contraint de s’occuper de Luc «comme une mère» (RMF: 250): il lui prépare ses repas, l’habille, s’assure que sa chambre soit propre. Les tâches domestiques relevant traditionnellement du féminin, spécifiquement associées au maternel dans le récit, lui sont dès lors imparties. Delphine, qui n’est «pas, n’a pas été et ne sera jamais une mère ordinaire [...]» (RMF: 222) agit aux antipodes du modèle traditionnel de mère et d’épouse, qui assure le maintien des femmes dans la sphère privée (Guillaumin 1992). Aucun de ses partenaires ne parvient à la fixer contre son gré.
Sa mobilité n’est pas davantage limitée par le code de la route: «Bon, voilà qu’elle roulait à cent soixante» (RMF: 10). Interceptée par un patrouilleur, Delphine e...