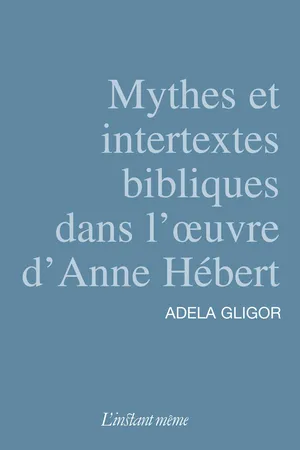![]()
PREMIÈRE PARTIE
LA VISION PARODIQUE DES MYTHES ET DES INTERTEXTES BIBLIQUES DANS L’ŒUVRE D’ANNE HÉBERT
![]()
LA PARODIE – UNE VOIE (VOIX) AUTRE
Avant d’entamer l’étude des figures bibliques parodiées dans l’œuvre d’Anne Hébert, il s’avère utile de consigner quelques considérations théoriques sur la notion de « parodie », en précisant de quelle manière le terme sera utilisé dans le contexte de cet essai. La parodie est-elle une simple figure rattachée à la rhétorique ou bien peut-on parler d’un genre, et dans ce cas, le concept ferait-il l’objet de la poétique ? Le terme est souvent vague, pris dans une nébuleuse théorique dans laquelle gravitent aussi des termes comme pastiche, réécriture, transposition, déconstruction, satire, etc. Des critiques comme Gérard Genette ont tenté de circonscrire son champ définitionnel, en l’interprétant comme une pratique intertextuelle qui se caractérise essentiellement par sa fonction satirique. La condition sine qua non de la parodie en tant que procédé littéraire implique une relation entre deux textes – le texte parodié et le texte parodiant –, l’identification du registre parodique d’un texte donné supposant une confrontation avec le texte source.
L’on évoque communément, en relation avec la parodie littéraire, l’idée d’un « détournement » : l’œuvre parodique serait celle qui « détourne » sémantiquement ou formellement une œuvre antérieure de son sens ou de sa fonction originaires, c’est-à-dire que, tout en se « greffant » sur un texte source, elle emprunte une autre voie, « parallèle » à la première, pourrait-on dire, pour la faire signifier autrement. C’est d’ailleurs ce sens que confirme l’étymologie grecque du verbe parodier : para veut dire « le long de », « à côté » et ôdè « chant » ; la parodie serait ainsi, selon Genette, « le fait de chanter à côté, donc de chanter faux ou dans une autre voix, en contrechant – en contrepoint – ou encore de chanter dans un autre ton : déformer, donc, ou transposer une mélodie ». Le sens étymologique du terme aurait trouvé une application, selon Genette qui cite Scaliger, dans la pratique des rhapsodes antiques qui interrompaient leurs récitations pour laisser la place à des « amuseurs » qu’on appelait « parodistes » et qui reprenaient sur un ton comique le sujet sérieux de la rhapsodie afin de détendre les auditeurs. En résumé, qu’on définisse la parodie par une métaphore appartenant au champ musical ou spatial, comme une « voix » ou une « voie » autre, on peut affirmer que l’hypertexte parodique présente un écart par rapport au texte source et que le « parodiste », soit l’auteur second, prend ses distances avec l’œuvre originelle pour mieux ironiser à son endroit.
Dans le cadre de ses recherches sur les pratiques intertextuelles, Genette tente de délimiter les différentes formes de la parodie : la plus stricte, d’après lui, est la parodie minimale, qui « consiste à reprendre littéralement un texte connu pour lui donner une signification nouvelle, en jouant au besoin et si possible sur les mots […] ». Cette première définition, qui reste somme toute assez générale et vague, prend en considération les modifications sémantiques que subit la citation qui, extraite de son contexte d’origine, acquiert une signification nouvelle. Genette affirme que ce mode restreint de la parodie a des limites, ne pouvant s’appliquer qu’à des textes brefs, tels que des vers, des mots historiques ou des proverbes. Cependant, ces contraintes ne semblent nuire aucunement à la pratique hébertienne de la citation testamentaire, la structure des versets bibliques faisant en sorte qu’ils se prêtent aisément au découpage et au prélèvement textuel.
Dans l’ouvrage d’Antoine Compagnon La Seconde Main ou Le Travail de la citation, la citation littéraire fait l’objet d’une étude approfondie. L’auteur prend en compte non seulement la citation en tant que morceau textuel prélevé à un texte source mais également le « travail de la citation », c’est-à-dire les modifications qu’on lui fait subir à travers la réécriture. En considérant la citation littéraire comme une forme restreinte de l’intertextualité, le critique la définit comme « la répétition d’une unité de discours dans un autre discours ; elle apparaît comme la relation interdiscursive primitive ». La citation est donc le premier indice d’une présence textuelle autre dans le texte de l’écrivain ; elle éveille des échos dans la mémoire du lecteur, renvoie à une référence extratextuelle en mettant en rapport deux systèmes sémiotiques (un texte et un auteur premiers avec un texte et un auteur seconds) à travers une série d’interprétants. Les analyses de Genette et de Compagnon sur les pratiques intertextuelles s’avèrent ainsi utiles dans l’étude des divers procédés par lesquels Anne Hébert parodie les citations bibliques dans son œuvre (détournement du sens par déplacement du contexte, réécriture des citations, pastiche, etc.).
Lorsque la réécriture parodique vise l’imitation caricaturale du style d’un texte, Genette précise qu’il s’agit du pastiche satirique, qu’il considère comme une espèce de la parodie et qu’il distingue du pastiche pur, dépourvu d’intention narquoise. On trouve le pastiche satirique dans l’œuvre hébertienne lorsque l’auteure imite parfois le style scripturaire, comme dans Les Fous de Bassan, à travers le discours du révérend Nicolas Jones ; le pasteur inscrit la fondation de Griffin Creek au XVIIIe siècle dans un contexte mythique, en faisant allusion au début de la Genèse biblique : « Au commencement il n’y eut que cette terre de taïga, au bord de la mer, entre cap Sec et cap Sauvagine ».(FB, 14) L’évocation solennelle de l’origine du village prend, un peu plus loin, une allure caricaturale, car le pasteur avoue qu’en 1982, il ne subsiste de cette communauté aux ancêtres mythiques qu’une poignée de « vieux rejetons sans postérité » (FB, 14). L’utilisation parodique du style biblique dans Les Fous de Bassan sera étudiée de manière plus détaillée dans la dernière partie de cet essai, où il sera question de l’influence formelle des Écritures sur l’œuvre hébertienne.
On a vu plus tôt que, d’après Genette, la parodie comme le pastiche restent des procédés assez limités, qui ne concernent que des textes courts ; la pratique hypertextuelle pouvant donner naissance à un texte plus ample est, selon le critique, la transposition, laquelle entraîne une modification à la fois formelle et thématique de l’hypotexte. Même s’il établit un tableau des pratiques hypertextuelles dans lequel la parodie est définie comme une transformation ludique et le pastiche comme une imitation stylistique, Genette n’insiste pas sur les différentes formes de parodie, focalisant son étude sur la transposition, qu’il définit comme une pratique de réécriture « sérieuse ». Pourtant, la réécriture parodique, cette voie « autre » qu’emprunte un auteur afin de réécrire une œuvre, peut viser autre chose que la citation, en opérant sur les thèmes et sur les structures narratives de l’hypotexte. En outre, la parodie n’a pas toujours un caractère purement ludique et inoffensif, comme le laisse entendre l’analyse genettienne ; il serait peut-être plus approprié de parler de degrés parodiques, la réécriture pouvant aller du simple jeu intertextuel, sans intention ironique, jusqu’à la moquerie et à la satire la plus féroce. C’est justement cette complexité des pratiques intertextuelles qu’il s’agira d’étudier dans l’œuvre hébertienne, à travers les mythes et les figures mythiques bibliques, les intertextes et les structures narratives testamentaires.
En s’inspirant des personnages, des histoires ou des structures narratives bibliques, l’auteure remet en cause les modèles scripturaires et sa réécriture prend souvent une tournure parodique. Le roman hébertien dans lequel on voit le mieux apparaître l’attitude anticléricale de l’auteure et sa réécriture parodique des textes et des mythes bibliques est Les Enfants du sabbat. Comme dans ses autres romans, l’auteure s’emploie à bouleverser l’ordre établi, en confrontant ici la loi divine, représentée par le couvent des dames du Précieux-Sang, avec l’envers sombre du décor, le sabbat des sorciers dans la montagne de B… Cette contestation des mythes de la tradition judéo-chrétienne prend dans le roman la forme d’une réécriture parodique. Le discours ironique de l’héroïne, sœur Julie de la Trinité, sert à créer une vision caricaturale des mythes testamentaires. Anne Hébert critique, à travers son personnage, les symboles les plus forts de la Bible et de la religion chrétienne : le Dieu patriarcal, la Passion du Christ, la Trinité, l’Eucharistie, en confondant délibérément le sacré et le profane et en inversant l’ordre moral établi. Cette volonté de contester les mythes sacrés, à travers l’inversion blasphématoire entre le « haut » spirituel et le « bas » matériel, évoque la conception du carnavalesque définie par Mikhaïl Bakhtine à propos de la culture populaire médiévale. La parodie carnavalesque, précise le théoricien, est marquée par « la logique originale des choses “à l’envers”, “au contraire”, des permutations constantes du haut et du bas (“la roue”), de la face et du derrière, par les formes les plus diverses de parodies et de divertissements, rabaissements, profanations, couronnements et détrônements bouffons ».
Dès le titre, l’auteure laisse entrevoir son projet sacrilège par rapport aux mythes bibliques, en superposant le sens sacré du « sabbat » – le jour consacré au culte divin – et sa connotation démoniaque, qui renvoie à la cérémonie des sorcières. L’ambiguïté sémantique du terme est maintenue tout au long du roman, où l’office religieux du couvent se déroule en parallèle avec la messe noire célébrée dans la cabane des sorciers.
Il faut préciser cependant qu’Anne Hébert ne réécrit pas de manière intentionnelle, volontaire, les mythes ou les textes anciens, comme le feraient certains auteurs, tels que Jean Giraudoux, Jean Anouilh ou Jean Grosjean qui reprennent les modèles littéraires judaïques, chrétiens ou gréco-latins et qui présentent explicitement leurs œuvres comme des réécritures au sens propre du terme. La démarche hébertienne par rapport aux Écritures est plutôt allusive, comme celle de nombreux auteurs pour qui les références aux textes bibliques sont incontournables, puisque les Écritures font partie d’un héritage culturel commun. L’influence scripturaire sur l’imaginaire hébertien est complexe, car elle se traduit par la présence des allusions aux figures et aux thèmes de la Bible, ainsi qu’aux récits testamentaires et au style des textes sacrés. Cependant, même si la réécriture des mythes bibliques dans l’œuvre hébertienne acquiert parfois une dimension parodique, la démarche d’Anne Hébert n’est pas forcément déconstructrice et négative, car, à travers la critique de la vision judéo-chrétienne, l’auteure apporte un nouvel éclairage aux thèmes et aux mythes scripturaires.
Le premier chapitre sera consacré à l’influence de la Bible sur l’œuvre d’Anne Hébert, à travers plusieurs mythes fondamentaux et leurs protagonistes qui font l’objet de la réécriture parodique dans les romans de l’auteure. Parmi les mythes vétéro-testamentaires auxquels s’intéresse l’auteure, le récit biblique de la Création occupe une place prépondérante, étant actualisé à travers des références au mythe du Paradis terrestre et à celui de la Chute, ainsi qu’aux figures d’Ève, d’Adam et du Serpent tentateur. Le mythe du Déluge est évoqué maintes fois à travers l’histoire de son protagoniste Noé et de son Arche. Il arrive que l’auteure fasse également allusion au mythe de Babylone, la cité maudite, ou encore à l’histoire de la femme de Loth quittant Sodome, à la lutte de Jacob avec l’Ange et au mythe de l’Exode, de même qu’à son protagoniste, Moïse. Enfin, une place particulière est accordée dans l’œuvre au mythe de la ténébreuse Lilith. Les mythes du Nouveau Testament sont également présents dans l’univers hébertien : la Passion christique et l’Apocalypse (le Jugement dernier, les anges et les saints), ainsi que la figure de Satan. Après avoir identifié et étudié les récits mythiques bibliques qui sous-tendent l’œuvre, on s’interrogera sur l’intérêt particu...