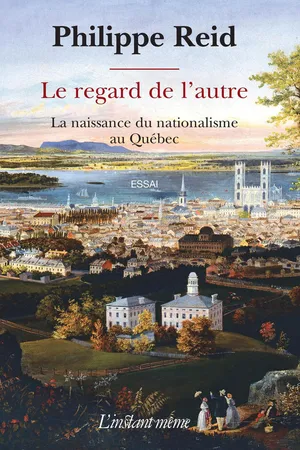CHAPITRE IV
LES STRUCTURES SOCIALES
DU BAS-CANADA
Économie, politique et religion constituent les trois plus importantes structures sociales du Bas-Canada. Chacune d’entre elles est dominée par une élite qui définit les normes à suivre dans l’action collective et qui prescrit en quelque sorte un ordre social idéal. D’autres acteurs sociaux, individuels et collectifs, y expriment également leurs propres normes.
Il règne à mes yeux une grande instabilité, le mot plus juste serait dynamisme, au sein de ces structures, en raison du choc fréquent d’éléments contraires. Elles se chevauchent et sont ouvertes sur l’extérieur, notamment sur Londres, Glasgow et Rome, en ce qui concerne le Bas-Canada. C’est dire qu’il n’y a pas de totalité appelée « la société », qui serait la somme de toutes les structures. « La société » est en réalité toujours problématique, constamment en train de se faire, de se défaire et de se refaire. Elle ne constitue pas ce tout unifié qui se conçoit lui-même dont parlent certains chercheurs, non plus qu’il est loisible de parler de société globale qui entretient des représentations sur elle-même, qui se donne des finalités.
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU BAS-CANADA
Parler du Bas-Canada, c’est se référer à un espace social délimité par la frontière tracée en 1791, au moment de la constitution par la Grande-Bretagne de deux colonies distinctes, le Bas-Canada et le Haut-Canada. Cela dit, nous éviterons de nous perdre dans des détails historiques, pour porter notre attention sur les principaux groupes sociaux.
Une élite marchande
L’examen de la structure économique ne peut que révéler la présence d’un petit groupe d’individus voués au commerce. Certains sont marchands de fourrures, d’autres importateurs de produits manufacturés en même temps qu’exportateurs de céréales, de potasse et de poissons. D’autres encore travaillent dans le commerce du bois, ou exploitent des chantiers maritimes, où ils font construire les bateaux nécessaires à leurs activités commerciales.
Le premier détail frappant chez cette bourgeoisie commerçante, c’est sa composition ethnique. W. Stanford Reid40 nous fait prendre conscience de l’origine écossaise de la grande majorité des membres de cette bourgeoisie au XVIIIe siècle, de même qu’au siècle suivant. À n’en pas douter, l’économie du Bas-Canada est avant tout l’affaire des Écossais.
Dès 1759, au moment de la guerre de Conquête, arrivent au pays un certain nombre de marchands, Écossais de la région des Lowlands, plus précisément de Greenock, un port sur la rivière Clyde en aval de Glasgow. Ils voient dans le siège de Québec non seulement une occasion de fournir en nourriture l’armée d’occupation, mais aussi des débouchés pour leurs produits manufacturés. La chute du Régime français favorise évidemment leurs desseins.
On peut citer à titre d’exemple le cas de James Finlay. Associé à son frère Robert à Greenock, il met sur pied dès 1764 un service régulier de bateaux entre la Clyde et Québec, affrétant des navires pour l’importation de lainage, de toile, d’alcool (du rhum) et de ferronnerie ; au retour, ils exportent bois et potasse41. Des immigrants des Lowlands — maçons, jardiniers, carriers, meuniers, opérateurs de scieries… — sont recrutés : on paye leur passage s’ils s’engagent par contrat à travailler au Canada. Jusque dans les années 1790, James Finlay veille aussi à la construction de magasins, d’entrepôts et de résidences à Québec.
James Dunlop est un autre de ces marchands formés à Glasgow et liés à plusieurs firmes de Greenock. Fuyant la Révolution américaine, il arrive à Montréal en 1776. Il commence comme marchand général, important textiles, boissons et produits alimentaires. Il a tôt fait de faire construire un vaste entrepôt, rue Saint-Paul. Il ne s’arrête pas là : après 1793, il commerce avec les Antilles y exportant du bois, des provisions et du bétail et en important entre autres du sucre et du rhum. Il doit donc faire construire, à Montréal et à Québec, aidé de charpentiers, d’architectes navals et d’artisans écossais, une flotte de navires de plus de 400 tonneaux. Il en profite également pour exporter vers l’Angleterre du chêne de choix et des céréales, et vers l’Écosse de la potasse, produits qu’il a achetés directement des producteurs du Haut et du Bas-Canada. Il paye ces derniers en produits manufacturés importés d’Écosse et des Antilles. Ses réserves lui permettent de spéculer sur les prix. Ses activités de cabotage sur le fleuve l’incitent à aménager des quais et à construire de petits entrepôts. Aux alentours de 1810, il exporte dans la péninsule ibérique du bœuf en baril pour des armées de Wellington. Ambitieux, plein d’énergie, sachant déceler les tendances, il prévoit que la guerre de 1812 entre l’Angleterre et les États-Unis sera favorable à la construction de navires.
En 1800, on compte pas moins de 35 entreprises engagées, comme celles de Finlay et de Dunlop, dans le commerce (l’import-export, dirions-nous aujourd’hui) entre la Clyde (Glasgow/Greenock) et le fleuve Saint-Laurent. La domination des Écossais de la Clyde est observable aussi en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, après 1783.
À ce noyau initial, compact et homogène, ont peine à se joindre des commerçants d’origine canadienne. Mal servis par l’issue de la guerre de Sept Ans, dépourvus de relations commerciales avec l’Angleterre et l’Écosse, ils soutiennent difficilement la concurrence. Aussi la plupart d’entre eux sont-ils forcés en l’espace de quelques décennies de s’intégrer tant bien que mal aux rangs subalternes de l’administration coloniale.
Ainsi, François Baby, après maintes tracasseries et vicissitudes, deviendra grand voyer et adjudant général, en plus de recevoir la charge non rémunérée de conseiller législatif. On pourrait également évoquer le cas de Saint-Georges Dupré, devenu commissaire des milices et des corvées pour le transport militaire, ou encore celui de La Naudière, autre grand voyer. La subordination des quelques commerçants canadiens à l’administration coloniale est si complète que, vers 1790, l’élite marchande sera presque exclusivement composée de Britanniques, des Écossais de la région de Glasgow pour la plupart, comme nous venons de le constater.
Mais, peut-on se demander au passage, comment un tel intérêt pour le commerce s’est-il développé dans cette région ? Des historiens notent qu’une culture commerciale a commencé à y prendre racine au XVIIe siècle. Des groupes de marchands ont rapidement trouvé le moyen de sortir du cercle restreint des pêcheries de Terre-Neuve (considérée alors comme une extension de l’Angleterre, donc accessible aux Écossais), auquel les confinaient les lois anglaises sur la navigation, pour commercer avec les colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre (importation du tabac de Virginie, par exemple), les colonies françaises et espagnoles des Antilles (le sucre, entre autres). Il y a plus : une véritable révolution économique, selon les dires de l’historien D. S. MacMillan42, est en train de se produire dans la région de Glasgow. Attirés par les nouvelles entreprises industrielles — des raffineries de sucre, des distilleries (où l’on produit du rhum), des manufactures où l’on fabrique voiles et cordages, des chantiers navals… —, les gens des alentours affluent vers cette ville, qui voit sa population gonfler. Un nouveau groupe d’hommes très ambitieux émerge, des commerçants qui veulent prendre leur place au soleil, qui sentent que c’est maintenant au tour de l’Écosse de connaître les bienfaits du progrès. Troisième élément d’explication : le système scolaire écossais, à la base duquel se trouvent les écoles paroissiales presbytériennes, qui a permis de scolariser une partie importante de la population et a rendu accessible à un plus grand nombre qu’ailleurs l’éducation supérieure.
À côté de ces marchands généraux se trouvent des commerçants qui s’adonnent à la traite des fourrures, autre activité économique largement dominée par des Écossais.
Le plus connu sans doute des marchands écossais se nomme Simon McTavish. Après avoir vécu dans l’État de New York, ce Highlander — une exception qui confirme la règle, pourrait-on dire — arrive à Montréal en 1775, âgé de 25 ans, pour y fonder sa propre entreprise. Il n’est pas le seul à s’adonner à cette activité. On note aussi la présence de William Grant (de Trois-Rivières) et de son associé Simon Fraser, d’Isaac Todd et de James McGill, associés dans la firme Todd, McGill & Co, de George Phyn et d’Edward Ellice (ces derniers ont fui Schenectady dans l’État de New York au moment de la guerre d’Indépendance américaine), de la firme Phyn, Ellice & Co, de James Finlay Senior, d’Alexander Mackenzie, et de Norman McLeod de la firme Gregory, McLeod & Co, des frères Benjamin et Joseph Frobisher (parmi les rares qui ne soient pas écossais), de David et Peter Grant, de Thomas Corry, et j’en passe.
On constate chez tous ces marchands de fourrures la même ambition, la même ardeur au travail, mais aussi le même esprit de clan, le même favoritisme dans l’embauche que chez les marchands généraux. Pleins de préjugés à l’endroit de tous ceux qui ne sont pas de la région de Glasgow, ils remplacent les Canadiens dont ils avaient eu besoin, au début, en raison de leur connaissance du terrain et des langues indiennes, par des Écossais, de préférence de leur propre région, quand ce n’est pas de leur propre famille. Par exemple, au sein de l’entreprise de Simon McTavish, qui deviendra en 1783 la North West Company, se trouvent ses neveux William et Duncan McGillivray, ses cousins Simon Fraser, John McGillivray, Alexander Fraser et Donald McTavish. Roderick McKenzie a épousé la belle-sœur de Simon McTavish, et John McDonald of Garth, une de ses nièces, et ainsi de suite. Les clans, fondés sur la parenté, forment la base de leurs relations social...