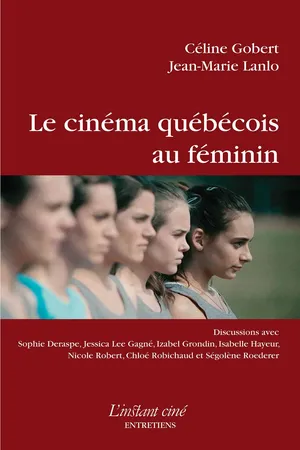![]()
Ségolène Roederer
JEAN-MARIE LANLO : Quelle est la place des femmes dans le cinéma québécois ?
SÉGOLÈNE ROEDERER : Au niveau des décideurs, elle est extrêmement importante, que ce soit à Radio-Canada, à Téléfilm Canada ou à la SODEC. À l’ONF c’est un peu différent… mais en production, il y a beaucoup de productrices fortes ! Au niveau décisionnel, la place des femmes est donc très importante dans notre cinéma, mais paradoxalement, il n’y a pas énormément de projets de femmes qui passent. Nous avons déjà eu plusieurs discussions à ce sujet, et la question est « où est-ce que ça bloque ? » On constate à peu près la parité au niveau des études, mais dans les projets soumis à la SODEC et à Téléfilm Canada, on ne retrouve plus cette parité. Reste à savoir pourquoi. C’est d’ailleurs la grosse question que se posent les Réalisatrices Équitables. C’est très difficile d’avoir des données sur le nombre de projets déposés chez les producteurs. Est-ce qu’il y a moins de projets dès le dépôt ou est-ce qu’il y a systématiquement, et de façon certainement involontaire, moins de films de femmes choisis, de par les thématiques par exemple ? L’imaginaire féminin est donc moins présent dans le cinéma que l’imaginaire masculin. Pour synthétiser, nous avons donc des décisionnaires majoritairement féminins, beaucoup de femmes dans la production… mais peu de réalisatrices ! Il y en a quand même plus qu’avant, et il y a beaucoup de femmes qui représentent la relève et qui sont en train de s’imposer. De plus, j’ai constaté que, lorsqu’une femme cinéaste de 65 ans et une femme cinéaste de 30 ans se parlent, leur rapport au milieu, à leur droit de s’exprimer, ainsi qu’à leur métier est très différent. Pour une cinéaste de 30 ans, être une femme cinéaste aujourd’hui, c’est normal alors que pour une cinéaste des années 1970/1980, c’est un exploit et elle doit vivre chaque jour un véritable combat.
CÉLINE GOBERT : Pour revenir à ce que vous disiez sur l’imaginaire féminin, il pourrait aussi être traité par des hommes. Pensez-vous qu’il a, de manière générale, été moins représenté dans le cinéma québécois ?
SR : L’imaginaire féminin vu par les hommes est traité sous l’angle du désir masculin. Nous avons une cinématographie très riche avec Gilles Carle par exemple, qui a mis la femme au centre de son œuvre, mais avec un regard d’homme sur le désir de la femme. Des grands personnages de femme dans notre cinématographie, il y en a peu. Je pense que c’est aussi le cas ailleurs. Lorsque Jane Campion a obtenu la Palme d’or avec La leçon de piano, cette histoire d’amour filmée avec le regard de la femme a eu l’effet d’une bombe. Les Réalisatrices Équitables avancent la piste d’une discrimination inconsciente. Inconsciemment, les histoires portées par les hommes vont davantage nous intéresser que les histoires portées par les femmes. On cherche des héros. On a tous été bercés par les grands archétypes que sont la force, la conquête et le désir, qui sont plus difficiles à aborder d’un point de vue féminin.
JML : Ces archétypes sont d’ailleurs peut-être plus liés à un cinéma commercial. Est-ce que ce n’est pas dans le cinéma d’auteur qu’on pourrait développer le cinéma québécois au féminin ?
SR : Sûrement. C’est d’ailleurs là qu’on retrouve la grande question liée aux projets. Où sont-ils ?
JML : Les réalisatrices ont peut-être peur de les déposer car elles s’attendent à des refus ?
SR : C’est possible, alors qu’une femme cinéaste ne devrait pas avoir à se demander si elle fait un film de femme. Que The Hurt Locker de Kathryn Bigelow soit réalisé par une femme ou non, on ne peut pas le voir en regardant son film. D’ailleurs, qu’est-ce que le cinéma féminin ? Doit-il obligatoirement raconter une histoire avec une héroïne femme ? Pas obligatoirement ! J’ai l’impression qu’il y a aussi des questions qui concernent l’accès au plateau, l’autorité, la reconnaissance. Je pense que toute femme de pouvoir vit son statut moins facilement. Être un réalisateur, c’est vraiment un métier de pouvoir par définition. Il faut sans arrêt prendre des décisions, convaincre des gens. Je pense que c’est toujours plus difficile pour une femme d’acquérir cette autorité qui fait qu’on va suivre ce qu’elle veut faire.
JML : L’an dernier, aux RVCQ, vous avez organisé une table ronde sur le manque de diversité culturelle dans le cinéma. Voyez-vous la faible représentation des femmes comme un autre problème qui peut éventuellement nuire au cinéma québécois ? Et s’il y a un problème, essayez-vous des choses pour le régler ?
SR : Je trouve qu’on n’essaie pas assez. On devrait donner plus d’importance à cette question-là, comme à la question de la diversité d’ailleurs. J’en discute beaucoup avec le directeur des Rendez-vous du cinéma québécois. Je pense qu’on devrait être plus sur la ligne de front, car on passe à côté de quelque chose. On le voit dans la littérature, où il y a une plus grande parité, avec des voix de femmes extraordinaires. Je considère que nous n’avons pas accès à certains imaginaires ou à des histoires dont nous serions fiers et qui nous seraient précieuses. Je suis certaine qu’il y a une lutte, un travail à faire pour s’assurer que les femmes puissent créer, qu’elles aient les outils pour le faire et qu’elles finissent par être vraiment reconnues.
CG : Ce travail ne serait-il pas à faire au niveau éducatif ?
SR : Toute la notion de confiance en soi, toutes ces choses avec lesquelles les femmes sont confrontées dans leur carrière, c’est la base. On retrouve ça au niveau de l’éducation, au niveau de la famille, au niveau des valeurs, au niveau des boys’ clubs qui sont encore présents partout. Il y a tout un patriarcat qui existe et dont les hommes ne sont pas obligatoirement conscients. C’est vraiment la notion de confiance en soi qui est importante et qui reste l’une des problématiques de la femme dans une société qui est encore très patriarcale. J’en suis persuadée.
JML : Même si dans le cinéma québécois la femme est perçue au sein de la famille comme étant très forte, alors que l’homme est extrêmement…
SR : Fuyant…
JML : Fuyant ses responsabilités, en effet. Il y a une sorte de paradoxe. Mais ce sont les cinéastes hommes qui donnent cette image. C’est d’ailleurs quasi systématique dans le cinéma commercial québécois.
SR : L’homme est perdu au Québec ! Dominique Dugas a une belle théorie là-dessus. Il pense que c’est lié au fait que nous n’avons pas d’identité nationale, que nous ne réussissons pas à avoir de pays, à être maîtres chez nous. Ça peut beaucoup jouer sur l’imaginaire de l’homme. Je trouve que ce n’est pas une idée idiote. Mais je crois que nous sommes en train de sortir de cette période d’hommes perdus. Pour revenir au sujet, ce qui est frappant, c’est qu’à l’école, il y a autant de filles que de garçons qui étudient le cinéma.
On sort un peu du sujet, mais comment ça se fait que la femme soit moins payée que l’homme pour un travail égal ? Je le vois au sein de mes jeunes équipes. Au travail, la manière dont un homme de 29 ans et une femme vont aborder la question des attentes salariales va être très différente par exemple. L’assurance de sa propre valeur est très différente chez les hommes et chez les femmes. Nous sommes dans une société où l’homme a encore un pas d’avance.
JML : La femme se sentirait-elle moins importante ?
SR : Je pense qu’elle est plus reconnaissante de ce qu’elle a. C’est encore présent, même si j’ai l’impression que les choses commencent à changer. Je pense que la femme est de plus en plus consciente de mériter sa place. Je perçois une nouvelle attitude chez les jeunes générations.
CG : Toutes les décideuses dont nous parlions peuvent aussi donner l’exemple.
SR : Oui. Ça va devenir normal. On le voit dans ce qui s’est passé avec Pauline Marois, avec les remarques sur la façon dont elle s’habille. Jamais on irait dire des choses sur la calvitie de Bernard Landry. Il y a une autre façon de parler des femmes… même des décideuses. Une femme qui gueule est caractérielle alors qu’un homme qui gueule a de la prestance, il est mieux accepté.
JML : On en revient peut-être à la différence entre la littérature et le cinéma ! Une écrivaine…
SR : Elle est chez elle !
JML : Alors qu’une cinéaste est obligée de diriger une équipe, de gueuler.
SR : Et elle est mal vue si elle gueule. Je pense que l’autorité naturelle est plus difficile pour une femme que pour un homme. Tout de suite on va lui faire des réflexions désagréables. Celles qui ont fait leur chemin sont des dures. On a l’impression qu’elles doivent être deux fois plus dures. Certaines sont des femmes terrifiantes. J’ai l’impression que pour avoir le bout de gras qu’elles voulaient, elles sont devenues des machines.
CG : Et peut-on utiliser des moyens institutionnels pour pousser le cinéma de femmes ? Je pense aux quotas, par exemple.
SR : Personnellement j’y crois. Nous avons beaucoup de discussions avec Dominique Dugas à ce sujet. Il pense qu’une discrimination positive est une discrimination et que ça dévalorise le travail de la personne. Je ne le pense pas. Je pense que pour que l’égalité existe vraiment, il faut travailler à cette parité, surtout dans un domaine si particulier. C’est très subjectif de dire ce qu’est un bon ou un mauvais scénario. Je trouve qu’à ce niveau-là, une discrimination positive pourrait être intéressante.
JML : Ne pourrait-elle pas être accompagnée d’effets pervers ? D’autant plus qu’on ne sait pas si autant de femmes ont envie de faire des films que les hommes.
SR : Mais se sont-elles laissé donner le droit de le faire ? C’est ce qui est compliqué. Avoir envie est une chose, mais il faut aussi sentir qu’on a le droit de le faire.
JML : Donc les institutions financières pourraient à leur manière essayer de pallier un problème plus sociétal ?
SR : Je le crois. Je sais qu’à L’inis, ils font attention à ça. Il faut que ça se passe à tous les niveaux. Cela s’applique aussi aux producteurs. Ils devraient aller dans ces écoles pour voir quelles sont les jeunes femmes talentueuses, et donner sa chance à une jeune fille. C’est aussi vrai au niveau de nos jurys. Nous devons aussi instaurer la parité. Si tout le monde le fait un peu, l’échelle se met en place.
JML : Mais est-ce que ça passe obligatoirement par les quotas ?
SR : Oui, mais il faut aussi aller chercher des talents.
JML : Mais si ça vient des producteurs, il faut qu’il y ait un intérêt financier. Qu’est-ce qui peut les motiver à le faire ?
SR : C’est là où c’est important de parler de l’imaginaire.
JML : Les femmes pourraient aborder de nouveaux sujets peut-être plus délicats pour les hommes, notamment lorsqu’il est question d’elles-mêmes, de leur sexualité, de l’adolescence ?
SR : On entend parfois des cinéastes hommes dire qu’ils ont du mal à écrire des personnages féminins, et c’est un peu normal. C’est sûr que pour cette raison, si plus de femmes font plus de films, il y aura plus d’imaginaire féminin. C’est certain ! Et elles représentent la moitié de la population ! Mais il y a beaucoup de choses enfouies. C’est plus compliqué que de dire qu’il faut prendre autant de projets d’hommes que de femmes. Ce que fait Fabienne Larouche à la télé nationale canadienne, ce n’est pas rien. Un succès comme Unité 9, c’est incroyable ! C’est une histoire de femmes, écrite par une femme… certes réalisée par un homme, mais qui tient depuis cinq ou six ans et qui nous permet de voir un univers féminin, il est vrai, particulier. Mais je pense que ça fait avancer les choses.
JML : Mais le problè...