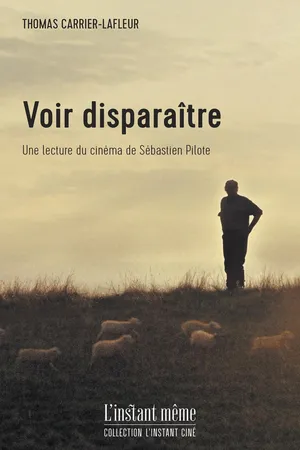![]()
LEUR MAISON SOLITAIRE
Maria Chapdelaine
« tu seras heureuse fille heureuse
d’être la femme que tu es dans mes bras
le monde entier sera changé en toi et moi »
Gaston Miron, « La marche à l’amour »
(L’homme rapaillé)
« Car la maison est notre coin du monde. Elle est — on l’a souvent dit — notre premier univers. Elle est vraiment un cosmos. »
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace
Une société-musée
« Ce bois-là, c’est chez nous. C’est le sable drainé par la rivière Péribonka depuis des milliers d’années. Saint-Ambroise, où je suis né, Sainte-Monique, Péribonka : c’est le même sol. Je le connais, tout comme je connais la végétation qui pousse dessus, intimement. J’ai passé mon enfance à l’explorer, cette forêt-là. […] C’est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, et c’est en continuité avec mes films précédents. C’est un roman qui m’obsède, que j’ai toujours aimé pour sa grande simplicité », disait déjà Pilote (dans Lévesque) en 2017, tandis que commençait à naître son projet de porter à l’écran, pour une quatrième fois — après Julien Duvivier, en 1934, Marc Allégret, en 1950 et Gilles Carle, en 1983 —, le mythique roman de Louis Hémon.
« Relire Maria Chapdelaine aujourd’hui relève de l’archéologie. Lieu commun, parfait symbole, ce livre est devenu un monument à déchiffrer. Certes, il existe un texte de Maria Chapdelaine, dûment publié, daté, circonstancié, immédiatement disponible et désormais exploré jusque dans ses variantes, mais combien de récits de ce texte, divergeant du récit de Hémon, l’occultant, le prolongeant, le modulant, parfois le recréant jusque dans ses données fondamentales », écrit Nicole Deschamps (dans Deschamps, Héroux et Villeneuve, p. 7-8) en ouverture de l’ouvrage Le mythe de Maria Chapdelaine, étude fondatrice sur l’œuvre de Hémon, avant d’ajouter que « [r]arement dans l’histoire de la littérature contemporaine trouvera-t-on l’exemple d’un après-texte aussi envahissant. Écrit et lu au début du vingtième siècle, Maria Chapdelaine rappelle déjà ces contes traditionnels dont on a oublié depuis longtemps la lettre et qui, à force d’être racontés, traduits, interprétés, réécrits, ont acquis dans diverses conjonctures historiques la densité des mythes » (p. 8). Avec ses coauteurs, Deschamps va ainsi se lancer dans une entreprise de démythification du récit de Hémon. De la première publication du roman en feuilleton jusqu’aux stratégies littéraires de Grasset pour en faire le plus grand succès littéraire de langue française de ce premier quart de siècle, en passant par les discours religieux qui se sont emparés du texte, de même que par ses nombreuses adaptations, reprises et variantes, voilà ce qui sera analysé et mis en perspective par les auteurs pour tenter de raconter de manière réaliste l’histoire de cette nébuleuse en mouvement qui a pour nom « Maria Chapdelaine ». La conclusion de cette enquête, toutefois, a de quoi surprendre : « Dans toutes ses manifestations, le mythe de Maria Chapdelaine apparaît ainsi comme l’expression d’une société-musée qui vit de ses souvenirs et qui refuse, sans doute involontairement, de se créer une nouvelle histoire. » (Villeneuve dans Deschamps, Héroux et Villeneuve, p. 218) En dépit de ses innombrables variantes et de son vaste patrimoine transnational et transmédiatique, le mythe de Maria Chapdelaine serait donc porteur d’une interprétation unique ? S’il y a une chose que nous enseigne la mythologie, c’est plutôt que les mythes, en tant que grands récits fondateurs des civilisations, ne possèdent pas qu’une seule lecture, mais, au contraire, jouissent d’interprétations multiples qui savent se renouveler avec le temps.
L’ambivalence du patrimoine, le double fond de l’héritage, la difficulté de se défaire des modèles qui nous ont été légués par les générations antérieures, voilà autant de thèmes qui — les précédents chapitres nous l’ont bien montré — trouvent une place de choix dans l’œuvre de Pilote. Questionné par Marcel Jean (p. 4) sur ses appréhensions quant au fait de porter une nouvelle fois à l’écran une histoire aussi célèbre, ce dernier abondera en ce sens :
Il y a quelque chose de passionnant à raconter une histoire qui l’a été maintes fois. Comme un mythe, une légende, un conte, une blague. Le fait de savoir que plusieurs connaissent déjà l’histoire avant de voir le film me donne des ailes. C’est très libérateur. C’est dire : « Regardez comment je vais vous la raconter, moi, à ma manière. Et peut-être ensuite verrez-vous l’histoire différemment ». Parce que cette simple histoire en raconte plusieurs autres… […] Ce roman est donc une véritable invitation à faire du cinéma. Je dis tout ça, mais j’ai souvent l’impression que les gens connaissent davantage ce qu’on a dit du roman, le mythe autour, que le roman lui-même. J’ai aussi souvent l’impression que ceux qui en parlent ne l’ont pas lu.
Dans le même entretien (p. 5), Pilote reviendra sur l’aspect « mythique » du roman, contre lequel se braquera son adaptation : « Je pense qu’on a tendance à l’oublier, mais ce qu’a fait Louis Hémon, ce sont des portraits, pas des modèles. L’Église catholique et les conservateurs ont donné au roman, à ses personnages, le rôle de modèles à suivre. Ils s’en sont servis en les détournant, en les récupérant, et il est difficile aujourd’hui de lire le roman — et ses personnages — sans passer par ce filtre. Quand je parle de mythe, je veux aussi dire toute l’imagerie autour du roman […], le succès populaire phénoménal qui a donné au roman une “image”. » Après avoir déconstruit l’image de « meilleur vendeur du mois » qui collait à la peau de Marcel depuis quinze ans, montré le malentendu sur lequel est construite la ferme Gagnon et fils, et retiré à Léonie son père héroïque, Pilote utilisera le récit de Hémon pour mettre en scène une nouvelle coupure dans la filiation, où le modèle, une fois éclaté en mille morceaux, laisse sa place au portrait qui nous heurte par sa singularité.
Les métamorphoses
« Lorsqu’on répète par exemple, sans cesse, cette fameuse phrase : “Au pays de Québec rien ne doit mourir et rien ne doit changer”, on oublie que le roman contient une multitude de métamorphoses. On devrait plutôt dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une loi tout à fait naturelle et universelle finalement. Il y a un peu du paradoxe révolutionnaire de Lampedusa et du Guépard dans Maria Chapdelaine. » (Pilote dans Jean, p. 6) Il faut faire éclater le mythe pour retrouver la force vive du texte. Refusant le réservoir d’images et de clichés qui accompagnent le roman depuis sa parution, Pilote sera ainsi en quête de la vérité intrinsèque des protagonistes, qui, comme il l’indique ici, est une vérité mobile, plurielle. Les personnages de Hémon sont tout sauf statiques ou immobiles, mais pris dans un processus de transformation complexe, caisse de résonance du récit.
Rien de plus faux, alors, que de peindre Maria en vierge Marie puis en épouse fidèle, forte d’une résilience toute canadienne-française qui l’encline à rester au pays de ses ancêtres ; faux, également, de ne voir en François qu’un éternel aventurier des bois magiques, en Eutrope un infatigable et honnête cultivateur ou en Lorenzo un amoureux fou de la modernité. Avec Marcel Jean (p. 6-7), Pilote résume ainsi le processus de transformation des principaux personnages du roman :
Il y a la mère qui se met à parler comme le père lorsqu’on attaque leur mode de vie, puis qui, ultimement et fatalement, se transforme en femme de la ville. Il y a le père qui adopte alors les doléances de la mère, ses regrets. Il y a Eutrope qui devient Paradis en affrontant seul la forêt pour aller chercher le curé. Puis Paradis qui promet de se changer en Eutrope, en souhaitant revenir chez lui, avant de disparaître. Puis ce même Paradis disparu qui réapparaît en Innu fantomatique, avec femme et enfant. Il y a Lorenzo, un habitant de la place comme eux, qui revient transformé en ouvrier, en prolétaire. Et évidemment, il y a Maria qui devient la mère, la cheffe de famille.
À lire ces lignes, on comprend que, pour le cinéaste, la transformation est en rapport étroit avec la disparition, puisque c’est cette dernière qui rend visible les métamorphoses. Celles-ci, d’ailleurs, ne concernent pas seulement les personnages, mais aussi le paysage — par le changement des saisons, le travail de la terre et la lutte contre la nature sauvage —, autre protagoniste du film. Par cette série de transformations, petites et grandes, allant de la chute d’un arbre au trou béant laissé par la mort d’un personnage, l’adaptation de Pilote nous invite à trouver le nouveau à même l’identique, la différence à travers la répétition.
« D’abord le silence… Des yeux pleins de jeunesse. Seulement des yeux. Puis, un visage. Celui d’une jeune femme, Maria Chapdelaine. Une jeune fille brune. Elle regarde devant elle. Un regard ardent. Puis, un deuxième visage. Celui d’un jeune homme, François Paradis. Il regarde aussi vers l’avant, vers un troisième visage, celui d’un homme maigre et jeune, le visage d’un curé. Trois visages : elle, lui et le curé. On dirait un mariage. » C’est ainsi que s’ouvre le scénario de Maria Chapdelaine. Déjà, on y retrouve les deux principes évoqués par Pilote pour défendre les spécificités de son adaptation : d’une part, le procédé du portrait (la série de gros plans de visages), d’autre part, le principe de transformation, qui nous empêche de poser un jugement définitif sur une image, un personnage ou une situation. La suite de la scène décrira justement le premier renversement du film : « Nous sommes dans une petite église de bois rustique. Nous entendons le plancher et les bancs qui craquent, des toussotements discrets. Le curé prend une pause en regardant fixement devant lui. Le temps est suspendu. Il semble prendre un élan. Il attend un instant, silencieusement. Et soudainement, il se met à chanter le Ite missa est, brisant ce silence en ouverture. Ce n’est donc pas un mariage, mais la fin de la messe… ». À la fois un début et une fin, un mariage et une messe. Même si, du point de vue strictement narratif, il faudra bien choisir l’un ou l’autre de ces deux embranchements, sur le plan de l’effet produit par le visionnement de l’œuvre, les deux choix restent possibles et coexistants. Dans le film, le procédé sera légèrement simplifié. Avec le premier plan, nous voyons le visage de François (Émile Schneider), les yeux tournés vers la droite du cadre, fixant le hors champ. Le deuxième plan nous montre Maria (Sara Montpetit), levant les yeux et tournant la tête, à la recherche de son promis, qui vient de quitter l’église sans se signer. Non sans ironie, l’adaptation qui accorde le moins de temps d’écran à l’idylle entre Maria et François est également la seule à commencer le récit sur leur histoire. Or, ce que cherche ici Pilote, ce n’est pas tant l’histoire d’amour que la tension entre la présence et l’absence, l’apparition et la disparition.
Sur le plan cinématographique, la force du personnage de François est justement de suggérer sa présence alors même qu’il est absent, jaillissant de sa boîte comme un diable à ressort. C’est d’ailleurs ainsi qu’il refera surface une vingtaine de minutes plus tard : nous ne verrons pas directement son arrivée sur la concession des Chapdelaine, mais nous entendrons sa voix interpeller Tit’bé (Arno Lemay) depuis le hors champ. Interloqué, ce dernier lèvera les yeux pour le chercher du regard, répétant le geste de Maria lors de la première scène. Avec variantes, le procédé sera repris lors des départs et des arrivées de François, personnage mobile par excellence, que l’on ne verra paradoxalement jamais en déplacement. Il en sera de même lors de sa disparition finale. Lorsqu’il prendra le bois malgré la menace d’une imminente tempête de neige, pour rejoindre la famille Chapdelaine, nous le verrons seulement s’approcher de la lisière de la forêt, mais jamais la traverser. Fidèle au texte de Hémon, qui se contente de la narration d’Eutrope pour informer le lecteur, et les Chapdelaine, de la disparition de François, Pilote est le seul cinéaste à faire le choix de ne pas montrer la mort de l’aventurier, qui à nouveau refuse de fixer l’état de ses personnages pour ne pas mettre fin au processus de métamorphose. « Paradis ne meurt pas, il disparaît… Et s’il revient, ce sera sous une autre apparence, transfiguré. J’aime qu’il reste une incertitude, j’aime qu’il puisse demeurer quelque chose d’indéterminé dans la disparition — ou la mort — de Paradis. J’aime que l’on puisse même se dire qu’il n’a jamais existé réellement. C’est un esprit. Une idée. Une invention de Maria. » (Pilote dans Jean, p. 8) Fantasme, fantôme ou esprit, le François Paradis de Pilote n’est plus condamné à incarner une nouvelle fois le symbole de la liberté du coureur des bois dans un monde tiraillé entre le nomadisme et la sédentarité. S’il illustre quelque chose, c’est plutôt la poétique des métamorphoses sur laquelle sont construits le roman et sa nouvelle adaptation. « De ne pas montrer Paradis se perdre en forêt, mais d’utiliser le récit d’Eutrope, c’est possiblement la meilleure idée que j’aie eue pour l’adaptation. Paradis s’écarte du film. On ne le voit plus, mais il est encore là… En suspens », souligne avec justesse le réalisateur (dans Jean, p. 8), qui, en rétrospective, note également la qualité cinématographique de l’écriture de Hémon, qui transpose la mort de son personnage dans une tension entre le visible et l’invisible.
Une force gravitationnelle
« Une sorte d’attraction d’images concentre les images autour de la maison » écrit Bachelard dans La poétique de l’espace (p. 23), qui propose d’« atteindre les vertus premières, celles où se révèle une adhésion, en quelque manière, native à la fonction première d’habiter » (p. 24). Éternel voyageur, Hémon a néanmoins écrit un des grands romans du XXe siècle sur le thème de la maison. Dans Maria Chapdelaine (Hémon), la « maison isolée dans les bois » (p. 24), frêle forteresse contre l’immensité et la violence du territoire, sera donc maintes fois décrite comme le « centre du monde » (p. 90). Or, là où les précédents adaptateurs, en particulier Duvivier et Allégret dont les films ont d’abord été tournés pour le public français, se sont éloignés de la véritable poétique de l’espace du roman afin d’investir le cliché de la « cabane au Canada », Pilote, au contraire, va faire de la maison un personnage à part entière de son adaptation.
Maria Chapdelaine « Le centre du monde »
Maria Chapdelaine
« Le centre du monde »
« Le cœur du film devait être la maison. Avec sa pulsation. Et son centre c’est le poêle qu’il ne faut pas laisser mourir. Tout gravite autour. Les personnages partent, puis y reviennent, comme le mouvement des vagues qui se succèdent. La maison a une force gravitationnelle. Un pouvoir d’attraction. Tout ce qui est autour, je ne le montre pas. Les villes, les villages, les belles paroisses, c’est le hors champ… », note Pilote (dans Jean, p. 5), soulignant par là sa fidélité à la poétique de l’espace du roman. Cet « univers de la maison » (Bachelard, p. 24) et la force attractive qui s’y trouve associée seront par ailleurs exemplifiés dès l’ouverture du film. Après le Ite missa est et le mari...