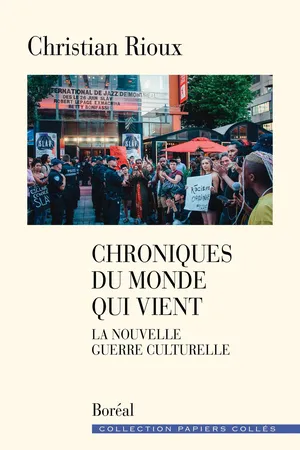![]()
Avant-propos
Même les mots n’existaient pas encore. C’était avant le « racisme systémique » et les « LGBTQ2S+ ». Bien avant les « racisés » et les études « genrées ». Avant « #MeToo » et l’« écriture épicène ». Longtemps avant la « gestation pour autrui » et les « véganes », les « safe spaces » et le « privilège blanc ». Même l’« appropriation culturelle » et la « masculinité toxique », les « couples hétéronormés » et la « cisidentité » n’existaient pas encore. En ces temps reculés les militants n’avaient pas encore inventé leur propre sabir. Ils parlaient encore avec des mots simples, ceux de la langue commune et du dictionnaire.
C’était une autre époque.
Personne ne pouvait imaginer qu’un jour on égorgerait un enseignant en pleine rue pour avoir simplement montré une caricature à ses élèves. Il était encore plus impensable de dire qu’il l’avait cherché. Personne ne pouvait imaginer qu’on puisse brûler des livres, comme on l’a fait dans une bourgade de l’Ontario, et disperser leurs cendres au pied d’un arbre dit de la réconciliation avec les Autochtones. Personne n’aurait cru que des militants pourraient un jour saccager les boutiques de simples bouchers gagnant honnêtement leur vie. Personne n’avait encore songé que, trente ans après l’abolition de l’apartheid et un demi-siècle après la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, la guerre raciale reprendrait et qu’on se déchirerait sur les privilèges de « l’homme blanc ». Personne n’aurait cru que, plus de quarante ans après Les fées ont soif, on puisse censurer des films, des pièces de théâtre, des livres, et condamner des artistes à l’opprobre sur la foi d’accusations ou de simples rumeurs incapables de passer l’épreuve des tribunaux.
Il y a quelques années à peine, une décennie tout au plus, tout cela n’était encore que de la science-fiction. Nous avons changé de monde. Cela s’est fait en douceur, sans crier gare, comme les plaques tectoniques se déplacent imperceptiblement loin des regards humains avant de heurter les fonds marins pour provoquer une lame de fond emportant tout sur son passage.
J’ai longtemps résisté à publier ces chroniques. Comme toutes les chroniques, elles ont été écrites sous l’impulsion du moment. Leur point de départ n’est souvent qu’un mot, une intuition, un détail anodin remarqué dans le flot continu de l’actualité. Écrites dans l’urgence, elles ne prétendent pas à l’exhaustivité. Elles n’étaient pas sitôt publiées qu’il m’arrivait de douter et de me demander si ce qui avait spontanément attiré mon attention méritait qu’on importunât le lecteur occupé à des choses plus urgentes.
Je n’ai consenti à leur publication que lorsque j’ai compris que certaines pourraient aider à mieux mettre en perspective l’étonnante guerre culturelle qui semble aujourd’hui engagée dans les démocraties occidentales. Ainsi qu’on les appelle toujours, pour combien de temps encore ?
Lorsqu’en 2006 l’historien français Olivier Pétré-Grenouilleau fut pris à partie par des organisations antiracistes pour avoir simplement rappelé cette évidence que l’esclavage n’avait été ni le monopole de l’Occident ni un génocide, qui aurait pu croire que nous n’étions qu’au tout début du véritable raz-de-marée antiraciste qui allait déferler sur l’Amérique une décennie plus tard ?
Même chose au Québec, en 2011, lorsque quelques bonnes âmes convaincues de leur supériorité morale s’autorisèrent à censurer la trilogie adaptée de Sophocle par Wajdi Mouawad et intitulée Des femmes, sous prétexte que le chanteur Bertrand Cantat, condamné pour la mort de la comédienne Marie Trintignant, en avait composé et interprété les chœurs. Personne ne se doutait alors qu’un nouvel Index s’abattrait bientôt sur des artistes et des intellectuels aussi différents que Robert Lepage, Woody Allen, Roman Polanski, Sylviane Agacinski ou Claude Meunier, tous soupçonnés d’avoir dérogé à la rectitude politique ou aux bonnes mœurs de leur époque. Même les morts ne sont pas à l’abri, comme les peintres Balthus et Egon Schiele, dont les tableaux ont été décrochés de grands musées. Sans oublier Ovide, auteur des Métamorphoses, jugées trop violentes et sexistes près de deux millénaires après avoir été écrites. Nous n’avions alors nullement conscience que nous n’étions qu’au début d’une longue série d’attentats contre la liberté d’opinion et de création qui prend parfois les allures d’un nouveau maccarthysme.
Lorsqu’en 2014 je relevai qu’un obscur groupe de rappeurs adolescents nommé Dead Obies et connu seulement de quelques aficionados traitait impunément les souverainistes québécois de « suprémacistes blancs », on m’accusa de faire de la publicité à un groupe marginal qui n’en valait pas la peine. Il est vrai qu’on aurait pu croire à une farce, tant le sabir anglicisé de ces jeunes gens pourtant nés sur la Rive-Sud de Montréal était incompréhensible à l’homme de la rue. Qui pouvait imaginer que cette injure empruntée à la sombre histoire du Ku Klux Klan serait bientôt brandie indifféremment dans tous les pays d’Occident tel un bâton de sorcier ou un encensoir destiné à repousser les esprits maléfiques émanant de tous ceux qui osaient encore défendre leur identité nationale ?
Nous n’avions pas encore conscience que nous sortions déjà de cette époque dite de la mondialisation heureuse, pour reprendre le titre emblématique d’un livre d’Alain Minc publié en 1999. Un titre qui à lui seul illustre toute la naïveté de ces années. Après la chute du mur de Berlin, une discussion civique et respectueuse, à mille lieues de la guerre de tranchées d’aujourd’hui, s’était installée dans les pays démocratiques. Des journaux comme Le Devoir et Le Monde, de grandes revues comme Le Débat, en France, ou Prospect, au Royaume-Uni, accueillaient des intellectuels de gauche comme de droite, l’essentiel étant qu’ils fassent avancer le débat et la compréhension du monde. Une gauche réformiste, appelée social-démocratie (ou son pendant chrétien-démocrate dans certains pays), allait alors s’imposer de l’Allemagne au Royaume-Uni, du Québec à la France.
Comme correspondant du Devoir à Paris, comme Nieman Fellow à l’université Harvard et comme simple citoyen vivant entre la France et le Québec, je me suis souvent retrouvé aux premières loges. J’en fus donc un témoin privilégié. C’est la beauté du journalisme que de s’intéresser aux détails, loin des idéologies et de l’esprit de système. On tire un fil sans jamais savoir ce qu’il y aura au bout. Seul le temps le dira.
Et le temps a fini par révéler son secret. Une partie, du moins. Qui aurait dit par exemple qu’en supprimant les frontières pour plaire aux sirènes de la mondialisation, la social-démocratie se suiciderait à petit feu, et qu’au rêve de l’État-providence, de l’école laïque et de l’harmonie entre les peuples succèderaient les rébellions des banlieues françaises, le Brexit, la jacquerie des gilets jaunes, les émeutes antiracistes d’Oakland, le déboulonnage des statues, le retour des empires et l’irruption des partisans de Donald Trump au Capitole en costume de carnaval ?
Cette montée des extrêmes évoque le souvenir d’un autre temps, celui de la lutte des classes. Elle est aujourd’hui bel et bien de retour, mais sous une autre forme. Cette radicalisation est caractérisée à droite par la colère des classes populaires abandonnées à la désindustrialisation, expulsées des villes et de leurs banlieues immédiates, ridiculisées et rejetées par la société du savoir, l’université « woke » et l’univers médiatique. L’actualité aura voulu que j’explore quelques-uns de ces « chemins noirs », pour parodier l’écrivain Sylvain Tesson, des friches industrielles de Florange, en Lorraine, à celles de Clacton, dans l’Essex, sur les bords de la Manche.
À gauche, les nouvelles classes instruites issues de l’université et qui profitent à plein de la mondialisation n’ont pas hésité à revendiquer leur nouveau pouvoir. Pressées de se débarrasser du vieux monde, elles ont ressuscité la vieille tentation totalitaire de l’« homme nouveau », qui prend aujourd’hui la forme d’un antiracisme exacerbé et de réformes sociétales à répétition destinées, comme toujours, à « changer l’homme ». Jamais nos sociétés n’auront été plus égalitaires, rarement auront-elles été moins racistes, nulle part ailleurs les femmes n’auront-elles eu plus de pouvoir et les homosexuels plus de reconnaissance. Or, voilà que c’est dans ce monde revenu de tout qu’on ressuscite les bûchers et les autodafés. La « fin des idéologies » annoncée par Raymond Aron n’aura été que de courte durée.
J’entends déjà les cassandres crier à l’exagération, affirmer qu’il ne s’agit que de « dérapages » insignifiants, que le monde intellectuel n’en est pas à son premier délire extrémiste et que l’université n’a jamais été à court d’utopie.
Et pourtant.
Imaginons qu’en 1974 un jeune militant maoïste fraîchement émoulu de l’université eût adressé une lettre à un grand quotidien français ou québécois pour défendre, disons, la dictature du prolétariat. Le directeur de la publication lui aurait probablement répondu poliment de revoir sa copie en suggérant à l’auteur quelques lectures utiles comme Joseph Kessel, George Orwell et Simon Leys. En 2021, une militante féministe envoie une lettre aux mêmes journaux prêchant, non plus le renversement de la bourgeoisie, une classe arrivée au pouvoir il y a à peine deux cents ou trois cents ans, mais rien de moins que la disparition des sexes, une réalité qui remonte, elle, aux origines mêmes de l’humanité, sinon plus loin encore. Que fait le directeur en question ? Eh bien, il publie le texte en une, fier de se faire le défenseur du « droit de choisir son sexe », une théorie d’un radicalisme anthropologique que les militants les plus radicaux des années 1970 n’auraient jamais pu entrevoir, même dans leurs rêves les plus absurdes.
Cette histoire n’a rien de farfelu. Elle illustre à quel point le nouveau radicalisme qui a envahi l’université, le monde des arts, de la culture et des médias n’a rien à envier à celui d’hier. Les extrémistes de naguère passeraient même pour des enfants de chœur à côté des « born again » de l’antiracisme, des néoféministes qui scandent comme Pauline Harmange « Moi les hommes je les déteste » et des idéologues trans pour qui l’on peut choisir son sexe comme chez le coiffeur on choisit sa couleur de cheveux. Sans compter que malgré tous ses défauts l’extrême gauche de grand-papa, du moins dans nos pays, ne s’est jamais permis de censurer des pièces de théâtre, des films et des sculptures et encore moins de brûler des livres comme cela semble devenu notre lot. Comble de la naïveté, s’il y a une chose que ma génération n’avait jamais imaginé rencontrer un jour, c’est bien la censure.
Cette anecdote illustre surtout l’incroyable faiblesse de nos institutions face à cette offensive multiforme qui, comme toutes les poussées de fièvre totalitaire qui ont marqué le xxe siècle, est évidemment menée au nom du « Bien ». Il faut surtout y voir l’effondrement de l’école et des institutions d’enseignement qui capitulent au premier coup de semonce quand elles ne se prennent pas pour des madrasas du « développement durable » et de la « diversité ». Toutes les compromissions sont bonnes pour ne pas être traité de raciste et voué à la vindicte médiatique par les nouveaux commissaires du peuple.
Quand on ne sait plus distinguer l’« assimilation culturelle » d’un « génocide », une « agression » d’un « viol », les simples préjugés du « racisme », quand on discute de ces réalités complexes avec les mots des analphabètes, tr...