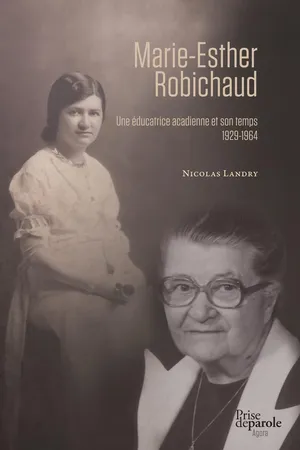![]()
CHAPITRE 1 –
SURVOL HISTORIOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE DE L’ÉDUCATION FRANCOPHONE AU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1836-1955
Bien qu’il y ait beaucoup à dire sur la vaste historiographie de l’éducation acadienne au Nouveau-Brunswick, une étude récente permet d’en saisir les principales composantes. Ainsi, Philippe Volpé rappelle que l’historiographie plus traditionnelle s’intéressa longtemps « à dresser une chronique des grandes réformes en éducation1 ». Il pense alors aux nombreux travaux d’Alcide Godin, durant les années 1980 et 1990. Toutefois, des chercheurs tels Isabelle McKee et Anne Wéry tentent d’aller plus loin et de dépasser le « factuel » et le « descriptif ». Également, le milieu des années 1990 est marqué par l’élaboration d’un important projet dirigé par Jacques-Paul Couturier et Wendy Johnston. Dans ce cas-ci, ces deux chercheurs veulent donner la parole aux « administrateurs intermédiaires, des professeurs, des étudiants / élèves, des collectivités2 ». En termes d’approche, j’aspire à répondre, ne serait-ce que partiellement, aux attentes de Philippe Volpé, soit de mieux « contextualiser » le vécu des enseignant-e-s acadien-ne-s de Gloucester et de mettre davantage l’accent sur « l’élément humain3 ».
Aux provinces maritimes, ce serait à partir de 1838 que les lois permettent progressivement l’embauche des femmes en enseignement. Ces changements s’avèrent nécessaires en raison d’une pénurie d’enseignants masculins, et parce que les femmes acceptent plus facilement de faibles salaires4. De manière générale, les constats historiographiques révèlent que les enseignantes font alors face à un système acceptant d’emblée que ce sont plutôt les hommes qui sont des pédagogues naturels, mais qu’en même temps, elles sont encouragées à devenir enseignantes tout en étant perçues comme étant moins engagées, moins capables et moins qualifiées. Il n’en demeure pas moins qu’un bon nombre de ces femmes repoussent ces préjugés en se forgeant une identité propre à titre d’enseignantes possédant des connaissances rationnelles de professionnelles. Elles sont ainsi confrontées à une contradiction professionnelle : à titre de femmes, elles sont traitées moins sérieusement que leurs collègues masculins si elles démontrent des ambitions féminines : se marier, fonder une famille. En même temps, on les traite avec suspicion si elles se concentrent sur leur carrière, demeurent célibataires et donc sans enfant5.
Durant la première moitié du XXe siècle, le monde scolaire des enseignantes anglosaxonnes et franco-canadiennes est marqué de manière plus large par l’impérialisme britannique, la colonisation, le capitalisme, la religion et le patriarcat gouvernemental. En contrepartie, leur quotidien est également teinté de tensions et de contradictions, quoiqu’elles tentent d’exercer un certain pouvoir et un meilleur contrôle sur leur propre vie6. Cette poussée de féminisation de l’enseignement est largement perceptible entre 1910 et 1930, alors qu’au moins 90% des enseignants du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse sont des femmes7. Il y a une baisse à peine perceptible durant les années 1930, et durant les années 1940, on parle de 85%8.
Autant dans les travaux existants que dans ce livre, certaines caractéristiques collent au profil de l’enseignante rurale typique d’après la Seconde Guerre mondiale : elle est pauvre, injustement traitée, mal rémunérée, victime de congédiement en cas de mariage, soumise à la domination masculine dans les postes administratifs, etc. Bref, face à ce triste constat, comment l’enseignante rurale canadienne peut-elle être autre chose que malheureuse? Dianne M. Hallman pense plutôt qu’en Nouvelle-Écosse, plusieurs enseignantes rurales sont fières du travail bien accompli et ont le désir d’améliorer leurs conditions de travail9.
Qui sont donc ces enseignantes, comme Marie-Esther, qui demeurent célibataires en embrassant une fructueuse carrière en éducation et qui, dans quelques cas, réussissent à se hisser dans la hiérarchie administrative? Par exemple, jusqu’au milieu des années 1940, la plupart des commissions scolaires de la Saskatchewan refusent d’engager des enseignantes mariées et la seule option des femmes qui désirent poursuivre dans l’enseignement est de rester célibataire. Ne jouissant d’aucun précédent, elles doivent affronter la discrimination à l’embauche. Pourtant, ces embûches n’empêchent pas ces femmes célibataires de persévérer en menant de longues carrières et en participant à leurs associations professionnelles. Ces enseignantes se retrouvent donc au premier rang des femmes qui brisent le plafond de verre, en entrant dans des domaines longtemps réservés aux hommes. Et ce, autant au sein de la profession que dans les associations professionnelles10.
Même dans les lointaines provinces de l’Ouest canadien durant les années 1940, le cheminement et le profil de certaines enseignantes s’apparentent de près aux réalités que connaît Marie-Esther à la même époque dans le comté de Gloucester. Deux exemples sont frappants : Ethel Coppinger, en 1945, devient présidente de la Saskatchewan Teacher’s Association. Auparavant, elle a enseigné dans une école à une seule pièce avec une formation de l’École normale. Quant à Marian Scriber, elle devient la première femme surintendante de cette province en 194611.
De plus, à certains égards, cette étude aborde quelques composantes étudiées par Mary Anne Poutanen pour le Québec rural, soit les relations souvent complexes existant entre les maîtres, les parents et les commissaires d’écoles. Elle relate également d’autres problèmes reliés à l’éducation en milieu rural pauvre; le caractère éphémère des maîtres, la pauvreté généralisée, le bas taux de taxe foncière, l’état primitif des écoles à une seule pièce et le conflit entre les exigences saisonnières de l’économie rurale et de l’école12.
ÉVOLUTION DES STRUCTURES SCOLAIRES DURANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Ce qui caractérise l’éducation rurale au Canada au début du XXe siècle se résume à ceci : des écoles à une seule pièce avec une seule enseignante ou un seul enseignant face à des élèves de tous âges et de niveaux académiques variés. En 1900, rappelons que la fréquentation scolaire est plutôt irrégulière en milieu rural en raison de l’éloignement, des pauvres conditions des routes et du froid13. Au Nouveau-Brunswick, la loi sur la fréquentation scolaire obligatoire de 1906 ne s’applique pas forcément de la même manière pour tous : « tandis que les enfants de 6 à 14 ans des villes sont soumis à l’obligation scolaire, seuls les enfants de 7 à 12 ans des districts ruraux devaient être présents en classe un certain nombre de jours par an14 ».
Les francophones, eux, voient les premiers livres de lecture français apparaître entre 1876 et 1907. Pour une trentaine d’années, les élèves disposent de seulement quatre livres de lecture au primaire. À partir de 1922, l’inspecteur Charles D. Hébert15, avec l’aide de Théodule Lejeune16, alors instituteur et lui-même futur inspecteur d’écoles, réussit à faire adopter quelques manuels supplémentaires, parfois en français, parfois bilingues. Dans les écoles à deux classes s’impose le nouveau livre bilingue d’Ollendorf, destiné à enseigner l’anglais aux élèves francophones. On y ajoute progressivement trois manuels de grammaire française17.
Du côté du gouvernement fédéral en 1913 débute les travaux de la Commission royale d’enquête Industrial and Technical Education. Les conclusions de cette commission vantent les bienfaits de l’éducation manuelle et de la consolidation scolaire. C’est l’époque où, en Amérique du Nord, l’école élémentaire est en mutation vers le concept de la New Education favorisant une approche pédagogique plus pratique et pertinente. Cela implique la promotion du travail manuel, de l’étude des sciences sociales et de l’exploitation de jardins scolaires, sans oublier l’éducation physique18.
Les réalités vécues par les communautés minoritaires en Acadie du Nouveau-Brunswick s’appliquent aussi à l’Ontario. Tel que l’explique Jean-Philippe Croteau, l’Ontario « obéit à une logique majoritaire qui reflète la volonté du groupe prépondérant, les protestants, en accordant la primauté aux écoles publiques qui disposent à la fois de la reconnaissance politique et de l’accès aux ressources financières ». Les catholiques doivent donc se rabattre sur les écoles secondaires privées, œuvre de l’Église catholique et des congrégations religieuses19. Dans cette province, encore en 1919, au moins 80% des jeunes ne fréquentent pas l’école secondaire une fois l’élémentaire terminé. Il s’en suit, en 1921, l’adoption de la loi Adolescent School Attendance Act20. Au Québec c’est tout le contraire, alors que les institutions privées catholiques remplissent les besoins en éducation des catholiques francophones comme nulle part ailleurs au pays. C’est ce qui explique pourquoi le gouvernement se préoccupe peu d’assurer un financement adéquat aux écoles publiques, et encore moins d’organiser un système d’écoles secondaires durant les années 192021. Au Nouveau-Brunswick, en 1928, le règlement 32 « reconnaît la légalité de l’enseignement du français à tous les niveaux dans les écoles publiques, mais a dû être retiré à la suite de pressions provenant des orangistes22 ».
Rappelons que vers la fin des années 1920, le nombre d’écoles à une seule pièce aux Maritimes dépasse 5000! Les plus anciennes datent de la fin du XIXe siècle. En 1920 au Nouveau-Brunswick, il n’y a que quatre écoles consolidées. Les petites écoles à une seule pièce, largement plus nombreuses, sont généralement faites en bois, peintes en blanc et recouvertes de bardeaux ou de planches23. L’intérieur de celle de Pointe-Brûlée, près de Shippagan, est en bois et peinte en vert. Au centre de la classe, le poêle occupe la place d’honneur. En 1942, sa dernière année d’opération, il y a trois rangées de pupitres24.
En 1932, toujours au Nouveau-Brunswick, la Commission McFarlane s’entend sur une clause portant sur l’enseignement en français :
Que les livres prescrits dans les deux premières années soient unilingues français pour les enfants dont le français est la langue maternelle. Les autres textes seraient bilingues jusqu’au niveau 8. Les étudiants devraient pouvoir rédiger l’examen d’entrée au High School en français, même si les questions sont posées en anglais25.
Cette commission propose également « d’unifier le système scolaire en finançant l’instruction selon un taux de taxation uniforme à l’échelle de la province en imposant en retour des normes de fonctionnement aux écoles ». Il s’agissait donc de garantir des conditions d’enseignement et d’apprentissage accessibles à tous les enfants de la province, peu importe les moyens financiers des communautés locales26. De plus, toutes les écoles offrant les cours des années 9, 10 et 11 porteront désormais le nom de High School27. De cette manière, l’enseignement du niveau secondaire fait son entrée en milieu rural par le biais de ces nouvelles écoles régionales. Ces nouvelles infrastructures sont ainsi destinées à devenir le lieu de prédilection de la grande majorité des activités socioculturelles. On y trouve une bibliothèque, un gymnase, une cafétéria en plus de locaux disponibles aux élèves en journée et aux adultes le soir. Bref, un lieu de « récréation et d’éducation permanente de toute la communauté28 ». On sait toutefois que ces recommandations n’entrent en vigueur qu’au début des années 1940, à cause du lobbying exercé par les orangistes et en raison de la crise économique de 1929-193929.
Il ne faut guère se surprendre que la province cherche à revitaliser et à moderniser son système d’éducation. À l’époque, en pleine crise économique, les écoles rurales font face à une véritable hécatombe financière. Les taxes scolaires varient de 7$ à 75$ pour chaque 100$ d’évaluation. Des écarts tout aussi flagrants existent dans la qualité de l’éducation, résultant de l...