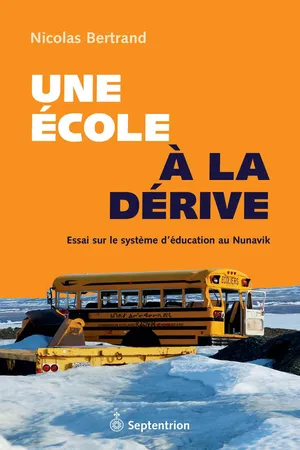chapitre 1
Un suppléant désemparé
Un bref aperçu de l’organisation de l’école au Nunavik
Bien que le Nunavik s’étende sur un vaste territoire, dont la superficie équivaut à peu près à celle de l’Espagne, la région ne compte que 14 villages, tous côtiers et isolés les uns des autres. En 2011, sa population globale s’établissait à 12 000 habitants, dont l’immense majorité est d’origine inuite.
Étant donné la faible population des villages, qui oscille entre quelques centaines et quelques milliers d’habitants, l’école regroupe généralement sous un même toit l’ensemble des élèves, de la maternelle à la cinquième année du secondaire. Seuls les deux villages les plus peuplés du Nunavik, Kuujjuaq et Puvirnituq, ont deux écoles, l’une primaire et l’autre accueillant des élèves du primaire et du secondaire. À Kangirsuk, ce sont 160 élèves qui fréquentent l’école Sautjuit, soit le tiers de la population du village. Cette très grande proportion d’enfants est représentative du Nunavik, où la population est jeune et en hausse constante depuis la sédentarisation des Inuits, au milieu du siècle dernier.
Une photo de l’école Sautjuit, prise depuis la rivière Arnaud, à marée basse. Photo de Nicolas Bertrand.
De la maternelle à la deuxième année du primaire, l’enseignement se fait exclusivement en inuktitut, l’enseignement en français (ou en anglais, selon ce que décident les parents) débutant en troisième année du primaire, à demi-temps, avant de devenir la principale langue d’enseignement l’année suivante. À partir de ce moment, la langue inuite est enseignée comme une matière complémentaire, à raison d’une période par jour. Le cursus comprend également une septième année au primaire, ce qui signifie que les élèves inuits, comparativement à ceux du reste du Québec, ont une année supplémentaire à compléter avant d’obtenir leur diplôme secondaire. En outre, ces diplômés doivent réussir un test linguistique (en anglais ou en français) qui déterminera s’ils sont aptes à poursuivre leurs études collégiales immédiatement. S’ils échouent ce test, ils doivent alors suivre une année de préparation postsecondaire, laquelle est offerte dans un seul village de la région.
Ce long chemin vers des études supérieures, rares sont les Inuits du Nunavik qui parviennent à le gravir avec succès. Ce sont ainsi 22 % des Nunavimmiut (les Inuits du Nunavik) âgés de 15 ans et plus qui détiennent un diplôme d’études secondaires, alors que dans le reste du Québec, ce pourcentage est de 68 %. Certes, la situation s’améliore de génération en génération, mais, pour l’instant, bien peu d’Inuits du Québec terminent leur secondaire, et encore moins des études collégiales ou universitaires.
Loin d’être unique au Nunavik, cet échec de l’école formelle est un phénomène très répandu dans l’Arctique canadien – comme dans bien des communautés autochtones du pays. Selon le recensement de 2006, 51 % de la population inuite canadienne âgée de 25 à 64 ans n’avait pas complété son secondaire. Si cette statistique doit être relativisée, dans la mesure où les premières écoles nordiques ont fait leur apparition autour de 1950, il reste que seulement 36 % des Inuits ont un grade ou un diplôme postsecondaire, comparativement à 61 % de la population canadienne non autochtone.
Comment expliquer un si faible taux de réussite scolaire qui, à terme, entrave les perspectives d’avenir de la jeunesse inuite ? Le problème, on s’en doute bien, dépasse le simple cadre scolaire et étend ses ramifications dans plusieurs sphères de la vie sociale, économique et culturelle. Le manque de confiance de nombreux Inuits à l’égard de l’institution scolaire, de profondes différences culturelles dans la manière de concevoir l’éducation, les graves problèmes sociaux qui affectent les communautés et, finalement, l’angoisse identitaire vécue par plusieurs Inuits sont toutes des causes plausibles des difficultés scolaires des Inuits. De plus, à Kangirsuk en tout cas, la désorganisation, voire la confusion qui régnait parfois dans la gestion quotidienne de l’école, concourait également à son dysfonctionnement.
Une offre d’emploi inattendue
Dès le lendemain de mon arrivée à Kangirsuk, à la mi-août 2010, je me suis mis à travailler à l’école Sautjuit. Pendant les deux premiers jours, j’ai aidé ma compagne et quelques enseignantes à ranger leur classe, en prévision de la rentrée. Il y avait fort à faire, car des dizaines de boîtes s’empilaient au milieu des locaux et jusque dans le corridor, tandis que dans les armoires et les bibliothèques des classes, on retrouvait beaucoup de matériel désuet, qui semblait inutilisé depuis des lustres. Un grand ménage s’imposait, comme si personne n’avait osé ou voulu le faire ces 20 dernières années. En ce début d’année scolaire, ce sont des dizaines de vieux livres, de manuels et de cahiers d’exercices qui sont transportés à la décharge du village (que les Inuits appellent communément le Canadian Tire, étant donné tout ce qu’il est possible d’y trouver), où ils seront éventuellement brûlés.
À ma grande surprise, au troisième jour de cette première semaine, on m’embauche comme remplaçant au secondaire, même si je n’ai pas du tout les compétences requises pour m’acquitter de cette difficile tâche. Certes, j’avais enseigné la philosophie au collégial durant quelques années, mais je doutais fort qu’une telle expérience puisse m’être d’une quelconque utilité dans mes nouvelles fonctions.
Le professeur attitré s’étant désisté à la dernière minute, il fallait le remplacer au plus vite. Vu les circonstances, ce n’était pas là une mince affaire, puisque les classes débutaient la semaine suivante, ce qui laissait croire que la majorité des enseignants inscrits sur la liste de rappel de la Commission scolaire Kativik ne seraient plus disponibles ou disposés à accepter un tel poste. Avant de trouver une personne qualifiée et prête à tout abandonner, sur-le-champ, pour venir enseigner dans un village isolé du Nord du Québec, et en comptant le temps nécessaire pour organiser ce déménagement, je pouvais raisonnablement m’attendre à enseigner au minimum pendant un mois ou deux. Et, à supposer que personne ne se porte volontaire, il n’était pas exclu que les élèves me souffrent toute l’année.
Me sentant investi d’une responsabilité certaine par rapport à leur éducation, tout en entretenant de sérieux doutes quant à mes qualités de pédagogue et quant à ma capacité de faire régner un semblant de discipline en classe, je m’empresse de partager mes réserves à la directrice de l’école, qui a tôt fait de me rassurer. En toute franchise, elle m’avoue que ma plus grande utilité sera de permettre aux élèves de se rendre à l’école en début d’année scolaire, plutôt que se voir contraints de manquer un nombre considérable de cours. Pour le reste, il s’agit de faire mon possible, et advienne que pourra. Débordée, elle me consacre encore quelques minutes, le temps de me montrer mon local de classe et de me donner quelques vagues directives, puis elle m’abandonne à mes scrupules.
Laissé à moi-même, seul devant le fouillis de boîtes entassées pêle-mêle, je tente tant bien que mal de mettre de l’ordre dans le matériel et dans mes idées. J’ai à ma disposition deux journées pédagogiques pour faire le ménage dans les manuels obsolètes ou inadaptés qui abondent, pour prendre connaissance du programme de la commission scolaire en français, en sciences humaines et en arts (les trois matières que je suis censé enseigner), enfin pour essayer de cerner un peu les aptitudes des élèves et ce qu’ils ont accompli au cours des dernières années.
Ne sachant par où commencer, je gaspille un temps précieux à feuilleter l’épais cartable du programme de français, à la recherche d’informations susceptibles de m’aider à mieux comprendre ce qu’on attend de moi. La commission scolaire, dans un jargon qui ne m’est pas toujours compréhensible, m’enjoint d’enseigner à peu près toutes les notions élémentaires de la langue, de l’emploi de la virgule et de la majuscule aux diverses sortes d’adjectifs, en passant par la conjugaison et les règles de grammaire. Quant au programme en sciences humaines, j’en débusque des fragments qui datent des années 1990, que je juge rébarbatifs et mal conçus. Finalement, je ne trouve aucune trace de ce que je dois faire en arts, le programme étant apparemment laissé à mon entière discrétion.
Je constate aussi, en continuant mes recherches, que les plus jeunes élèves ont travaillé, l’année précédente, à partir d’un manuel d’apprentissage du français langue seconde conçu pour la cinquième année du primaire, alors qu’ils étaient en secondaire un ou deux. Sur le coup, je ne réalise pas que ces élèves n’ont eu que quatre ans et demi de scolarisation en français.
Une note laissée par l’enseignante qui m’a précédé précise que « beaucoup d’adaptation du matériel a été nécessaire ». En examinant de plus près ces manuels, ainsi que les cahiers Canada utilisés par les élèves et laissés dans la classe, je m’aperçois en outre que rares sont ceux qui semblent avoir été assidus à la tâche. J’évalue sommairement, à partir de ces quelques documents, la qualité générale du français des élèves, qui me paraît passablement faible. On m’avait déjà averti de cet état de choses, qui m’est confirmé lorsque j’ouvre les trois tiroirs métalliques du classeur de la classe. Pleins à craquer, ils contiennent de nombreux manuels rangés dans des chemises sur lesquelles on a indiqué à quelle matière ou notion ils se rapportent. Sur leurs couvertures plastifiées, on retrouve des dessins enfantins, car ces ouvrages sont destinés à des élèves de la troisième à la sixième année du primaire. Or, sur chacune de ces couvertures, on a pris soin d’apposer une étiquette qui indique que ces manuels s’adressent bel et bien à des élèves du secondaire.
Ces informations que je débusque, bien qu’éclairantes, me donnent pourtant peu d’indications sur la manière de procéder d’heure en heure, de jour en jour. Confus, je parviens mal à planifier quoi que ce soit de concret, mon cerveau se révélant incapable de se mettre convenablement en marche. Mais comment allais-je donc m’y prendre pour favoriser chez mes élèves un quelconque apprentissage ? Serais-je seulement à la hauteur ? En toute franchise, je dois admettre que les élèves qui m’ont été confiés, soit des jeunes de toutes les années du secondaire, ont découvert à la rentrée un succédané de professeur très mal préparé. Malheureusement pour eux et, dans une moindre mesure, pour moi, ces élèves ont eu à souffrir mon incompétence pendant un certain temps, même si elle n’explique pas, à elle seule, l’apathie générale dans laquelle ces adolescents se vautraient, dans cette école tout sauf « normale ».
L’école du laisser-faire
Cinq semaines après la rentrée, la Commission scolaire Kativik est finalement parvenue à engager une véritable enseignante (soit l’amie de l’orthopédagogue du primaire). J’ai toutefois repris du service deux semaines plus tard, quand un professeur est tombé malade et s’est absenté pendant un mois. Cette fois, j’ai agi comme professeur d’arts tant du côté anglophone que francophone, en plus de fournir une aide individuelle à des élèves en cheminement particulier, un euphémisme pour désigner des jeunes en difficulté, incapables de suivre, pour une raison ou une autre, le cursus scolaire habituel. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, j’ai continué de suppléer au manque d’effectifs de temps à autre, en remplaçant notamment, quelques jours durant, le professeur de mathématiques et de sciences lorsque ce dernier a pris la place de la directrice, partie en formation à Montréal. Au début de l’année scolaire suivante, j’ai aussi tenté d’enseigner aux plus petits les rudiments du français ou de l’anglais – avec des résultats pitoyables.
Mon séjour à l’école Sautjuit, quoique relativement bref, a été amplement suffisant pour constater son profond dysfonctionnement, en particulier celui de l’école secondaire, bien que le secteur primaire ait lui aussi son lot de problèmes. Trop souvent, cette école se révèle incapable de remplir son rôle éducatif premier, qui est d’inculquer de nouveaux savoirs et compétences aux élèves dont elle a la charge. Cela est particulièrement vrai chez les adolescents, pour qui elle est un important lieu de socialisation, mais rarement un lieu d’apprentissage. Il en résulte un retard scolaire qui se creuse au fil des ans, lequel rend la persévérance scolaire de plus en plus difficile.
Si les jeunes apprennent peu de choses à l’école Sautjuit, c’est d’abord parce qu’ils n’y viennent pas. Le taux d’absentéisme y est en effet endémique, parce que les absences ne sont pas punies et ne portent généralement pas à conséquence. Évidemment, quand on est adolescent, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas aller à l’école. Ainsi, il n’est pas rare de constater, en plein après-midi, que la caissière de la coop est une élève de 14 ou 15 ans, ou encore que des élèves (du primaire et du secondaire) traînent dans le magasin ou s’achètent des bonbons ou du coke. On se demande alors à quoi peut bien servir l’écriteau placé à côté de la porte, qui stipule que les élèves de l’école ne seront pas servis durant les heures de classe… On peut aussi s’absenter pour rendre visite à de la famille dans un autre village, pour aller magasiner à Montréal ou encore pour assister à un congrès religieux, par exemple. Mais pour la plupart des adeptes de l’école buissonnière, il suffit simplement de ne pas avoir envie de se présenter à l’école pour que ce souhait devienne réalité. Cet absentéisme, qui peut atteindre chez certains, au cours d’une étape, des proportions d’une journée d’absence sur deux (par exemple, 30 à 35 jours d’absence sur une soixantaine de jours d’école) est sans surprise plus marqué au secondaire, bien qu’on trouve des cas semblables dans les classes du primaire.
Gérer les retards fait aussi partie du quotidien des professeurs de l’école Sautjuit, car les élèves qui se présentent en classe ne se sentent pas tenus d’y arriver à l’heure. Pourquoi seraient-ils ponctuels, d’ailleurs, quand leurs camarades ne le sont pas, et quand leur retard n’est jama...