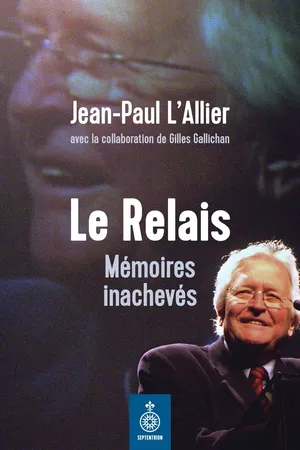![]()
CHAPITRE 1
L’enfance (1938-1951)
Mes parents sont originaires de Saint-Augustin de Deux-Montagnes, village fondé en 1855 qui s’est fusionné à Sainte-Scholastique en 1971, avant son changement de nom pour celui de Mirabel deux ans plus tard.
Mon grand-père maternel était cultivateur à Saint-Augustin. Ma mère, Georgette Duquette, née en 1916, était l’aînée d’une famille de onze enfants. Mon grand-père paternel, quant à lui, était boulanger et menuisier dans ce même village. Mon père, Paul L’Allier (1909-1965), était le plus jeune enfant de sa famille. Comme son père, il est devenu boulanger et il avait aussi du talent pour travailler le bois.
Mes parents avaient eu la chance de faire des études en fréquentant une école de rang, comme il y en avait dans plusieurs campagnes du Québec au début du xxe siècle. Ils n’étaient pas instruits au-delà de la moyenne des jeunes de leur temps. Mais, s’ils n’étaient pas instruits, ils avaient de l’éducation et vivaient « les valeurs » chrétiennes avec une certaine peur de l’enfer, plus que par conviction profonde, je pense.
À six ans, ma mère, aînée de la famille, avait fréquenté l’école de rang « du Petit Chicot » à Saint-Augustin où sont aussi allés ses dix frères et sœurs qui l’ont suivie. Les écoles de rang étaient à deux ou trois niveaux d’enseignement et mixtes, bien évidemment. L’institutrice (parce que c’étaient des femmes qui y enseignaient) enseignait à un groupe pendant que les autres devaient apprendre aux enfants l’écriture, le calcul et d’autres connaissances essentielles à la vie quotidienne. Les institutrices d’alors habitaient souvent dans une maison-école. Elles étaient engagées par des commissions scolaires aux ressources plus que limitées et elles travaillaient dans de pénibles conditions pour des salaires de misère. Elles réussissaient pourtant à transmettre à leurs élèves les connaissances de base du cours primaire et, surtout, la valeur fondamentale de l’éducation.
* * *
Les L’Allier d’Amérique
L’ancêtre des L’Allier d’Amérique s’appelait Jean Lallier et était originaire de Rivarennes, diocèse de Bourges dans le Berry. Son père se nommait Denys Lallier et sa mère, Catherine Gaucher.
Établi en Nouvelle-France, Jean Lallier épouse Marguerite Paquin à Saint-Pierre de Deschambault le 5 octobre 1750. Il pratique le métier de forgeron dans le village de Cap-Santé (Portneuf). Il est décédé dans ce village en 1807, à l’âge d’environ quatre-vingt-trois ans.
Les L’Allier se sont établis dans plusieurs régions du Québec, dont celles de Saint-Pierre-les-Becquets et Bécancour (Centre-du-Québec), de Montréal et de Terrebonne où ont vécu les ancêtres de Jean-Paul L’Allier.
Notons qu’au xve siècle, un Michel de Lallier fut prévôt des marchands de Paris, ce qui correspondait, à l’époque, à la fonction de maire de la Ville. Sa statue orne aujourd’hui la façade de l’hôtel de ville de Paris.
* * *
Ma mère a fait ainsi sa 5e année, mon père, sa 4e. Maman avait une belle calligraphie penchée, comme les femmes de sa génération, et elle écrivait sans fautes. Papa, lui, faisait quelques fautes d’orthographe, toujours les mêmes ; quand on le lui faisait remarquer, au fil de nos propres études, il continuait à écrire dans son petit calepin de vente noir : « pin », au lieu de « pain », en nous disant « je me comprends ».
Maman devait aller à pied à son école. Elle nous racontait tout simplement que, comme beaucoup d’autres enfants de cultivateurs, elle y allait pieds nus, les bottines à la main, à l’automne et au printemps. Ce n’était qu’une fois rendue à l’école qu’elle les enfilait, évitant ainsi de les user pour qu’elles puissent servir à ses sœurs plus jeunes, le moment venu. Ce n’était pas la pauvreté, mais l’austérité !
Au début du xxe siècle, l’économie de la ferme était essentiellement basée sur le troc, peu sur l’argent. Les grains cultivés étaient apportés au moulin et le meunier en prélevait une partie convenue pour se payer ; il revendait sa mouture lors des jours de marché, à Sainte-Thérèse. C’était la même chose pour le bois coupé durant l’hiver par les cultivateurs sur leurs terres. Ils transportaient les billots dans de grands traîneaux tirés par deux chevaux afin de les vendre au moulin à scie ou de les faire débiter en planches, pour leurs propres besoins.
Un jour, j’ai demandé à mon grand-père combien il se faisait d’argent comme cultivateur dans une année. Surpris de cette question, il me dit qu’il ne vendait pas au village, mais plutôt une fois par semaine et en saison sur la rue du Marché, à Sainte-Thérèse de Blainville, des légumes, de la saucisse, des œufs frais, de la crème et du beurre. C’était normal, pour l’époque. C’est cet argent qui servait à acheter ce qu’il ne pouvait pas échanger ou produire. Ma grand-mère fabriquait la plupart des vêtements, et mon grand-père fabriquait les souliers de bœuf. Il est mort dans sa centième année, vieux, mais pas malade, lui avait dit le docteur.
Quant à mon père, il était le plus jeune d’une famille de six enfants, quatre garçons et deux filles ; leur père, Zénon, était le boulanger du village. À cette époque, un seul métier n’était pas suffisant pour faire vivre sa famille et sûrement pas celui de boulanger, car la plupart des familles faisaient elles-mêmes leur pain à la maison. Comme il était aussi habile de ses mains en menuiserie, il fabriquait des manches pour hache, des fenêtres, des brouettes et d’autres objets en bois qu’il vendait au village. Il avait la réputation d’être un habile menuisier. Il a construit sa maison ainsi que celle de son fils, Albert, qui finissait ses études en médecine à Laval.
Jean-Paul, alors âgé de deux ans, dans les bras de son père au bord du Lac des Deux-Montagnes en 1940. (Collection privée)
Piastre par piastre, il a donc réussi à « payer un cours classique » au séminaire de Sainte-Thérèse à ses deux aînés, mes oncles, qui sont devenus médecins. Une des filles restait avec lui pour s’occuper de la maison, car il était veuf (mon père avait dix ans quand il a perdu sa mère), l’autre, Éliane, avait étudié à l’École normale et était institutrice-résidente à l’école de rang de Mirabel. Elle y enseignait, elle y habitait et s’occupait de la chauffer. Papa était le benjamin de la famille. Je ne sais pas s’il aurait aimé faire des études comme ses deux frères médecins. Il n’en a jamais parlé. J’ai cependant, comme mes frères je pense, perçu assez tôt que sa fierté était de nous donner ce qu’il n’avait pas reçu.
Après leur mariage en 1937, mon père et ma mère se sont installés à Hudson, sur la rive droite de la rivière des Outaouais, dans le comté de Vaudreuil, un village qui comptait alors environ 1 200 habitants. Mon grand-père lui avait acheté ou construit, je ne sais pas exactement, une boulangerie à Hudson ; ce qui explique que je sois né à Hudson, comme mon frère Claude.
Mes parents se sentaient étrangers à ce milieu essentiellement anglophone, mais pas vraiment bilingue. Ceux qui parlaient les deux langues, par besoin, étaient les Canadiens français. Mes parents ne connaissaient pas l’anglais ; ce n’était pas leur « monde ». Ils ont donc vendu la boulangerie d’Hudson, sont revenus à Saint-Augustin, papa travaillant pour son frère à la boulangerie qui avait été celle de son père. Trois ans plus tard, ils achetaient l’une des deux boulangeries de Sainte-Scholastique, la boulangerie Pressault, et s’y installèrent pour plus de vingt ans. C’est là, pour l’essentiel, que je considère avoir vécu mon enfance. J’y ai passé ma jeunesse avec mes trois frères, Claude, Pierre et François. C’est donc essentiellement à Sainte-Scholastique que je trouve mes racines.
Mon premier souvenir conscient, en dehors de ceux que nous rappellent les vieilles photographies et les histoires racontées par les parents et la famille, est très précis. C’est le jour de la fin de la Seconde Guerre mondiale en mai 1945. J’avais presque sept ans, je fréquentais alors le collège Sainte-Anne, dirigé par les Frères de l’instruction chrétienne. À la sortie des classes, en fin d’avant-midi, les frères nous dirent que la guerre est terminée. À sept ans, cela ne veut pas dire grand-chose. Les cloches sonnaient à toute volée à l’église du village beaucoup plus longtemps que pour les messes et les cérémonies des autres jours. Pendant ce temps, je rentrais à la maison pour le repas du midi. J’allais profiter du congé imprévu qu’on venait de nous accorder pour le reste de la journée, afin précisément de célébrer la fin de la guerre.
* * *
De Sainte-Scholastique à Mirabel
Avant de devenir un problème pourri et probablement un des plus grands scandales de mauvaise administration politique […] Mirabel était un magnifique projet d’avenir qui devait donner à la région de Montréal une impulsion considérable dans son développement économique et lui conserver son rang de métropole canadienne. Mais avant d’être un projet grandiose, c’était un beau et bon territoire agricole où les cultivateurs et les fermiers, à quelques dizaines de kilomètres de Montréal, amorçaient la mutation d’une exploitation traditionnelle de fermage et d’élevage à une exploitation moderne de cultures spécialisées.
Je suis de Mirabel, j’y suis né et j’y ai vécu jusqu’à l’âge de l’université. Mon père y était boulanger et, avec lui, autant qu’avec mes copains de village, j’ai parcouru ce territoire, ces champs et ces ér...