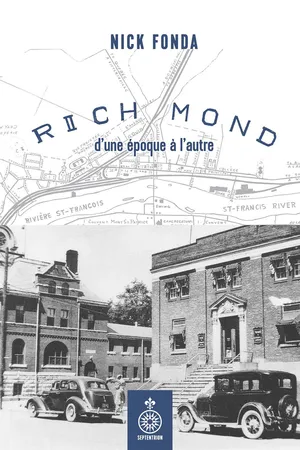![]()
CHAPITRE 1
Une ville en eaux troubles
La ville de Richmond telle qu’on la retrouve aujourd’hui est à la fois plus grande et plus petite qu’elle ne le fut par le passé. Constituée en 1882, Richmond était alors délimitée à l’ouest par la Saint-François tandis que la municipalité rurale de Cleveland circonscrivait ses trois autres côtés. Le 29 janvier 1999, elle s’agrandit du tiers en annexant Melbourne qui, pour un temps, fut son village voisin le plus prospère : constitué avant Richmond, il comptait à un certain moment plus de citoyens que cette dernière municipalité. Plus récemment, Richmond s’est étendue quelque peu afin de mieux répondre aux besoins de son parc industriel ; la Ville a en effet obtenu de Cleveland, par transaction monétaire ou échange de terrains, des parcelles de quelques douzaines d’acres de terres contiguës.
Les frontières qui délimitent la ville de Richmond forment un polygone irrégulier possédant son lot d’angles aigus et par ailleurs inexplicables. Sur le terrain, où ces lignes droites cartographiques sont invisibles, le résultat n’est pas sans étrangeté ni paradoxes. Parmi ces incongruités, notons que l’école secondaire régionale de Richmond, construite en 1968, repose maladroitement sur les limites de la ville : son bâtiment et ses terrains de soccer sont nettement scindés. Autre particularité, on retrouve des champs et des pâturages à l’intérieur même des frontières nord et sud de la ville.
La Ville de Richmond détient également ce que l’on pourrait désigner comme des lots de terres extraterritoriales. Le cimetière Sainte-Anne illustre bien ce fait : situé dans le canton de Cleveland, il dépend de la juridiction de Richmond. Autre exemple significatif, l’approvisionnement en eau de la ville provient d’un puits nouvellement foré à quelques kilomètres en amont sur le territoire de Cleveland, alors que sa station d’épuration se retrouve en aval, encore une fois à Cleveland, mais sur des parcelles de terres appartenant à Richmond. (À un certain moment, la ville possédait un barrage situé quelque trente kilomètres plus loin, au lac Brompton, qui servait à contrôler le niveau d’eau de la rivière au Saumon, la source d’eau potable de Richmond à cette époque.)
Confinée à un petit territoire (sept kilomètres carrés), la population de Richmond, aujourd’hui d’environ trois mille deux cents habitants, en compta déjà jusqu’à cinq mille, un chiffre atteint alors que régnaient des conditions économiques différentes et que le nombre d’enfants par famille était bien supérieur à ce qu’il est de nos jours.
En 2017, année du cent cinquantième anniversaire du Canada, le budget annuel de Richmond s’approchait de cinq millions de dollars, une somme utilisée pour assurer l’entretien et la réfection des routes, le déneigement, le traitement des eaux, la collecte des ordures et le fonctionnement du service de police, ainsi que pour accompagner financièrement, à différents degrés, divers organismes à but non lucratif telles la ligue de soccer mineur et la popote roulante.
À l’instar de ce qui se passe fréquemment dans les petits appareils gouvernementaux, les administrateurs municipaux peinent à accomplir tout le nécessaire avec l’argent dont ils disposent alors que les propriétaires sont rebutés par leur avis d’imposition. En ce qui concerne Richmond, les plaintes provenant des deux côtés sont justifiées. Ces dernières années, la Ville a reçu – et reçoit encore aujourd’hui – une péréquation annuelle, c’est-à-dire un réajustement monétaire versé par le gouvernement provincial aux villes reconnues comme étant défavorisées.
À Richmond, la rue Principale, l’artère majeure du centre-ville, s’avère une vision éloquente de ce statut de milieu défavorisé.
À vol d’oiseau, ou à partir de ces petits aéronefs que l’on peut parfois apercevoir sillonnant le ciel au-dessus de la ville par une journée claire et ensoleillée d’été, Richmond présente l’aspect d’une courtepointe jetée négligemment, mais néanmoins réconfortante : toitures, cimes d’arbres, quelques piscines à l’eau d’un bleu étincelant. Puis, brusquement, cet éclat fait place à la grisaille et à l’aridité : des toits goudronnés, des bandes et des carrés de bitume, un no man’s land inhospitalier. L’instant d’après, la courtepointe réapparaît, bien que pour un court instant. La ville s’évanouit ensuite, s’abandonnant à la rivière qui poursuit son cours, traversant champs et forêts, entrecoupée de routes et de chemins de fer, et parsemée d’habitats humains.
Lorsqu’on s’y balade à pied ou en voiture, le coup d’œil de la rue Principale est moins saisissant. Le centre-ville demeure peu attrayant. À l’extrémité sud se trouve un gigantesque magasin d’alimentation dont le revêtement entier est fait de métal ondulé ; la vue de cette boîte métallique est d’une troublante similitude avec le spectacle offert par le passage des wagons de marchandise roulant à une trentaine de mètres plus loin sur la voie ferrée. Peu de temps après sa construction, il y a une dizaine d’années, le bâtiment se mérita le triste honneur d’être désigné l’immeuble le plus laid au Québec. Mais cette chaîne d’alimentation (et son architecture inexorablement bon marché) fut retenue parmi les autres chaînes en lice parce qu’elle promettait les meilleurs prix, prix susceptibles de mieux convenir à la population desservie.
La péréquation accordée à Richmond n’est pas attribuable à une pauvreté récente. Celle-ci est présente dans la ville depuis longtemps, sinon depuis le commencement. Il est plutôt rare dans l’histoire humaine que l’enrichissement d’un individu ou d’un groupe n’entraîne pas l’appauvrissement des autres. Au tout début de Richmond, et même avant, des regroupements bénévoles, généralement chapeautés par les communautés religieuses, s’efforçaient de procurer aux moins fortunés le nécessaire pour assurer leur subsistance. Aujourd’hui, la Ville s’emploie, aussi bien qu’elle le peut, à prêter main-forte à ce pourcentage de la population vivant sous le seuil de la pauvreté, ces citoyens n’ayant que, mois après mois, leur prestation d’aide sociale pour subvenir à leurs besoins. Outre son active participation à la campagne des paniers de Noël, la Ville gère quelque trois douzaines de logements subventionnés construits il y a une vingtaine d’années par le gouvernement provincial. (Cette tâche devrait bientôt être attribuée à une autre structure administrative.) Il y a toujours une liste d’attente pour ces logements, le coût du loyer étant fixé à 25 pour cent du revenu de l’occupant. Ainsi, moins les revenus d’un individu sont élevés, plus ces habitations subventionnées deviennent attrayantes. Pour une personne seule ayant pour unique moyen de subsistance sa prestation d’aide sociale mensuelle de huit cents dollars, un appartement de l’Office municipal d’habitation est une aubaine. Ces unités locatives se retrouvent dans trois édifices différents situés à l’intérieur de quartiers résidentiels.
Toutefois, pour chaque individu dont la bonne fortune lui a permis d’avoir accès à un logement subventionné, il en existe à tout le moins deux ou trois à la recherche d’un loyer le plus économique possible. Presque tous ces logements se trouvent sur la rue Principale, à quelques pas de l’immense conteneur abritant le supermarché.
![]()
CHAPITRE 2
Noël sur la rue Principale
Dans les quartiers résidentiels, plusieurs demeures sont déjà ornées de lumières de Noël. À certains endroits, il n’y en a que quelques-unes, harmonieusement disposées, tandis qu’à d’autres, c’est une surabondance d’ampoules énergivores accompagnées de décorations gonflables couvrant tout le parterre. Mais pas sur la rue Principale.
Cette rue a connu des jours meilleurs. Des terrains devenus vacants après la démolition de bâtiments en décrépitude ou rasés par un incendie demeurent vacants. Parfois, seulement les appartements de l’étage génèrent des revenus ; le local commercial du premier niveau reste vide en dépit des pancartes à vendre ou à louer. Alors que quelques douzaines de commerces (dont certains réussissent bien) ont encore pignon sur rue le long de cette artère du centre-ville, certains édifices qui autrefois frétillaient d’activités commerciales sont aujourd’hui des immeubles à logements.
Il n’y a que peu de lumières de Noël sur la rue Principale et aucune sur l’immeuble où habitent Len et Tracy. Mais cela étonne peu : tous les autres appartements du bâtiment sont inoccupés.
« Nous ne serons que trois, indique Len. Nous ferons une fondue. Nous allons célébrer le 24. »
« Je dois travailler le 25, précise Tracy. Ce sera un jour comme les autres. Nous ne décorerons pas de sapin ; par contre, nous ferons un échange de cadeaux entre nous. »
« Mais le cadeau n’est jamais vraiment une surprise, ajoute Len, car nous vérifions toujours ce que l’autre désire. »
En Amérique du Nord, il est estimé que jusqu’à vingt pour cent des cadeaux de Noël sont expédiés directement au rebut.
Len et Tracy ne peuvent se permettre un tel laxisme. Ils vivent avec un budget d’environ mille dollars par mois provenant en partie de la pension du Québec de Len (il est âgé de soixante-trois ans) et en partie de l’emploi de Tracy, rémunéré neuf dollars de l’heure. De ces mille dollars, la somme d’environ quatre cents dollars est dédiée à leur logement de cinq pièces. Ils ne possèdent pas d’automobile. À différents moments au cours des dernières années, l’un ou l’autre eut recours à l’aide sociale. Parfois, ils se virent obligés de demander un panier de Noël, et certains mois sont plus difficiles que d’autres.
Ce ne fut pas toujours ainsi. Il y eut un temps où, pour Len, l’argent abondait.
« Je suis né au Danemark, dit-il. Ma mère était une épouse de guerre et mon père était dans l’armée de l’air. Je suis arrivé au Canada à l’âge de dix-huit mois et j’ai vécu dans presque toutes les provinces du pays, mon père étant transféré d’une base à l’autre. À un certain moment, il fut posté en France et, plutôt que de m’envoyer à une école du ministère de la Défense nationale, ma mère m’envoya vivre chez l’un de mes oncles au Danemark, où je fréquentai l’école pendant quatre ans. Je suis bilingue, mais en anglais et en danois. »
Len obtint deux fois son diplôme de l’école secondaire : la première fois au Danemark et la seconde fois en Ontario. Encore adolescent, il s’enrôla dans les Forces armées canadiennes, où il y resta deux ans.
À la suite de son passage dans l’armée, il trouva un emploi en tant que mécanicien automobile. Après quelques années, il mit les voiles vers d’autres horizons et devint courtier d’assurances, où il se montra plus que compétent. Il trouva le temps de s’inscrire à l’Université York et y obtint son diplôme. Il gravit les échelons jusqu’à des postes de gestion. Il s’aventura également dans l’immobilier à une période heureuse : l’effervescence du marché immobilier torontois le rendit millionnaire.
« Ma seconde épouse était originaire de Saint-Félix-de-Kingsey, raconte-t-il, et, à un certain moment, nous avons acheté une jolie demeure sise sur un terrain de cinq acres. J’ai aussi fait l’acquisition d’une petite compagnie qui fabriquait de l’équipement de technologie de pointe pour l’étude géologique. J’ai déménagé la compagnie ici, à Richmond, et les choses allèrent bien pour un temps. Nous vendions nos produits en Norvège, en Allemagne, en Australie, et même à la marine américaine. »
Mais la crise du pétrole prit Len au dépourvu. Incapable d’obtenir le financement nécessaire pour se maintenir à flot, la compagnie déclara faillite, tout comme Len. C’était il y a dix ans à peine. Il décrocha divers petits boulots par la suite et aujourd’hui il se dit semi-retraité.
« Avec le recul, dit-il, je pense que si j’avais déménagé ma compagnie de l’autre côté de la frontière, à Plattsburgh – ce que j’ai sérieusement considér...