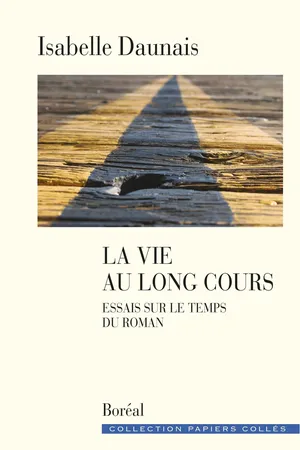![]()
troisième partie
La vie au long cours
Le bien comme possibilité
La représentation du bien, et plus largement de la vie bonne, a toujours constitué pour le roman un double problème. Un problème esthétique d’abord, qui tient à sa tâche de rendre compte de la réalité dans sa diversité, ses contraintes, sa multiplicité. Un problème pratique ensuite, qui vient de ce que l’art romanesque peut apporter ou non de spécifique à une telle entreprise : quel bien ou quelle forme de bien le roman, s’il ne veut pas être la simple transcription de valeurs déjà pensées et déjà définies en dehors de lui, autrement dit s’il ne veut pas être un simple relais de la morale, peut-il mettre en scène et donner à méditer ?
De ces deux problèmes, c’est le second qui est le plus difficile à résoudre, car si le romancier peut trouver des âmes exemplaires parmi tous les caractères d’hommes et de femmes que lui offre le réel et choisir de se concentrer sur elles, représenter une forme de bien qui ne soit pas un produit déjà tout construit par la morale est une entreprise infiniment plus délicate. Si délicate, d’ailleurs, que c’est souvent sous la forme de l’opposition ou, si l’on préfère, du tout ou rien que la critique considère les possibilités morales du roman : ou bien une œuvre est vertueuse, ou bien elle est ironique ; ou bien elle est portée par une conception idéale du monde et de la vie, ou bien elle est le lieu du désenchantement ; ou bien, pour reprendre les termes employés par George Sand dans une lettre qu’elle adresse à Gustave Flaubert en 1875, elle est du côté de la consolation, ou bien elle est de celui de la désolation.
Sans tout à fait contredire celle qu’il appelle respectueusement son « maître », Flaubert, dans la réponse qu’il fait à George Sand – qui lui reproche de prendre le parti de la désolation et de manquer de grands principes sur la vie –, suggère que cette conception binaire des choses lui paraît insuffisante :
Je pense comme vous, mon maître, que l’Art n’est pas seulement de la critique et de la satire. Aussi n’ai-je jamais essayé de faire, intentionnellement, ni de l’un[e] ni de l’autre. Je me suis toujours efforcé d’aller dans l’âme des choses, et de m’arrêter aux généralités les plus grandes, et je me suis détourné, exprès, de l’Accidentel et du dramatique. Pas de monstres, et pas de Héros ! […] Il me manque « une vue bien arrêtée et bien étendue sur la vie ». Vous avez mille fois raison ! mais le moyen de faire autrement ? je vous le demande. Vous n’éclairerez pas mes ténèbres avec de la Métaphysique, ni les miennes ni celles des autres.
Cette réponse résume bien la question. Celle-ci n’est pas pour le romancier, quel qu’il soit, de savoir s’il veut ou non représenter le bien (ou la morale, le progrès, la compassion), elle est de reconnaître qu’« une vue bien arrêtée et bien étendue sur la vie », telle que la préconise George Sand, est chose impossible dès lors que la vie ne relève ni de l’accidentel ni du dramatique, qu’elle n’est faite ni de monstres ni de héros, mais se situe dans la vaste zone où aucun bien ni aucun mal ne se dessine clairement. Faire naître, vivre, vieillir et mourir des personnages dans cette zone, c’est-à-dire dans la réalité la plus commune que nous habitons, ne signifie pas être du côté de la critique ou de la satire. Cela signifie plutôt que la définition d’une vie bien conduite et réussie est en soi sujette à caution, en soi ouverte à l’interrogation, en soi, et pleinement, un mystère.
Une scène de Bouvard et Pécuchet illustre le problème de façon très concrète. Elle se trouve dans le dernier chapitre, consacré à l’éducation des enfants. Après avoir vainement tenté de conquérir, dans les chapitres précédents, toute une série de savoirs scientifiques (agriculture, chimie, médecine, hygiène, philosophie, histoire), les deux compères se disent qu’ils seront peut-être plus habiles à maîtriser l’art de la pédagogie. Deux cobayes sont vite trouvés : Victor, un gamin d’une douzaine d’années, et Victorine, sa sœur d’environ dix ans, abandonnés et devenus la terreur du village tant ils multiplient les mauvais coups. Bouvard et Pécuchet les recueillent et entreprennent de faire leur éducation, et plus spécifiquement leur éducation morale. La tâche s’avère cependant ardue, les deux enfants, dont le père est en prison, n’ayant manifestement jamais été exposés à la moindre leçon dans ce domaine. Victor est particulièrement rétif aux principes qu’on cherche à lui inculquer et Pécuchet décide donc, « pour frapper son imagination », de suspendre au mur de sa chambre des images représentant « la vie du Bon Sujet et celle du Mauvais Sujet » :
Le premier, Adolphe, embrassait sa mère, étudiait l’allemand, secourait un aveugle, et était reçu à l’École Polytechnique. Le mauvais, Eugène, commençait par désobéir à son père, avait une querelle dans un café, battait son épouse, tombait ivre-mort, fracturait une armoire – et un dernier tableau le représentait au bagne, où un monsieur accompagné d’un jeune garçon disait, en le montrant : « Tu vois, mon fils, les dangers de l’inconduite. » Mais pour les enfants l’avenir n’existe pas. On avait beau prêcher, les saturer de cette maxime : le travail est honorable et les riches parfois sont malheureux, ils avaient connu des travailleurs nullement honorés, et se rappelaient le château où la vie semblait bonne.
Il y a évidemment dans cette scène beaucoup d’ironie, et la façon dont Flaubert caricature l’opposition entre le bien et le mal n’aurait certainement pas convaincu George Sand si elle avait vécu assez longtemps pour lire le roman. Mais l’idée clé, ici, est celle d’« avenir ». Les récits édifiants que donnent à lire les images proposées par Pécuchet n’ont de sens que de façon rétrospective, dans le résultat que constitue, pour le bon sujet Adolphe, l’accession à l’École polytechnique et, pour le mauvais sujet Eugène, sa condamnation au bagne. Si on peut aisément ranger du côté du bien et du mal chacune des actions représentées (embrasser sa mère, secourir un aveugle ; battre sa femme, se quereller), comment interpréter ce bien et ce mal dès lors que, dans la vie, et plus spécifiquement dans une vie, ils se mélangent et même se contredisent, ainsi que le savent d’expérience Victor et Victorine, qui ont vu des « travailleurs nullement honorés » et des puissants tout à fait heureux ? Quels seraient la valeur et le sens des bonnes actions d’Adolphe si, par quelque accident, il finissait ses jours au bagne ? Le mal commis par Eugène dans sa jeunesse serait-il annulé si, s’amendant sur le tard, il se mettait à secourir les aveugles et à embrasser ses vieux parents ? Un philosophe peut discourir autant qu’il le souhaite sur ces questions et, parce qu’il reste dans l’abstraction, proposer concurremment et théoriquement toutes sortes de réponses. À l’inverse, un romancier, qui ne peut raconter qu’une histoire à la fois, ne peut présenter qu’une réponse à la fois. Sans doute peut-il, pour cette raison même et comme le préconise George Sand, choisir la réponse la plus édifiante et faire en sorte qu’Adolphe devienne polytechnicien pendant qu’Eugène prend le chemin du bagne. Sauf que la réponse la plus édifiante n’annule pas les autres possibilités, ou, plus précisément, n’annule pas le fait qu’elle est, comme n’importe quelle réponse que l’on peut faire au sein d’un roman, aléatoire, anecdotique, singulière.
Je dis un roman, mais je devrais dire plutôt, en reprenant les termes de Flaubert, un roman dont les personnages ne sont ni des monstres ni des héros, c’est-à-dire des êtres dont le destin ou l’avenir n’est prévisible d’aucune façon, ni en termes de mal ni en termes de bien. Pour de tels personnages, chaque moment, chaque événement, chaque situation de l’existence peut faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre, chaque action voir ses conséquences livrées au hasard et à l’inconnu. Considérer le bien et le mal comme une possibilité parmi d’autres ou comme un résultat imprévisible est une approche très différente de la critique et de la satire. Elle se distingue aussi du désenchantement, car si l’idée d’un résultat imprévisible n’exclut pas la déception et la désillusion, elle n’exclut pas non plus que survienne une vie bonne, ou suffisamment bonne ; elle n’interdit pas que les conséquences des aléas puissent être positives.
Le bien comme une possibilité de la vie ou comme un chemin pris par la vie, le bien comme ce qui arrive plutôt qu’autre chose n’est visible ou calculable qu’a posteriori. C’est au moment où les jeux sont faits, en bout de course ou dans l’avenir, lorsqu’il n’y a plus rien à décider sauf, précisément, si la vie vécue a été bonne ou non, qu’un tel bien a la possibilité d’apparaître. Le terme calculable n’est peut-être même pas exact, car il s’agit d’un bien éminemment subjectif, dans lequel entre une bonne part des dispositions, du caractère et des exigences de celui qui cherche à l’évaluer. Toujours chez Flaubert, lorsque Frédéric Moreau et son ami Deslauriers font, à la fin de L’Éducation sentimentale, le résumé de leur vie, estimant que ce qu’ils ont « eu de meilleur » est un lointain épisode de jeunesse, ils sont libres de décider que cet épisode, sans racheter leurs impasses et leurs échecs, permet de faire pencher la balance du côté d’une vie jugée somme toute bonne. L’évaluation est d’autant plus liée à la subjectivité et même à l’ironie que l’épisode en question est la visite ratée des deux amis dans un bordel : Frédéric ayant pris peur au dernier moment, Deslauriers n’avait eu d’autre choix, faute d’argent, que de le suivre, et leur escapade avait été remarquée (« On les vit sortir. Cela fit une histoire, qui n’était pas oubliée trois ans après. »). Cependant, à l’heure des bilans, c’est « prolixement » que les deux personnages se racontent ce souvenir et quelques autres ; c’est sur tout ce que cette entreprise, même avortée, contenait d’aventure, de promesse et d’amitié que le roman se conclut. Il ne s’agit pas d’un bien assuré. Le lecteur peut y trouver autant de consolation que de désolation, comme il peut trouver autant de l’une que de l’autre dans la façon dont Flaubert fait mourir la servante Félicité, l’héroïne naïve d’« Un cœur simple », en lui faisant voir dans le ciel, au moment de son dernier souffle, le Saint-Esprit sous la forme de son perroquet tant aimé. Le fait qu’il n’y ait ici aucune certitude, qu’il n’y ait personne, comme le déplorait l’avocat du ministère public au procès de Madame Bovary, pour nous dire ce qui doit être pensé, n’empêche pas que le bien, sous la forme d’une vie jugée correctement ou suffisamment vécue, correctement ou suffisamment heureuse, soit une possibilité tout à fait réelle.
Cette possibilité peut même exister lorsque tout semble vouloir la nier. C’est le cas à la fin d’Une vie, le roman de Maupassant, même si les malheurs de son héroïne sont aussi nombreux qu’indéniables. Après avoir été trompée par son mari, vu mourir ses parents, vendu la maison de son enfance pour rembourser les dettes de jeu de son fils, Jeanne est compensée de toutes ses peines, à la fin du roman, par la naissance inopinée d’une petite-fille que son garçon lui confie. Les plateaux de la balance ne sont évidemment pas équilibrés, car outre que les souffrances de Jeanne ont été bien grandes et qu’elle est à présent bien vieille, la survenue de l’enfant, si heureuse et consolatrice soit-elle, ne se présente pas à son esprit comme une conclusion morale dont elle ferait elle-même l’évaluation. C’est à sa servante que cette conclusion apparaît, alors qu’elle égalise les choses en prononçant, avec sa sagesse toute paysanne et en guise d’excipit, que « la vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit ». Certes, l’axiome a quelque chose de naïf ou d’ironique, après le long tableau de malheurs que vient de traverser le lecteur. Mais peu importe de quel côté on fait pencher la balance, le fait est que le bien ne se mesure pas en actions vertueuses ou exemplaires, mais est simplement ce à quoi il est possible de conclure ou non au terme d’une vie vécue.
Il en va de même dans le beau roman de Fromentin, aujourd’hui oublié, qu’est Dominique. Quand commence le livre, le héros a l’âge de la maturité, il est marié et père de famille, établi à la campagne, et c’est à un gentilhomme de passage qu’il raconte, comme dans les romans du xviiie siècle, sa jeunesse souffrante et troublée. Il a, au temps de son adolescence, aimé d’un amour éperdu une jeune femme mariée tout en sachant le mal qu’il lui faisait par cette adoration dévorante qui n’était pas sans retour. Lorsqu’après le récit de ces années douloureuses – récit qui compose l’essentiel du roman – le héros et son confident tentent d’en tirer une conclusion, ce n’est pas sur le passé que porte leur réflexion, mais sur l’état actuel des choses. Objectivement, cet état est irréprochable : Dominique est un père aimant et un mari respectueux, un propriétaire terrien prospère et généreux. À tous égards, sa vie est rigoureusement exemplaire, et l’on pourrait conclure à la sagesse acquise du héros. Ce bien quantifiable n’est cependant pas ce qui est interrogé. Ce qui l’est, c’est la part de doute qui demeure au sein de ce bien. Au gentilhomme qui a écouté son récit, Dominique demande et répond à la fois : « Oui, me voici arrivé. À quel prix ? vous le savez ; avec quelle certitude ? vous en êtes témoin. » Sauf qu’il n’y a justement aucune certitude dont le gentilhomme, au terme du roman et de la longue confession de son interlocuteur, puisse témoigner. La seule chose qu’il pourrait attester est, précisément, l’absence de toute certitude : le bien, la vie bonne sont hautement probables, mais une part plus ou moins grande de doute reste à la fin du roman.
Cela dit, qu’avons-nous à gagner, comme lecteurs, d’un bien seulement possible ? Pourquoi ne pas préférer la clarté d’un bien certain ? Pourquoi ne pas vouloir le récit d’une vie exemplaire, imitable, plutôt que celui d’une vie dont le sens est imprévisible et qui pour cette raison ne peut servir de modèle ? De fait, un grand nombre de lecteurs préfèrent la clarté et l’exemplarité, et un grand nombre de romans les leur offrent. Pour autant, le bien incertain, le bien seulement possible n’est pas un bien négligeable. Ce n’est pas uniquement qu’il est plus proche de ce que chacun est appelé à connaître dans le cours de son existence, et même plus proche de l’existence en soi, qui par définition est contingente et dépourvue de conclusion. C’est aussi que le bien possible ou le bien incertain offre un autre type de réconfort, un autre type de secours que le bien exemplaire. Parce qu’il n’est assignable à aucune morale, à aucun idéal, à aucune leçon qui puisse être reproduite, il constitue une forme de pari et d’énigme. C’est un bien plus humble, plus terrestre, plus ouvert à tout ce qui, dans une vie, peut survenir. En se refusant à la « consolation », Flaubert et les autres romanciers du bien possible n’évacuent pas, comme on le croit trop souvent, l’idéal au profit de la « désolation » ou du désenchantement, ils laissent le plus de place possible à cette énigme, ils font en sorte que ce soit elle que nous emportions avec nous, une fois le livre refermé.
La leçon de Balzac, la leçon de Tolstoï
Il y a plusieurs façons de mesurer ce qu’une œuvre apporte à l’art auquel elle appartient. On peut considérer les thèmes, les idées et les motifs qu’elle explore et s’efforcer de voir de quelle façon elle en révèle une potentialité ou u...