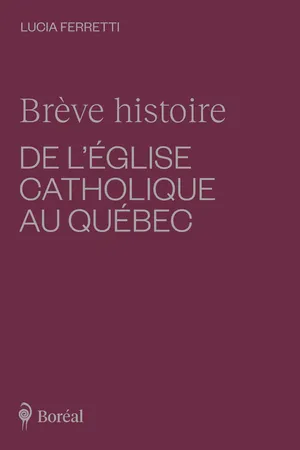CHAPITRE V
Apogée et déclin de l’Église nationale
De la Première Guerre mondiale jusqu’à la Révolution tranquille, l’Église se déploie pleinement comme organisatrice principale de la société québécoise. Cette société québécoise, un carré de clercs parmi les plus conservateurs rêvent encore d’en faire une chrétienté rurale reposant sur une famille indépendante et une « épouse dépareillée », mère de nombreux enfants. Cependant, la tendance dominante au début du xxe siècle, parmi les séculiers comme dans les congrégations, consiste plutôt à s’approprier la ville, le monde industriel et toute la société civile. Pour les régénérer, souvent dans un esprit de croisade : le durcissement doctrinal dont les papes Pie X, Pie XI et Pie XII se font les champions se répercute au Québec, à mesure que le cléricalisme se consolide. Mais il s’agit aussi de les structurer en corps intermédiaires placés dans l’orbite de l’Église ; dans le contexte québécois, ce catholicisme social aboutit à la promotion d’un modèle de société fondée sur la communauté, issue du milieu et favorable aux Canadiens français, et au rejet, en revanche, du modèle dominant de modernité exogène, souvent écrasante et reposant sur une intervention accrue de l’État. Rencontrant peu d’obstacles, l’Église réussit jusqu’aux années de guerre à étendre très largement la sphère de son action et de son influence.
Ces succès mêmes font alors surgir chez plusieurs religieux et laïcs œuvrant dans des milieux divers le sentiment que l’engagement de l’Église dans la gestion du milieu social entrave la poursuite de sa mission spirituelle. Ils seront les premiers, pendant la crise, à promouvoir la déconfessionnalisation des mouvements sociaux, à travailler, en somme, à la sécularisation de la société québécoise. Après la guerre, par ailleurs, alors que le Québec vit une période de prospérité sans précédent, faite de modernisation économique, d’intervention de l’État fédéral, d’immobilisme du régime Duplessis et de consolidation des valeurs d’autonomie et d’individualisme qui avaient commencé dès auparavant à émerger, c’est tout le modèle de société établi par l’Église qui se lézarde irrémédiablement. Malgré ses efforts et sa détermination, l’Église ne suffit plus à combler les besoins et les exigences de la population en matière d’éducation, de santé et de services sociaux. La prise en charge par l’État de tous ces domaines et la laïcisation de la société sont désormais exigées par un nombre toujours plus grand d’associations volontaires, d’organisations professionnelles et de syndicats issus du catholicisme social. En outre se dresse contre l’Église et contre le duplessisme l’impatience de moins en moins contenue des élites intellectuelles et artistiques, qui s’engagent dans le procès d’une société jugée étroite, mesquine, opprimée par le cléricalisme et l’autoritarisme. Enfin, dernier coup mais non le moindre, toute une manière de vivre la foi est en voie d’être dévalorisée par la nouvelle petite bourgeoisie professionnelle et intellectuelle. À côté de cela pointe un timide renouvellement de la religion, qui n’éclora vraiment qu’après 1960.
Sur la lancée du xixe siècle
À considérer l’intensité de la vie religieuse du peuple, le rayonnement des missions, les services offerts aux nouvelles communautés catholiques qui s’installent au Québec ou le nationalisme profond de l’Église, on a l’impression que le catholicisme québécois, jusqu’aux années 1930, poursuit sur la lancée du xixe siècle en accentuant et en élargissant les caractères qu’il en a reçus.
Un peuple croyant et bien encadré
Entre la guerre et la crise, les catholiques forment constamment environ 85 % de la population québécoise, et 92 % de ces catholiques sont des Canadiens français. De congrès eucharistiques régionaux en célébrations de la fête du Travail et d’anniversaires d’archevêques au congrès marial de Québec de 1929, l’Église continue à témoigner sans cesse de sa capacité à mobiliser les masses et à donner d’elle-même une image de grandeur et de puissance. Tout comme la vie de la cité, l’activité quotidienne est rythmée par les obligations religieuses mensuelles, hebdomadaires ou journalières. Aucune des dévotions privées ou communautaires instaurées depuis les années 1840 n’est abandonnée et la plupart sont pratiquées avec une intensité encore accrue. Prenons la communion comme exemple. On a pu calculer qu’à Saint-Pierre-Apôtre de Montréal, chaque paroissien en âge de le faire a communié trente-neuf fois en 1926 : après les campagnes du xixe siècle en faveur de la communion mensuelle, on est bien près maintenant de la généralisation de la communion hebdomadaire. Encore au xxe siècle, la religion continue d’être fortement axée sur le salut personnel. Les fidèles de l’époque entendent parler essentiellement de soumission à la volonté de Dieu et d’eschatologie, c’est-à-dire de la fin du monde, du jugement dernier, de la résurrection. La prédication est faite de péché plus que de grâce, de mort plus que de vie, de devoir et d’obligation plus que de liberté dans la foi. Rien ne témoigne mieux de cette profonde préoccupation pour le salut que la canonisation, en 1925, de Thérèse de Lisieux, une jeune carmélite morte à la fin du xixe siècle. Son autobiographie Histoire d’une âme, vendue entre 1898 et 1925 dans le monde à plus de 2,5 millions d’exemplaires dans ses versions intégrale et abrégée, propose un idéal de sainteté qui passe par une « petite voie » accessible, celle de la perfection dans la vie quotidienne. Au Québec, Thérèse est une véritable héroïne.
Avant 1930, une autre tendance prend un nouveau relief, celle de la croissance phénoménale des vocations sur-tout due au recrutement local. En 1931, le Québec compte 4 300 prêtres, soit 1 pour 576 fidèles, et 1 religieux ou 1 religieuse pour 97 fidèles, au sommet de la catholicité. Au début de la crise, pas moins de 27 100 Québécoises sont des religieuses, contre 15 200 en 1911.
Ces vocations se cultivent dès l’enfance. D’abord au sein des familles, surtout les familles nombreuses des campagnes pour lesquelles donner à l’Église un fils ou une fille équivaut à un gage de salut et, si le fils devient prêtre, à une promotion sociale. Les familles passent le relais au curé, qui est dans toutes les paroisses un éveilleur de vocations, et celui-ci à son tour le transmet à l’école ou au collège classique, qui laissent s’échapper d’autant moins de candidats potentiels que le réseau scolaire se resserre, grâce notamment à l’abondance des effectifs religieux et cléricaux. On a fait valoir que les garçons les plus brillants pouvaient espérer mener chez les religieux une véritable carrière, que les curés, sauf dans les paroisses misérables, bénéficiaient d’un revenu non négligeable et partout d’un prestige certain, qu’en entrant chez les sœurs les femmes échappaient aux destins tracés d’avance de mère ou de vieille fille, et on a vu là, parfois, des explications suffisantes à la multiplication des vocations. Sans doute, de tels motifs ont existé. Il convient toutefois d’ajouter à cette liste les raisons qu’ont invoquées les intéressés eux-mêmes et qui, dans la culture de l’époque, leur ont paru les plus déterminantes : le désir de répondre à l’appel de Dieu dans l’oblation et celui du dépassement de soi dans l’action, nourris tout ensemble par la foi et par les projets missionnaires, pastoraux et sociaux de l’Église à cette époque. D’ailleurs, l’Église peut d’autant mieux réaliser ces projets qu’elle dispose de cette main-d’œuvre abondante, laborieuse et totalement dévouée.
Les missions extérieures
Tout comme Grégoire XVI en son temps, les papes du xxe siècle font des missions extérieures une de leurs priorités. Pie XI exige que chaque ordre religieux s’établisse dans les territoires relevant de la Propagande, d’où un doublement du nombre de missionnaires entre 1922 et 1939. Ceux-ci apportent l’Évangile et, avec lui, ils transplantent l’Occident. Ils baptisent, convertissent, alphabétisent, soignent ; puis, ils cherchent généralement à couper les convertis de leur milieu, jugé superstitieux. En fait, il faudra le vaste mouvement de décolonisation des années 1950 et 1960 pour qu’enfin soit posée la question de la distinction entre la culture occidentale et le message chrétien.
Au Québec, une femme contribue puissamment à l’essor des missions lointaines, préparées du reste par toute l’histoire des missions indiennes. Soit directement, soit par l’intermédiaire des sœurs qu’elle a formées, Délia Tétreault, dite mère Marie-du-Saint-Esprit, est d’abord à l’origine des trois communautés missionnaires féminines fondées au Québec, toutes entre 1902 et 1928. Elle réorganise aussi l’œuvre de la Sainte-Enfance, à laquelle des générations d’écoliers québécois vont bientôt donner quelques sous pour « l’achat des petits Chinois ». Elle convainc en outre, en 1921, les évêques de fonder conjointement la Société des missions étrangères, pour former et suivre les prêtres missionnaires séculiers, puis même réguliers, de tout le Québec.
Toutes ces initiatives portent fruit. La Propagande confie, en effet, dès avant 1934, deux diocèses, six vicariats apostoliques et trois préfectures à l’Église canadienne, qui, à l’étranger, est pour ainsi dire uniquement canadienne-française. Les Québécois vont surtout en Asie (Chine, bien sûr, mais aussi Philippines, Japon, Indochine, Bengale) et un peu en Afrique. En 1932, on dénombre plus de 1 200 prêtres, religieuses et religieux canadiens des congrégations missionnaires dans les territoires de la Propagande ; ils seront 3 320 dans 68 pays des 5 continents en 1959, surtout en Afrique, cette fois, et en Amérique latine, car la Chine leur est fermée depuis la révolution communiste. À ces nombres, déjà impressionnants, il faut ajouter au moins 10 000 religieuses et religieux des congrégations enseignantes et hospitalières en 1931, plus encore par la suite. Les fidèles donnent par ailleurs tout près de 10 millions de dollars pour les missions entre 1920 et 1948, ramassés à coup de 25 cents dans chacune des paroisses, ce qui place le Québec dans les tout premiers rangs mondiaux pour le soutien aux œuvres pontificales. Un tel effort en vocations, en argent, en innombrables prières aussi, est stimulé de bien des manières : revues missionnaires, expositions dans plusieurs villes, cercles d’études dans les collèges jésuites, cercles de couture dans les paroisses et les écoles de filles. Rien n’est négligé.
Montréal, une courtepointe religieuse et ethnique
Parce que les barrières des classes et des langues renforcent celles des confessions, et aussi parce que leurs curés le leur interdisent, les catholiques montréalais ne fréquentent que rarement juifs et protestants, hormis dans le monde du travail et du commerce. Entre catholiques, les cloisons, bien sûr, ne se dressent pas aussi haut. Cependant, la vieille politique de ségrégation ethnique imposée par Rome dès 1872 à la demande des Irlandais contribue à éloigner l’une de l’autre les deux plus anciennes communautés catholiques de Montréal. D’autant plus que, pour contrer l’influence protestante sur ces anglophones, forcément plus vulnérables, Mgr Bruchési consacre une partie des ressources financières puisées dans le diocèse à les aider à se bâtir le réseau institutionnel qu’ils souhaitent, bien distinct de celui des francophones. C’est ainsi qu’est inauguré l’hôpital St. Mary en 1924, puis le high school public D’Arcy-McGee en 1932, et qu’est encouragé à partir de 1928 le mouvement vers l’autonomie accrue du secteur anglophone de la CECM, la commission scolaire catholique. En fait, très tôt, les Irlandais de Montréal jouissent d’institutions et d’organisations bien à eux ; il ne leur manque plus qu’un prélat : ce sera Mgr Lawrence P. Whelan dès 1941, auxiliaire de l’archevêque pour tout ce qui les concerne.
Les immigrants d’origine non britannique, quant à eux, sont venus au Canada d’abord pour l’agriculture, dans l’Ouest, et pour les mines, dans le Nord. Mais à partir de la guerre et durant le boom des années 1920, les emplois liés au développement de l’urbanisation et de l’industrialisation les attirent en ville de plus en plus. Ville multiculturelle depuis longtemps déjà, port d’accueil d’un grand nombre d’immigrants de tous horizons par la suite, Montréal présente avant 1930 le visage le plus multiethnique de toutes les villes canadiennes. Cela pose à l’Église québécoise des défis inédits, sinon dans leur nature, du moins dans leur ampleur.
Pour faciliter leur vie quotidienne, les immigrants ont tendance à se regrouper entre eux et près des sources d’emplois. Les mille catholiques syriens et les deux cents catholiques chinois s’établissent autour de la rue De La Gauchetière, les Ukrainiens, les Polonais et les Lituaniens plutôt dans Pointe-Saint-Charles ou dans Hochelaga, les quinze mille Italiens présents en 1920 résident au centre-ville, puis aussi dans le quartier du Mile-End. L’historien Roberto Perin a noté que, à peine arrivés, tous ces groupes demandent à l’archevêque des paroisses ou un clergé allophone, comme ils le font également dans les autres villes canadiennes. Ils en sentent le besoin à la fois parce que la vie communautaire favorise une transition progressive entre leur pays d’origine et leur pays d’adoption, et parce qu’ils veulent exprimer leur piété et prier à leur manière. Dans l’ensemble, c’est à Montréal que ces requêtes sont le mieux accueillies, en partie parce que la voie de la différence a été ouverte par les Irlandais, en partie aussi parce que, pour les évêques et le clergé francophones, la langue est véritablement la gardienne de la foi, en partie enfin pour tenter d’éradiquer l’influence socialiste.
Avant 1930, des paroisses ou, au moins, des missions sont donc érigées pour la plupart des groupes d’immigrants. Des congrégations de femmes, soit missionnaires, soit enseignantes, s’occupent aussi de mettre sur pied des écoles trilingues rattachées à la CECM et parfois même un hôpital, comme l’Hôpital chinois, fondé pendant l’épidémie de grippe espagnole de 1918. Dans la paroisse ukrainienne, les prêtres se dépêchent d’organiser la vie sociale précisément pour couper l’herbe sous le pied aux premières organisations communautaires, des sociétés de secours mutuels, instaurées à l’intention des immigrants d’Europe orientale par des laïcs aux idées socialistes. Mgr Bruchési, et après lui Mgr Gauthier, confient presque toujours les paroisses à des congrégations religieuses, qui à leur tour trouvent pour les desservir des pasteurs ne venant généralement pas directement des pays d’origine, mais passés d’abord par les États-Unis. Cela constituera d’ailleurs un facteur supplémentaire d’anglicisation des immigrants au Québec.
Une Église n...