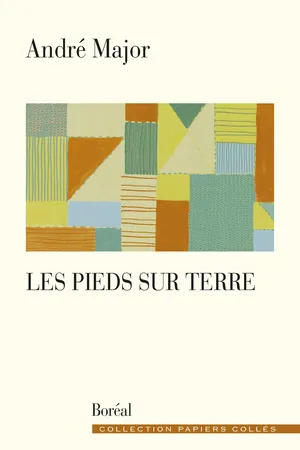2004
3 janvier – Ce goût que j’ai de noter, souvent associé à la promenade ou à la lecture, tient au fait que je tire un plaisir très vif des mots qui expriment le plus justement possible ce qui me traverse l’esprit, parfois de manière impromptue. Mes notes, c’est en y travaillant, c’est-à-dire en les mettant au net, que j’en entrevois la portée, si ténue soit-elle. Et je ne parle pas de la joie que j’éprouve quand cela me semble venir du lointain d’une mémoire que j’interprète de mon mieux, comme tant d’autres le font dans leur propre langue. Cette joie est à son comble s’il en émane un peu de lumière.
Dans la nature, on découvre parfois ce qu’on n’y cherchait pas. De même qu’on peut s’y perdre de vue ou s’y retrouver. En société, on perd souvent de vue ce qu’on projetait d’y apporter et l’on ne trouve guère ce qu’on avait la naïveté d’en attendre.
Relu Deux jours, deux nuits de Per Olof Sundman. Dans ce roman bref et laconique, il y a un intéressant contrepoint entre les constatations d’ordre scientifique – sur le corps et la météo – et les affirmations relevant de la morale et de la psychologie, presque toujours sujettes à caution et marquées d’une ambiguïté qui rend toute conclusion indéfendable. J’aurais envie d’écrire un texte sur son œuvre, mais je n’en ferai rien. Je préfère m’en tenir à des notes prises au fil de ma lecture – un peu par paresse, beaucoup parce que je n’éprouve plus le besoin de convaincre les autres du bien-fondé de mes préférences littéraires. La plupart des articles le moindrement développés que j’ai menés à terme m’avaient d’ailleurs été commandés. (J’ai appris, en consultant Wikipédia, que Sundman aurait eu des sympathies nazies, qu’il a reniées par la suite en ralliant un parti centriste. Je pourrais déplorer cet égarement, mais est-ce que cela devrait m’amener à brûler ses œuvres ? Il faudrait, en toute justice, que j’en fasse autant pour Cioran ou Hamsun.)
Au journaliste André Parinaud, qui évoquait son prétendu pessimisme, Simenon répond qu’il ne se considère pas comme pessimiste puisqu’il n’a jamais attendu grand-chose de l’espèce humaine et qu’il se contente de la décrire telle qu’il la voit, c’est-à-dire en noir – celui de la fatalité. Selon lui, d’ailleurs, la tragédie s’est réfugiée dans le roman.
Le mode interrogatif convient à celui qui n’a pas une vision toute faite du monde. Ce qui le fait se sentir souvent très seul.
Quelquefois mes rêveries débouchent sur la méditation, mais cette méditation ne tarde pas à se diluer dans la rêverie, et « durant ces égarements mon âme erre et plane dans l’univers sur les ailes de l’imagination », sans cependant sombrer, comme c’est le cas du Promeneur solitaire, « dans des extases qui passent toute autre jouissance ».
Le romancier Dany Laferrière déclare à la radio qu’il revient au journalisme et au cinéma. Il a bien raison d’agir de la sorte si, comme il l’affirme, il considère avoir fait le tour de son jardin. Tant d’autres, sous prétexte qu’écrire est leur métier, continuent de bêcher un coin de terre stérile, alors qu’il leur serait plus profitable de passer à autre chose. (Relue maintenant, cette note appelle un ajout qui se présente sous forme d’interrogation : en soumettant sa candidature à l’Académie française, notre Dany amorçait-il un retour à l’écriture ou faisait-il des adieux ironiques à la littérature ? Quoi qu’il en soit, son élection aura radicalement changé l’opinion des Québécois sur l’auguste institution française : elle que nous honnissions quasi unanimement, la voilà devenue honorable. Mais ne nous emballons pas trop : l’Académie n’offre aucune garantie de pérennité à ses Immortels.)
Je reviens à Per Olof Sundman pour ajouter que, dans Deux jours, deux nuits, l’espèce de polarité qui existe entre l’incertitude psychologique ou morale et les certitudes d’ordre pratique tient lieu de procédé narratif, de même que dans L’Enquête la juxtaposition des points de vue contradictoires remet constamment en question le constat de l’enquêteur. Chez Sundman, la vérité fuit comme du sable, rendant tout jugement aléatoire. Trancher, c’est forcément courir le risque de se tromper. Le plus beau récit de Sundman, Ce pays est une grande île, est l’adaptation d’une saga islandaise, où il montre avec la plus grande finesse la difficulté de rendre justice en toute justice.
7 janvier – Hier, comme je recevais J. et son cher petit, j’ai préparé un plat de bison, accompagné d’une polenta aux quatre fromages, puis j’ai mis hors de portée tout ce qui risquait de représenter un danger pour Antoine. Au moment où nous nous mettions à table, il est allé chercher un napperon qu’il a posé devant lui, comme j’aurais dû le faire, mais il n’a presque rien mangé, réclamant son sablé au beurre – un des rituels qu’il n’est pas question d’oublier. Et il est monté à l’étage faire son habituelle tournée, ce qui nous a obligés, sa mère et moi, à le suivre pas à pas, puis il m’a entraîné au salon où il a ouvert l’Atlas du monde, qu’il feuillette avec moi chaque fois qu’il vient à la maison. Pour finir, il a réclamé sa musique préférée sur laquelle nous avons dansé un bon moment. Avec lui, il faut toujours que ça bouge, et à son rythme, sinon rien ne va plus. Une fois seul, j’ai ramassé tout ce qui traînait avant de faire des courses pour le repas du soir.
Que la littérature apparaisse comme un contre-pouvoir, on a pu le voir ici ou là ; mais qu’elle opère comme une magie ou même qu’elle ne devienne rien de moins qu’un ersatz de la vie, je ne l’ai pas cru longtemps. Je veux bien admettre cependant qu’elle peut servir de refuge aux éclopés de l’existence, et même de revanche sur le destin, sinon de passe-temps. J’ai renoncé, pour ma part, à définir cette littérature qui a été au cœur de ma vie jusqu’à la modeler.
Au cours de mes promenades solitaires, je renoue avec les morts qui me demeurent proches, comme si un dialogue intime pouvait devenir possible, comme si l’embarras qui nous a toujours réduits au silence pouvait disparaître par enchantement. Que dirais-je à mes parents que je n’ai pu dire de leur vivant ? Et eux, de leur côté ? Nos relations ayant surtout été d’ordre pratique, exemptes de toute manifestation affective, comment pourrions-nous leur attribuer une autre portée ? C’est maintenant que je comprends qu’étant ce que j’étais, je représentais pour eux un cas assez déroutant et qu’il leur suffisait de me savoir bien portant et à l’abri du besoin. Faute de les entendre, je leur dis ce qui me passe par la tête, notamment ce que j’aurais pu leur demander qui m’aurait peut-être aidé à accepter leur austérité, leur repliement sur les nécessités quotidiennes, de même que l’hostilité qu’ils manifestaient ouvertement l’un à l’égard de l’autre et qui me semblait intolérable après tant d’années de vie commune.
Des gens qu’on n’avait pas vus depuis longtemps ont beau avoir pris un sérieux coup de vieux, on les reconnaît tout de suite parce qu’ils se présentent tels qu’ils ont toujours été, comme s’ils étaient sortis indemnes de l’expérience de la vie.
Celui qui s’enorgueillit de sa modestie, jamais vous ne l’entendrez se plaindre de sa popularité.
Dans son Journal inutile, si irritant parfois, Paul Morand dit que « la vie en société n’est qu’une longue suite d’agressions contre votre liberté » et qu’on « n’arrive à vivre et à se protéger que dans les premières heures du matin », ce qui n’est pas le cas pour moi qui dois souvent remettre au lendemain un travail qui finit par ne plus compter à mes propres yeux.
Le je des carnets témoigne d’une résistance au silence mortel qui le guette et auquel il est parfois tenté de céder.
Si je me sens si proche de Kafka, c’est entre autres raisons qu’il m’arrive d’être aussi torturé que lui, aussi insatisfait que lui, aussi étranger à ce qui me semble aller de soi pour mes contemporains. Si l’on ne vaut sans doute pas mieux que le premier venu, il n’empêche qu’on perçoit autrement, avec plus d’acuité parfois, ce qui nous entoure ou ce qui passe pour aller de soi. Le sentiment de cette différence ne confère aucune supériorité d’ordre moral à celui qui l’éprouve puisqu’il n’est que la conséquence d’une conscience plus aiguë de l’expérience humaine.
C’est une grande tristesse de ne pouvoir parler ou écrire sa langue maternelle sans toujours douter de la justesse de telle tournure ou de la précision d’un terme ou de s’entendre faire une faute avec le sentiment humiliant d’affaiblir son propos. Et pourtant, autour de nous, des journalistes et des personnages publics massacrent leur langue sans vergogne, comme si ce n’était là qu’une manifestation de sympathique délinquance intellectuelle.
Une fois qu’on a conclu à la vanité d’un salut quelconque en ce monde ou dans l’autre, il nous reste la possibilité de vivre à la hauteur de nos moyens, si faibles soient-ils, sans pour autant sombrer dans une triste résignation.
Le dernier bâton de marche que je me suis offert, c’est dans un jeune merisier que je l’ai taillé. Comme je ne l’ai pas dépouillé de son écorce, il est encore plein de sève. Il vibre en touchant le sol, et cette vibration réconfortante, je la ressens au creux de ma paume. L’indécrottable terrien que je suis est curieux de savoir combien de temps la vie passera ainsi du sol à moi par l’entremise de ce bâton.
Qu’un peu de beauté ou qu’un brin de vérité apparaisse dans le discontinu de ces carnets, je ne demande rien de plus. Que je demeure un prosateur quelque peu marginal me convient tout à fait, si mes lecteurs éprouvent un certain bien-être à me fréquenter – pourvu qu’ils ne quittent pas ce monde avant moi…
Le livre que je préfère de plus en plus, c’est celui où je peux circuler à mon gré – et non pas de la première à la dernière phrase, comme on le fait en entrant dans un récit – et que je peux découvrir comme on découvre une forêt, en quittant le sentier pour suivre le cours d’un ruisseau ou en rêvant, assis contre le tronc d’un arbre. Il m’arrive ainsi de reconstituer la trame d’un récit à l’aide des fragments disparates qui composent les carnets d’un Handke ou le Journal d’un Kafka. Ce qui ne m’empêche pas d’éprouver parfois le plaisir irremplaçable de suiv...